
Publié aux éditions Vroum, le recueil de Louis Dorsène s’intitule Quatre catastrophes, comme autant de poème à dire à haute voix pour mieux revenir au pouvoir agissant de la poésie, dans une écriture engagée, vive et pleine d’humour.
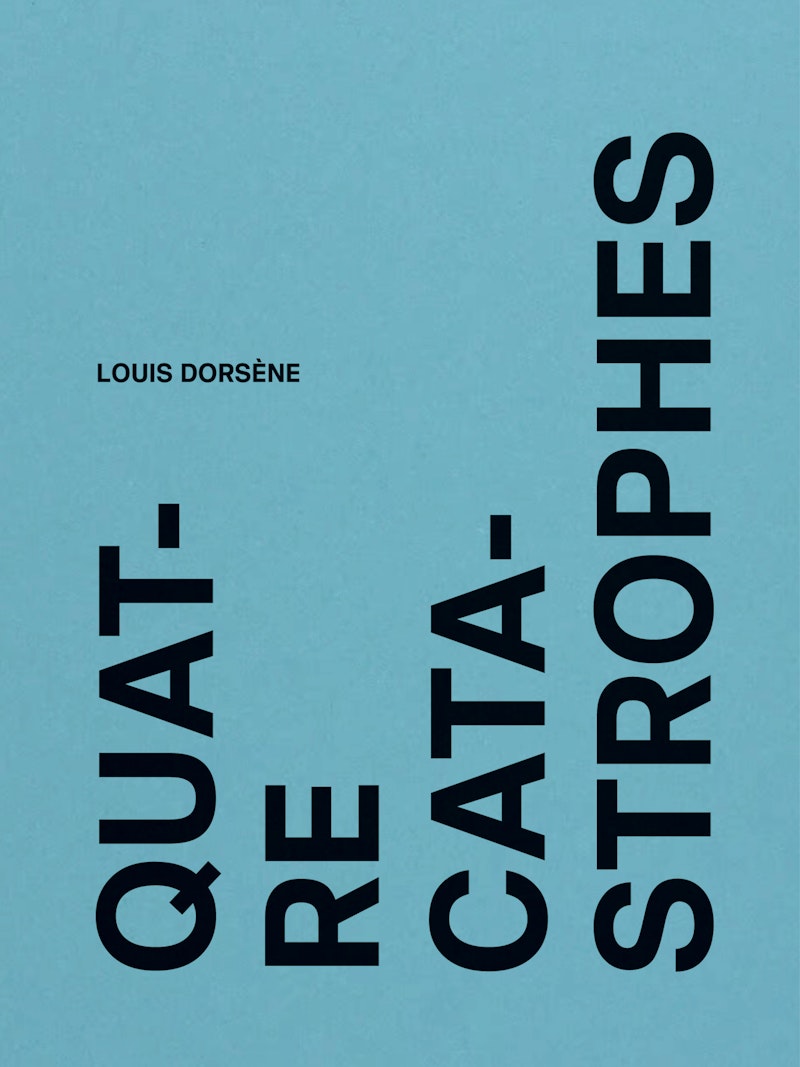
Louis Dorsène :La notion de récit pour qualifier le travail de Quatre Catastrophes me semble fondamentale dans la mesure où il s’agit bien de raconter quelque chose, d’investir des évènements, des idées, par le recours à l’image. Chaque poème se construit autour d’une crise, d’un épisode qui contient en lui-même une évolution linéaire : à ce titre, Volcan(s) apparaît comme le plus simple, en apparence, en prétendant être le seul récit d’une éruption avant/pendant/après. Dans le concept même de « catastrophe », on trouve l’idée d’un changement, et donc d’une progression chronologique ou idéelle : l’approche de la catastrophe, quelle que soit la manière, rejoint la nécessité d’un récit, que ce soit celui fait par l’écriture, ou imaginé en amont par le lecteur. Ainsi, récit et fiction ne recouvrent pas nécessairement, dans ce recueil, le même geste : ou alors il s’agit de penser une fiction non-humaine, sans autre personnage ni discours que celui tenu par les forces mobilisées dans ces mêmes évènements, ce qui déplace automatiquement l’approche même de l’idée de fiction. Dès lors, le recours à des « raisonnements narratifs qui saturent l’argumentation » montre une autre manière de faire histoire : la succession d’images, ou leur épuisement méthodique, pseudo-argumentatif, comme dans la comparaison « Le capitalisme est comme un iceberg », participent activement de la résolution de la catastrophe, ou de son ouverture vers un monde autre, aussi bien que n’importe quelle péripétie ou n’importe quel dénouement dans une fiction. Or, c’est ce « monde autre » que je cherche à ouvrir, à créer en tant que possible avec le recours à une poésie qui me semble plus épique que lyrique.
Rodolphe Perez : Les textes reposent sur un usage actif, agissant de la parole. « Dire », dis-tu d’ailleurs, plutôt que « lire à haute voix. » Mais parce que ces textes ont aussi – surtout – une dimension politique dont ils tentent d’épuiser les recoins perdus d’une parole qui ne signifierait pas.

Ainsi, la poésie devient nécessairement un « dire », voire un « crier », qui se doit d’être mis en corps, actualisé dans la performance (dont la lecture à haute voix serait alors un degré zéro), pour deux raisons : faire de chaque texte, selon le vœu de Garance Dor des éditions Vroum, une « partition » que chacun.e pourrait s’approprier pleinement, à sa manière, et donner au texte une place dans l’espace public en tant que discours partagé et reçu qui, d’une rencontre intime, devient une ressource militante.
Rodolphe Perez :Si tes textes postulent des crises, qu’ils énoncent, c’est un peu à la manière de tableaux qui disent la passivité du sujet face à sa spectacularisation, et ramènent l’impératif agissant du « dire » comme œuvre du poète. Tu parles de la « nécessité d’un récit », et d’un geste qui serait épique. Aussi, ne pourrait-on pas lire dans tes quatre temps pour catastrophe comme le besoin de rappeler que certains mythes n’en sont pas ? Qu’il y a un arbitraire de l’histoire ?

Rodolphe Perez : Au sujet de la question historique, ta tentative d’épuisement joue comme un geste de déconstruction, qui prendrait le phénomène par son envers : en assumant une surenchère du sens il finit par le déborder, l’excéder, et manifeste assez franchement l’absurdité du discours – politique notamment –, dénude l’histoire, pour relier les causes et les effets.
Louis Dorsène : Il y a deux choses fondamentales qui recouvrent, à mon sens, le rapport à l’absurde dans les textes. La première, qui je pense est ressentie par de plus en plus de gens, est une forme d’incompréhension totale de la situation : tandis que tous les indicateurs nous poussent à l’action immédiate, un discours dominant, porté jusqu’aux politiques publiques et dans un certain nombre de médias, conduit à faire accepter une posture pseudo-modérée, raisonnable, immobile, plaçant tout imaginaire politique différent comme une radicalité dangereuse et violente. La dissolution des Soulèvements de la terre, entre autres signes, montre que cette dynamique est partie pour prospérer. Or, ce discours, puisqu’il est contre les faits, est contraint de se réfugier dans des torsions rhétoriques hallucinantes qu’il s’agit de renvoyer à ses propres contradictions tout en le dépassant, en proposant autre chose, en lui faisant une place dans le poème. La volonté d’épuiser les images, de « tirer le petit fil des nuages », c’est une volonté de comprendre la mécanique même de ce sentiment de colère qui nous habite tous et toutes, et surtout de laisser la place à une autre forme de langage, plus radicale, justement, plus totale. La seconde chose tient à la reprise d’une esthétique que je trouve imparable, très bien théorisée par Rabelais dans le prologue de Gargantua, c’est la vertu du rire comme arme. La seule réponse possible à l’absurde, c’est l’absurde : et c’est justement par le rire que l’on crève quelque chose, aussi bien que l’on parvient à proposer une idée non pas brute, mais à s’approprier, que l’on invite à piocher dans les sens, les images, pour à son tour avoir les moyens de dénoncer, ou de créer, un discours personnel et collectif. En cela, il me semble que la poésie est la seule à pouvoir véritablement agir.
Crédit photo : (c) Raphaëlle PASSOT

















