Décidément le dernier Aragon n’en finit pas de nous surprendre et de nous rappeler combien il reste à découvrir. Olivier Barbarant ne s’y trompe pas qui titre sa préface au Voyage de Hollande et autres poèmes, si beau recueil réédité par les éditions Seghers à la fin du printemps, « un éternel partir ».
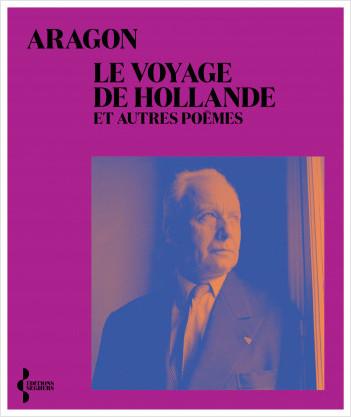
Cet « éternel partir » d’Aragon nous rappelle la persistance heureuse de son vers, que demeurent des contrées inexplorées, ni tout à fait les mêmes ni tout à fait autres. Revenir à Aragon qui ne cesse de ne plus partir – malgré les Adieux – c’est rendre inépuisable l’entêtement du poème, la vivacité et la créativité du poète.
Rendre inépuisable l’adieu, aussi. Car demeure l’inachèvement perpétuel de la poésie aragonienne, inachèvement dont on ne saurait se lasser et que le poète lui-même semble énoncer dans une « caresse inachevée » comme dans un profond sentiment de vanité qui ouvre le recueil dans ce beau vers de Maurice Scève « Le vain travail de voir divers païs ». Vanité sans ecclésiaste pourtant car si voguer d’une herbe qui n’est jamais plus verte ailleurs nous ramène au pays de soi c’est que l’amour répond encore au drame de vivre. Et s’il emprunte à Scève le vers d’une vanité de l’ailleurs sans doute lui emprunte-t-il aussi un geste élogieux proche de la Délie, dans l’élaboration d’une puissante parole amoureuse qui ne cesse d’emprunter à l’outre-raison la pluralité du lyrisme. A mille lieux de toute misologie, Aragon sait mieux que personne retourner la possible inanité du langage à signifier pour arrimer à la plus juste des langues.
« Je tiens avec les mains des propos de dément
Et faute d’à l’amour inventer son langage
Je dérobe leurs mots à d’autres sentiments »
Monument de l’amour, Elsa demeure cet objet de haute vertu, cet objet de l’amour toujours insatisfait parce que le poète croit ne jamais parvenir à en dire la plus juste teneur dans cette permanente scène d’une parole qui se cherchant révèle combien elle est là.
« La pauvre rime qu’est carmin
Pour décrire ta bouche »
Car encore,
« Ce que je dis de toi n’est au plus qu’une approche », délicate et précieuse, d’une approche qui, à la rime avec « cloches », signale tantôt la célébration tantôt le glas de ce temps qui passe et nous portera jusqu’au deuil des Chambres. Mais Elsa n’est pas encore sur le point de mourir ici, qui accompagne le poète dans un périple hollandais. Persiste encore le trouble du cœur qui aime : « Rien n’a calmé ces mains que j’ai de te connaître » dans une éternité de la parole poétique. Elsa qui, dans ce retour, parfois, à une tradition de la lyrique courtoise, devient la dame qui blesse malgré elle, quand la fin’amor prolonge l’amour idolâtre dans la persévérance d’un poète amoureux, « Elsa malheur sur moi je sais que tu m’oublies ».
Là où, comme le précise Olivier Barbarant, le lecteur rencontre un poète
« blessé par sa demande d’amour, et qui attend de ses déferlements de langue un accès au cœur de son propre volcan ».
Le chant alors, de la « messe pour Elsa » aux traversées des Enfers du poète orphique, ne cessera de dire combien il faut conjurer le sort et se regarder dans les yeux du verbe aimer. Car il ne faut cesser de lire aussi chez Aragon ces cercles de l’histoire de la poésie dont il continue d’être un maître virtuose, qu’il intègre, retourne, renouvelle.
« Peu à peu tu te fais silence
Mais pas assez vite pourtant
Pour ne sentir ta dissemblance
Et sur le toi-même d’antan
Tomber la poussière du temps »
De ce silence lent comme l’espérance est violente qui trouble l’alexandrin d’un décasyllabe égrainant les poussières de l’histoire, ces mouvements du vers qui témoignent aussi, comme le rappelle Olivier Barbarant, de cette « cadence qui veut compter avec les incertitudes du monde. »
« A quoi pensent donc les fantômes des tambours quand ils me toisent
Et la petite brume des calculs de craie à l’aube ardoise
Je parle d’un pays qui tousse et des escaliers qu’on y monte
Je parle d’une valise oubliée à midi sur un banc
Je parle de l’inutilité d’être et de ce pain dont je m’étrangle »
Je parle de cette gorge serrée et de ce nœud où se dénoue la parole poétique comme un geste qui dit la « lumière d’aimer » dans le brasier de l’Histoire.
« Ah la toux atroce qui fait geindre la nuit les cheminées
Cette vie aura passé sur nous dans un vol noir de macreuses
Nous laissant nus et déchirés comme noyés aux roches creuses
Mais ensemble et c’est pour cela qu’à ce monde nous sommes nés »
Là où porte la voix et cherche à se placer la mesure immense du poème. Comme l’indique la préface :
« Aux confins de la ligne d’horizon, dans ce fond des marines et scènes portuaires flamandes où la lumière dissout toute chose, ce qui ne cesse de scintiller tout au long du poème, c’est l’essentiel du lyrisme aragonien de la dernière période : la revendication de l’amour contre les blessures de l’Histoire, mais aussi l’effroi de constater sa fragilité devant l’imminence de la mort. »
Alors le voyage, odyssée du verbe, catabase pour poète, se situe au seuil d’un temps qui n’invente rien et alors invente tout, parce qu’il affirme la fulgurance du temps compris et du pouvoir du poème à le conjuguer, vertige du soi dans l’éternelle présence d’Aragon. Alors le voyage, qui ouvre à nouveau le temps d’aimer et s’intermine, car c’est là l’inachèvement d’une parole qui trouve toujours à énoncer le chant d’aimer et à se perpétuer dans une émotion sensible qu’est cette crainte de ne pas y parvenir. L’ajout des « autres poèmes » va dans ce sens d’une déploiement du voyage au-delà même de la chronologie du déplacement.
« Nous appellerons Hollande
Ce pays de contrebande
Entre la pluie et le vent
Comme un moment de césure
Dans la voix et la mesure
Entre l’après et l’avant »
Nous appelons poésie ce territoire du verbe entre l’Histoire et soi-même comme le brasier du dit qui de la bouche à la gerbe a reconnu ce qui sème //
« Montre ta bouche pâle où me renaît l’enfance
Et que je sois ton lit lorsqu’il t’ouvre ses draps
Et sois cette couleur où tu t’endormiras
Et mon âme ton souffle et mon corps ton silence
Pour enfermer tes yeux dans la nuit de mes bras »
Nous appelons poésie la justesse toujours en mouvement du vers d’Aragon, et son pouvoir à ne jamais s’achever dans la pluralité vivante et vibrante de l’oeuvre à venir.
- Olivier Barabant, Le voyage de Hollande ( et autres poèmes), Poésie Seghers, 2023

















