Deuxième temps de l’entretien avec Patrick Autréaux qui, à partir de ses récentes parutions, chez Verdier et aux éditions du Chemin de fer, revient sur la place de l’écrivain à l’égard de littérature et du langage et tisse les liens de son propre rapport à l’écriture.
Rodolphe Perez : Après tout, ce renoncement à la définition est aussi le constat de la liberté la plus grande, départie de ce qui coince, de ce qui résiste, pour ramener à soi le geste de résistance justement. Cela s’institue finalement en seuil où « ça ne cesse de se défaire et refaire », comme lors de la scène new-yorkaise du premier volume du Constat. On sent dans la construction de votre écriture cette démarche de circulation, dans cette volonté d’épuiser les sujets – ce que vous ne faites évidemment pas, l’écriture n’épuise rien, mais vous faites le tour de la question. Il me semble que vous écrivez par cycle. Il y a eu la maladie, le soin et politique et médical, désormais la famille, avec des thématiques tout aussi spiralaires dans la mesure où elles dépassent l’individualité des textes. Et puis ces récits-bascules, dont le dernier roman, Pussyboy. La spirale est aussi une manière de rompre la « déliaison », en biaisant, car c’est une expérience de la « déliaison » qui ne se solde pas par une fusion. Toujours dans l’article consacré à Camon : vous parlez de ce dernier comme d’un « écrivain peu soluble », que vous définissez aussi, plus loin, comme une « réaction contre la forme ambiante », contre le « cela-va-de-soi », appliqué ici à un milieu, qu’évoquait Barthes. En quoi, vous, vous seriez aussi un « écrivain peu soluble » ? En quoi l’expérience de l’écriture est-elle, pour vous, une expérience du « non soluble » précisément ?
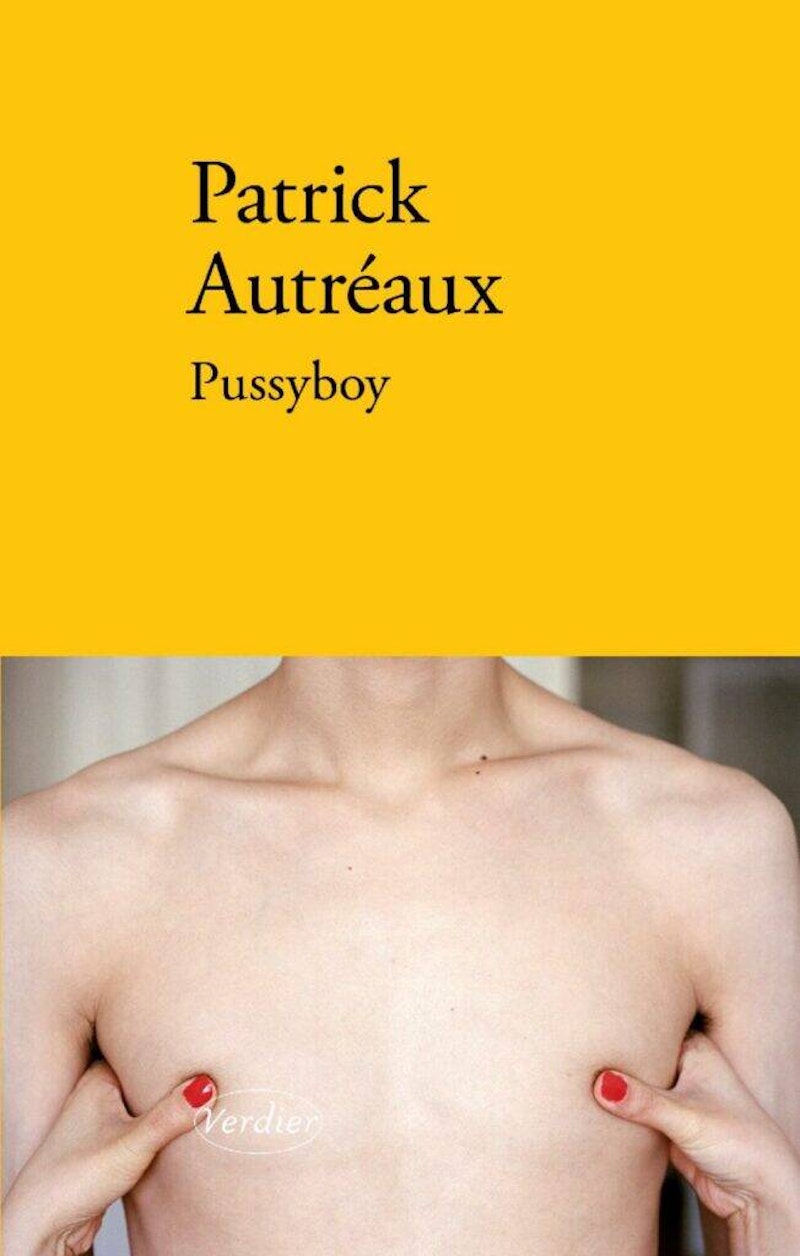
Patrick-Autréaux : On n’y voit rien si on ne passe qu’une fois. Le détail du souvenir, comme celui de la peinture (ou du rêve) qui ouvre à des perspectives inattendues, c’est la leçon de Daniel Arasse et a fortiori des psychanalystes. J’ai intégré cette école-là, celle de la pinaille aussi, du « ce n’est pas tout à fait ça » qui empêche toute réponse définitive à ce qu’est une écriture. Récit à bascule : j’aime votre expression. Je parle volontiers de récit souche. Ce fut le cas avec Dans la vallée des larmes, je crois. Et je peux dire désormais que c’est le cas de celui-ci (peut-être aussi Pussyboy, même si je n’ai pas encore pleinement exploré les voies que m’ont ouvertes ce récit). J’ai toujours comparé mon travail aux mues d’un insecte qui grandit, change, trouve une forme pour là où il en est. Et les livres seraient des exuvies (mot latin qui renvoie aux dépouilles : les morts encore donc !) Mais les mues sont issues finalement d’un même corps, sans cesse différent : notre corps et notre esprit sont ainsi, même et changeant. Sans doute est-ce ce qui me permet ou plutôt m’impose, par logique, de biaiser et contrer la déliaison : puisque le réel est dans le lien, dans la causalité multiple, dans la nuance, dans l’interdépendance.
J’aime beaucoup ce « non soluble. » Pour la résistance qu’il suggère, pour la permanence de la question qui le sous-tend. Si je me sens moi peu soluble, voire non soluble ? Ce sont les autres qui peuvent répondre, j’ai du mal à être impartial ! Pourtant je sens que j’écris à partir de ce qui vibre, cloche, à partir de ce qui rend un son fêlé en réaction à des événements intimes ou collectifs. Je l’ai explicité dans un article sur le confinement au début de l’épidémie covid (paru dans la revue Comment faire ? Éditions du Seuil). Or je crois que cette réaction est une résonance et ce qui dissone à la fois. Ma « résistance » n’est pas une résistance de tête ou une volonté, elle est viscérale toujours. Je me cabre ou ne dis pas oui, parce que je sens monter quelque chose d’irrépressible qui me pousse à opposer un « ce n’est pas tout à fait ça » ; parce que je suis mon intuition et cherche toujours à discerner ce qui me semble juste. C’est vrai pour l’écriture de mes livres ou articles sur des artistes ou auteurs, mais aussi pour les circonstances politiques où j’ai pris position.
J’ai été élevé par un vieil homme qui était un résistant et un vrai Juste, même s’il n’en a jamais eu le titre. Ça marque. Ferdinando Camon avait été le témoin des exactions nazies, quand il était enfant ; il a lui aussi développé un sens aigu de la résistance. Et la question du milieu social, de l’exil de classe, est fondamentale évidemment. Camon témoigne de cela tardivement dans sa carrière : la mise au pinacle actuel de certains transfuges, au contraire de ce que chantent les gens de pouvoir, n’est jamais le garant d’une ouverture pour ceux qui ne deviennent justement pas l’exception, ceux qui confirment la règle – et la règle en l’occurrence est celle du plafond de verre pour les exilés de classe. C’est ce que rappelle avec véhémence Camon. Son sentiment d’exclusion est un signe de résistance involontaire, qui devient peu à peu conscientisée, qui se revendique telle. C’est ce que je sens à l’œuvre pour moi. Et puis il y a, plus spécifiquement, ce que fait l’écriture à celui qui s’empare d’elle. Cela reste un sujet de réflexion, je songe à un livre qui devrait poursuivre cette interrogation, aussi n’ai-je pas de réponse à vous donner. Sinon qu’écrire conduit – c’est l’expérience que je fais – à me distancer du bruit, à me placer sur un bord (encore un !) mais aussi à regarder et à m’indigner, à critiquer, à n’être pas d’accord. Et, pour reprendre ma conclusion à cet article sur Camon : écrire, c’est rompre les amarres de la docilité.
L’ennui, c’est qu’avec la résistance grandit le sentiment de notre, de mon impuissance. Est-ce un sain paradoxe ? Peut-être n’est-ce que les deux côtés d’une même pièce ? Car plus je sens mon impuissance (qu’elle soit esthétique ou politique), plus je biaise, plus j’insiste : cela prend la forme du cycle, c’est-à-dire de la spirale que j’ai l’impression de visser dans le réel pour le comprendre sur le plus de couches possible. J’ajouterai que cette figure implique un imaginaire temporel non linéaire, et résiste donc par une approche du temps qui s’oppose au flux et à l’accélération. Mais c’est un autre sujet.
Rodolphe Perez : De cette résistance – sur le plan esthétique et non pas politique, parce que votre parole politique affirme en conscience et volonté – il faut dire, oui, qu’elle n’est pas un geste volontariste de refus mais qu’elle est plutôt le ressort d’une singularité qui n’est pas happée, et sans doute est-ce là un geste de résistance plus efficace en ce qu’il ne se pense pas contre et donc s’impose comme saillant traçant sa voie, son sillon, même par le biais (surtout par le biais), qui n’est en réalité qu’une autre voie, donc avec sa propre légitimité. Plus efficace en ce qu’il n’est pas une revendication qui, par ricochet, confirme la place de ce qui s’oppose, en face. Vous parlez d’une forme d’impuissance mais l’impuissance existe-t-elle ? N’est-ce pas plutôt la capacité à provoquer la ramification pour connaître la pluralité de sa propre voix, maillage du contre, qui est à la fois la résistance et la proximité ? Il me semble que vous faites plutôt cela.
Patrick-Autréaux : Oui vous avez raison, on pourrait distinguer deux paroles en effet. L’une explicitement politique (texte sur l’après Charlie Hebdo, sur les Gilets jaunes, sur l’après confinement) mais qui vise une temporalité assez immédiate. Et puis il y a l’engagement littéraire et la résistance qu’elle suppose dans ce monde dominé par l’industrie du livre, par l’entreprenariat culturel, par le conformisme médiatique qu’implique la logique notoriété-argent. Cela on ne peut le réaliser seul. J’ai eu la chance de rencontrer les éditions Verdier et leur sais gré de leur soutien qui permet de rendre concrète cette résistance de la singularité que vous évoquez. Ce mot de singularité est ambigu, il est devenu courant, un peu trop, et remplace l’originalité sans doute d’antan, mais il est aussi le point visé, entre foi et science-fiction, par les dirigeants de la Silicon Valley pour décrire ce moment d’autonomie du monde numérique. La singularité laisse aussi entendre la distinction d’un individu (et en ce sens peut devenir le signe d’une appartenance sociale). Or le développement de mon travail, qu’on qualifie souvent de singulier dans le champ français, n’a pu se faire harmonieusement jusqu’ici que parce que j’ai eu un éditeur attentif. Il est vrai que je ne pense pas la résistance en un geste contre, mais bien en suivant le fil d’un auto-engendrement (avec les bémols que suscite ce genre de vocable) contre la réalité sociologique de mon milieu… Mais de quelle impuissance parle-t-on ? Sans doute ai-je été imprécis en vous répondant plus tôt. Le sentiment d’impuissance est métissé. L’individu qui écrit ne cesse d’être citoyen, et il constate l’infime poids qu’il a pour agir (et au minimum témoigner) sur certains problèmes de son temps. Cela m’assombrit, car j’ai appris de la médecine que, si l’on n’a pas obligation de résultat, on a obligation de moyens dès qu’on a conscience d’un problème nocif. Quand je deviens une personne publique qui prend la parole, je ne peux m’ôter de la tête cette règle et cela m’a causé bien des désillusions. Pour le travail littéraire lui-même, c’est différent, j’aurais plutôt l’attitude du chercheur que du praticien, celle du curieux et de l’explorateur, même dans une démarche autobiographique. En cet endroit-là je deviens dès lors, comme dit Agamben, puissant de ne rien faire parfois : en cherchant dans l’écriture, je découvre des réservoirs potentiels. J’en ai pris conscience après mes deux premiers livres, je sentais que j’avais ouvert une veine qui donnait une matière intime dont je ne soupçonnais pas qu’elle prendrait cette forme ; ce cycle s’est clos avec La Voix écrite. Après deux livres intermédiaires ou préparatoires peut-être (Quand la parole attend la nuit et Pussyboy), j’ai retrouvé de nouveau une urgence avec Constat, ou disons le renouveau de mes débuts. J’ai parlé des mues qu’ont été mes précédents livres. Ici s’y est associé un autre type de travail, je crois, plus exhaustif de la matière autobiographique et plus intégratif. Comme ce cycle n’a pas été engendré par une urgence vitale, comme il est moins clairement sous-tendu par la confrontation à la mort, je crois que ma position singulière est devenue une manière de tendre des antennes non seulement vers ce qui m’entoure et m’aide à exprimer des aspects sinon inconnus du moins négligés de moi, mais aussi vers mon propre passé pour relire des situations dans lesquelles j’ai été plongé. Toutefois, l’écriture autobiographique n’est pas une manière de me dire mais de dire une interface. Je me suis toujours vu comme un oscilloscope. Pour le formuler autrement, un écrivain est forcément de son temps. Je suis porté vers ce qui tique et que souvent l’on ne voit pas autour de moi, ou ne sent pas aussi vivement. Je ne parle pas d’une quelconque tendance visionnaire, ce serait pompeux et ridicule. Et même si j’ai beaucoup fantasmé la figure de Cassandre quand j’étais adolescent, je ne suis pas une chamane inspirée par Apollon ! Mais je reste un clinicien dans l’âme, qui procède par avancée lente, par élargissement successif, si l’on veut. Je développe mes antennes à mesure que j’écris – je le crois du moins. Et cela dans le domaine thématique limité où je déploie mes livres. Pourtant je crois que cela agit sur qui me lit. Si l’effet se prolonge au-delà de leur vie intime, je l’ignore. Même quand on croit représenter beaucoup de gens, je ne suis pas sûr qu’on agisse collectivement – surtout dans un monde si rapide. Et puis un livre ne suffit pas, il faut le moment. Mais je ne puis empêcher en moi que ne se réveille l’homme qui désire changer la vie, et d’abord en prolongeant les livres et auteurs qui l’ont secouru quelquefois. Quant à une place dans la littérature contemporaine, dans l’esthétique, je ne puis en être juge et, sans ignorer que cela plane parfois dans mon esprit, je sais qu’y penser ne peut que gêner mon écriture à venir. Avec l’idée d’une place ou d’un rôle, survient un risque certain de posture : la spirale s’interrompt et on tourne en rond. Quelques contemporains estimables et très honorés en sont des exemples.
Rodolphe Perez : Vous actez une défiance à l’égard du discours en ce qu’il serait surtout une sclérose du signifié, un détournement du signifiant. Au croisement d’un scepticisme janséniste et nietzschéen, deux voies qui donnent lieu à des monuments de la littérature. Et c’est précisément sur la scène sociale qu’apparaît la duperie du discursif, quand il s’institue en simulacre. Ne sont-ce pas là deux perspectives qui se rencontrent chez vous, où la question du divin n’est jamais celle d’une croyance ferme mais toujours au seuil d’un désir ? Ni tout à fait janséniste, ni tout à fait nietzschéen.
Patrick-Autréaux : Écrire, c’est habiter le langage. L’éprouver du moins au point de s’y sentir incorporé. C’est surtout se situer là où on tisse le lien entre ce qui est encore expérience du corps et expérience mentale. En écrivant je me sens souvent sur un bord de moi et le regard du dedans tendu vers ce qui serait presque l’abîme. C’est ainsi que je me vois écrivant. Le jansénisme a-t-il déteint sur moi ? J’ai tété la mamelle de Port-Royal, sans le savoir, comme beaucoup d’entre nous qui parcourons la littérature du Grand Siècle, et puis par fascination pour Pascal, même si le Pascal qui m’est familier est celui des Pensées, qui effraie un peu Port-Royal. Il y avait dans ce goût pour le jansénisme un désir de distinction : j’étais un enfant de prolo qui prenait pour modèle une littérature de l’élite aristocratique ; et puis, j’avais une attirance pour le calvinisme, pour son exigence, même si la théologie de ces deux courants m’inquiétait avec leur idée de prédestination. Le lien au jansénisme est donc mêlé de goût classique (pour Saint-Simon également) et de préoccupation métaphysique. Cela c’est un aspect de ma jeunesse. Nietzsche était là aussi dans ce paysage. Pour nous qui vivons aujourd’hui, il est forcément présent : il place devant l’abîme (et un certain iconoclasme de la raison) que découvre également pour nous Pascal. Puis la psychanalyse a fait irruption dans mon cheminement. Je ne suis ni un théoricien ni un philosophe, mais depuis ma jeunesse j’ai autant appris que désappris. Nietzschéen en cela, j’ai toujours cherché à ne pas être enfermé dans des croyances, religieuses ou scientifiques. C’est-à-dire que je sais mon besoin de croire et me méfie de tout ce qui peu à peu se constitue en système apaisant de pensée. Jouer d’une discipline contre une autre (allant des sciences dures aux sciences humaines et inversement) m’a été fort utile pour demeurer inquiet. La perspective d’écrire et de constituer une œuvre, l’apaisement un peu illusoire que cela m’a un temps procuré, auront été ma dernière importante croyance en date. Elle s’est fracassée, ainsi que je l’évoque dans La Sainte de ma famille. Tant mieux ! C’est que dès qu’on est au chaud dans un système, fût-il hors de toute transcendance, on ne suit plus l’exigence, qui fut celle de Nietzsche et Pascal, et que clame Zarathoustra : écrire ne se peut vraiment qu’avec son sang.
Rodolphe Perez : Pour en revenir à la question de la singularité, je vous rejoins : aucune trace chez vous d’une soif égotiste du type que vous évoquez, mais parce que chez vous l’écriture – et l’écrivain ! – ni ne sert la capitalisation, ni la spéculation, aux sens volontairement pluriels des termes. Elle vise, pour l’écriture, la maison commune, et le dépassement de l’incidence de l’histoire. Parce qu’elle œuvre au territoire du commun, l’écriture ne vise pas la destruction (le soin ici cherche sinon à construire et restaurer, du moins à préserver) et vous ne pensez pas « la résistance en un geste contre ». Si le contre est chez vous plutôt la proximité que la négation, « l’interface » est toujours une porte ouverte où le personnel s’ouvre au commun.
Patrick-Autréaux : Ce que vous dites est très pertinent. Sans doute est-ce aussi né d’un profond et violent besoin : après avoir été malade, j’ai été obsédé par l’idée d’écrire un livre qui apporterait un peu de ce que certains livres m’avaient apporté quand j’étais incertain de guérir. Écrire, ou dirait Cézanne, peindre un tableau qu’on pourrait sans honte accrocher dans la cellule d’un condamné à mort. Mon besoin de commun vient de ma connaissance intime de la douleur et de ce qui en a surgi : rencontrer une main amie, alors que toute assurance se retire et nous livre à la solitude ontologique. Cela concerne, je crois, tous ceux qui traversent une catastrophe, intime ou collective, deuil ou passion, maladie ou viol. Je sais, pour reprendre votre précédente question, que mon lien au Je a été le fil de mon travail depuis ses débuts. Très tôt, sentant l’omniprésence du narcissisme, et né dans un temps qui valorisait l’autofiction, j’ai voulu affronter ce Je : non en lui tournant le dos, mais comme les mystiques, en l’érodant. Je croyais faire cela en écrivant, c’est la vie qui s’est chargée de me rendre perméable, comme disait Max Jacob. Ce qui m’importait dans ce Je, c’était sa porosité, son impersonnalité – ou du moins de tendre vers cela. Je crois que c’est cette recherche même qui me rend résistant, singulier si l’on veut. Sans doute est-ce ce qui me fait penser et écrire à partir de ce lieu-là d’observation. Un bon exemple serait l’ensemble des articles que j’ai écrits ces dernières années. Ce sont des traces de mon cheminement. Écrire sur Genet plusieurs fois, sur Camon, Belloc, Delbo, Yacine, Le Brun, Giono, Lispector ou Pascal, comme je l’avais fait sur des artistes avant cela, c’est une façon de dessiner non un autoportrait mais une déprise permanente et recommencée de mon lieu d’observation, c’est aller vers soi par les autres et, au-delà des autres et de moi, vers ce qui survient de l’inconnu. Pour reprendre l’image de Saint-John Perse, je tends quasi érotiquement vers cette frontière où, disait-il dans son discours de Nobel, « on entendra courir encore la meute chasseresse du poète. »
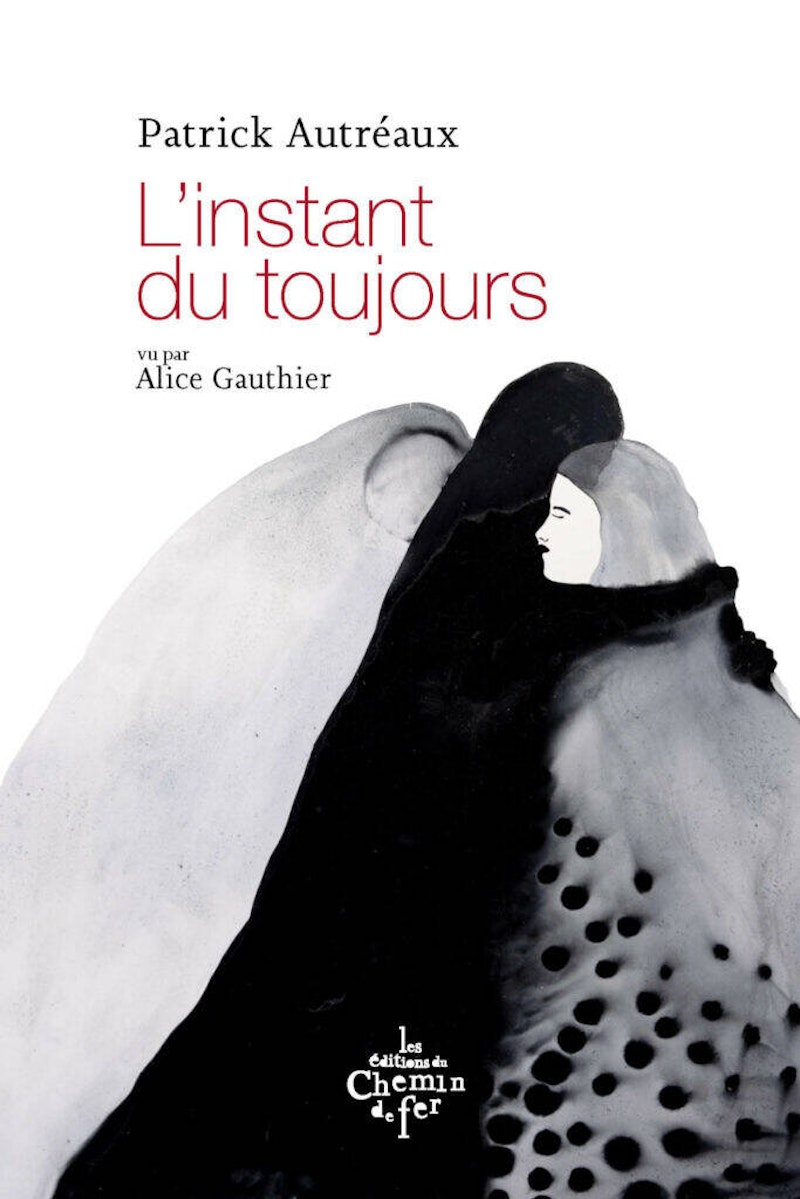
Rodolphe Perez : Vous dites habiter le langage, que vous définissez comme « s’y sentir incorporé », alors qu’on aurait plutôt songé à l’image inverse, celle d’une digestion du langage par l’auteur, la voie de la voracité a ses lois… ! Habitant (par) le langage, y étant incorporé, vous trouvez là comme une manière d’être au monde par le semblable et le collectif, ce fameux lien que vous travaillez, pierre à l’édifice, mot à la phrase de l’Histoire. C’est en ce sens aussi que l’écriture apparaît comme le décentrement et le dépassement. De Nietzsche donc vous emprunteriez la voie historicisante (un peu des jansénistes aussi donc) d’un retour à la compréhension de l’histoire pour saisir comment s’y incorporer, car comprendre c’est aussi être pris dans. Façon de renverser l’hypothèse calviniste, refus de la prédestination mais mise au jour d’une conscience historique du moi dans le monde, du multiple. Vos textes semblent aller dans ce sens, peut-être est-ce là un reste de la démarche médicale, qui tisse un système (non pas apaisant) de l’accident, comme l’expérience du chagrin mise en perspective dans L’Instant du toujours, par exemple. Car comprendre c’est aussi refuser de nier l’obscurité et la faille. Ce n’est pas objectiver pour penser en bon capitaliste le protocole de l’émotion ou de la scène mais plutôt faire émerger l’universel et le commun de l’accident, c’est plutôt ramener, contre la tentation croissante de l’individualisme, à la possibilité d’une parole commune. Il en va de même, oui, de ces essais qui n’en sont pas, qui sont aussi la digestion d’une parole du multiple pour poursuivre les ramifications.
Patrick-Autréaux : Habiter, est-ce que ce serait avoir trouvé une place ? Ou bien admettre que les mots n’ont qu’un sens provisoire ? Je vois moins en moi le mangeur qui digère, comme vous dites, qu’un sécréteur de cocon. Je me vois moins avalant que surnageant et rafistolant mon radeau. Et ainsi me co-créant et survivant avec ce que j’écris. Je me crois profondément enfant de mes livres. Ma pensée ne prend forme vraiment que par l’écriture. Sans elle, je suis moindre ; sans elle, je me sens grignoté et diminué par le langage affadi et dédensifié dont je me protège beaucoup. Écrire est une réaction – contre l’inexactitude, contre l’imprécision, contre la fermeture rationalisante, contre la folie irrationnelle. Écrire, c’est habiter la brèche, sur les rives de laquelle on prend pied, et en même temps tremper l’esprit dans le vertige. C’est ainsi que mes livres se sont tous écrits, s’engendrant l’un l’autre, et c’est pourquoi ils sont des mues d’un être qui devient. Écrire pour devenir. Chaque livre me coûte, et ce n’est pas une posture de dire cela. Dès que je soupçonne la présence mentale de mon livre, quand je sens son existence possible, je sais ce qu’il va falloir pour arriver à l’écrire. Oh non, il va falloir passer par tout ça ! C’est ce que je me dis chaque fois. « Tout ça », ce sont les mois et parfois années, en tout cas un temps incertain ; ce sont les nuits mauvaises et l’humeur maussade, les voix dénigrantes qui harcèlent, une bataille interne contre l’autodépréciation assez constante. Malgré tout, il faut sortir de soi ce qui exige d’être écrit. Le sortir à gros traits, puis le reprendre, le faire grandir et ensuite retravailler, réécrire, affiner, polir, tout en même temps, faire saillir des lignes directrices et respecter celles secondaires, faire émerger des thèmes qui étaient dissimulés ou trop discrets. Bref, cela demande de croire, après un bref moment d’ivresse, croire sans avoir de certitude, croire en travaillant sans se dire qu’on croit, juste tenir bon. Écrire n’est pas un geste joyeux pour moi, même si cela me fait quelquefois jubiler et souvent me rend heureux. Et vers où cela conduit-il ? Je ne sais pas si c’est une parole commune, mais ce que m’ont enseigné les urgences psychiatriques, et donc tant de personnes me racontant leur intimité, c’est que parler de soi – réussir à le faire – devant quelqu’un qu’on ne connaît pas, c’est le pari d’un commun possible. Il n’y a pas de livre sans cela. Vous évoquez l’individualisme, celui de masse, mais la parole de l’individu qui sait qu’au fond de lui frémit un intime commun possible, et que parler de soi c’est parler de toi ou de lui, voilà ce en quoi je crois encore. Et plus : je crois que c’est performatif, que cela peut changer la vie. Bien sûr c’est un jeu subtil, qui ne peut se faire sans un travail sur le retrait paradoxal de soi quand on s’écrit : c’est un travail que faisaient les anciens et les mystiques. Et c’est très antithétique d’un monde qui noie les discours de soi dans le miroir aux alouettes de l’ego.
Pour revenir à votre mot de digestion, l’artiste conceptuel Hubert Duprat offre une assez belle métaphore de ce que je sens à l’œuvre dans mon processus de travail. Duprat a notamment utilisé la mue de phryganes. Ces insectes aquatiques au stade larvaire s’entourent d’un fourreau mobile, constitué de brindilles, résidus végétaux, petits cailloux, ce qu’ils trouvent à leur proximité pour constituer une coque où mûrir et se transformer. Élevant ces petites ouvrières, leur fournissant fil d’or, perles et pierres précieuses, Duprat fait de ces insectes des orfèvres, qui sans le savoir font des bijoux qu’elles abandonnent pour mener leur vie adulte aérienne.Est-ce qu’un artiste n’est pas (en partie du moins puisque l’artiste est aussi celui qui conçoit le dispositif et assemble ses propres mues en un récit) cette larve qui s’entoure de ce que son milieu met à sa disposition, débris et aliments, dont il s’entoure et se nourrit pour sa propre métamorphose ? La comparaison de ce travail avec l’activité artistique me séduit, même si je ne crois pas qu’un corps achevé puisse être atteint en art. L’œuvre se construirait comme une longue étape d’un processus qui se poursuit dans le secret – après l’art. Et c’est pourquoi peut-être je n’inféoderais pas, pour reprendre un débat scolaire, la vie à l’art. La lecture fait partie de la vie jusqu’au bout. L’écriture peut-être pas forcément. C’est aussi la lecture qui m’inscrit dans l’histoire. Si je devais chercher un espace commun aux auteurs sur qui j’ai écrit (loin du nombre de ceux qui ont compté), ce serait en moi que je le retrouve : j’ai toujours été du côté des intransigeants, de ceux qui écrivent avec leur sang (c’est une antienne !). Et si j’en admire de nombreux types, je donne la couronne à ceux qui ébranlent sans concession ; qui, au bord du vertige devant ce trou qu’engendre la lucidité, savent rester aussi peu monnayables que définitivement hors de prise (Annie Le Brun, Ailleurs et autrement). En ce sens, écrire implique pour moi de rejoindre un positionnement politique proche des anarchistes. N’admettant ni dieu ni maître, si l’on veut, et aucune autre autorité que mon intuition, je m’attends toujours à être délogé de ce que j’ai écrit par ce que j’écris (et lis pour écrire), et à reprendre une route vers une autre maison. Je ne me sens bien qu’en compagnie des exilés – qu’ils soient de classe ou de pays –, en accord profond qu’avec les déplacés.
Rodolphe Perez : Vous opposez la possibilité d’habiter comme fait d’avoir trouvé une place – vous dites une, et non pas sa – et l’aveu que les mots n’aient un sens que provisoire, mais est-ce bien la une dichotomie ? Car si l’on acte que les mots ne demeurent signifiants que provisoirement – en ce qu’ils s’actualisent en différance – la place, une place possible, ne peut être que sans cesse rejouée. Au mieux positivement parce que nous évoluons, au moins négativement en ce que nous sommes agis de forces extérieures et de contingences historiques et culturelles. Votre pensée, oui, se fait jour dans l’actualisation en mouvement qu’en donne l’écriture, elle dit, à l’endroit d’un seuil comme d’un boitement, l’horizon incertain mais possible. Sans ne rien achever. Elle signale qu’il existe toutefois. Mais c’est là je crois un distinguo a minima entre une écriture qui dépasserait l’affirmation d’une place pour lui préférer la manifestation d’une pluralité, qui de fait affirme l’incertitude d’une définition de la place pour son indéfinition, et une écriture qui gloserait et spéculerait sur l’affirmation totalitaire et fermée. On en revient alors à cette opposition entre un « intime commun possible », que vous évoquez, et « l’individualisme, celui de masse », qui a ceci de vicieux qu’il n’est pas l’avènement d’une parole singulière au profit de l’arrière-pays du commun mais bien le tapage clos du moi-masse.
Patrick-Autréaux : Todo cambia, chante Mercedes Sosa. Tout se transforme, dit un autre. Pas de dichotomie en effet. Seulement, peut-être n’est-ce pas au même niveau qu’on se situe. Et disons que le temporaire a aussi une temporalité qui varie. Mais si l’on pense à la place des œuvres ou des livres, alors comment parler d’une quelconque place, si on ne la rend pas indéfinie. Je ne crois pas à la préexistence d’une place possible, comme je ne crois pas à la préexistence des œuvres, des livres. Ça me semble évident. Il traîne toujours un je ne sais quoi de prédétermination dans l’idée d’art pour certains. Une sorte d’ontologie a posteriori, un reste de platonisme. Proust le suggère : écrire, écrire vraiment, c’est parler une langue étrangère que personne encore ne parle (et sans doute ne pourra plus jamais parler, les grandes œuvres étant sans descendants, tout en nous fécondant – elles sont fondamentalement queer !). Tout se crée à mesure. Je crois volontiers au processus, pas à un essentialisme des œuvres ou des livres, ni des êtres d’ailleurs. Encore une fois, ça semble évident. Tout ce qui affirme (ou laisse croire) le contraire est ce qui tient à légitimer un ordre préexistant, quel qu’il soit, ou disons à contrer son provisoire. L’horizon est ce qu’on crée, aussi est-il déterminant de se battre pour un minimum commun, pour le recréer sans cesse, en rendre les conditions possibles. Je ne crois qu’aux singuliers mais émanant d’un (ou plusieurs) arrière-pays du commun (j’écris sur le fond de tout un pan de la littérature, et ne serai pas sans elle ce que je suis devenu). Est aussi évidente l’idée d’une co-dépendance. On parle souvent de paysage littéraire, or la dynamique qu’on peut retrouver à la base de la création d’un paysage a ses règles mais n’est pas préétablie. On ne peut respirer que dans une vision du monde qui offre encore de l’échappée, de l’inconnu. Si je sens le besoin de devoir préciser de telles évidences, c’est parce que quelque chose de notre temps, et de celui qui vient, tente de verrouiller cette liberté-là.
Rodolphe Perez : Vous parlez alors de ce déplacement, comme un pas de côté de ce pied du boitement qui ne se pose qu’incertainement – là où ignore encore où le pas rencontre le sol – et que temporairement. Ce déplacement, manière de marge, certes rend compliqué de vivre dans le monde sans jamais l’embrasser tout à fait, mais reconduit cette résistance. C’est encore là le propos d’Agamben sur le contemporain. D’ailleurs, en 2017, dans la postface à la parution en poche de Dans la vallée des larmes et Soigner, qui datent respectivement de 2009 et 2010, vous écrivez ceci : « Écrire, écrire sur soi en particulier, c’est tendre à retrouver l’épure qu’impose le dénuement et, en même temps, à réapproprier soi-même », pour mieux en venir à définir cette « voix écrite. » C’est ainsi la voix de soi donnée comme ce qu’elle porte du monde.
Patrick-Autréaux : Ce pas de côté est une conséquence du désir (et besoin) d’inconnu, d’ouverture à l’inconnu. Mais permettez-moi encore une incise. J’ai été très marqué par un essai, L’Origine des individus (J.-J. Kupiec, Éditions Fayard) qui tente d’unir théoriquement les processus phylogénétique (apparition des lignées d’espèces) et ontogénétique (constitution des individus). Pour Kupiec, en biologie darwinienne, tout repose sur une lecture probabiliste de l’ADN et selon les lois physico-chimiques (thermodynamique, viscosité intra-cellulaire, gravité, etc). C’est le cadre. Le hasard module donc le déterminisme relatif de la génétique (génome transmis et épigénétique). Or, cette théorie émancipe de toute unicité de la causalité biologique : je suis et ne suis pas l’enfant de mes parents (si je simplifie, et sans parler de l’environnement socio-affectif). Ce livre m’a libéré de mon milieu autant que la sociologie (c’est la beauté de l’émancipation par les sciences). Il justifie (s’il était besoin) la nécessité de l’inconnu et de vivre en faisant sans cesse des pas de côté – parce qu’au fin fond de mes cellules, c’est ainsi en partie que je me suis constitué et continue de vivre. Il m’a également permis une sorte de réappropriation en me libérant de la croyance en un déterminisme rigide. Cela semble encore évident au fond, mais l’époque a la tentation de faire peser sur nous un déterminisme biologique (renforçant celui sociologique) qui sert certains. Eh bien, ce n’est vraiment qu’avec cet état d’esprit que je peux écrire et surtout que je me sens heureux de vivre. Cette réappropriation n’est pas clôture identitaire, vous vous en doutez, mais manière de se débarrasser des entraves inévitables (ne serait-ce, dans l’écriture, que du kitsch ou des clichés ou des formes attendues) – se dénuder donc pour accueillir. C’est une démarche érotique.
Rodolphe Perez : Dans Les deux Annie, article paru récemment pour dans lundimatin, vous opposez Annie Ernaux et Annie Le Brun, notamment sur leur position dans le milieu éditorial et vous avancez vous sentir plus proche de la seconde, en ce qu’elle témoigne d’une résistance qui, revendiquée ou non, est la preuve de quelque chose d’immiscible. Il ne s’agit pas d’y critiquer Ernaux, mais plutôt de mettre en lumière un impératif de l’inassimilable. Je n’ignore pas que vous ne cherchez pas, ce faisant, à vous hisser à Le Brun – s’il nous fallait décidément ne plus se départir des horizons verticaux – mais cette lecture que vous proposez parle nécessairement de votre propre position et de votre écriture qui refuse que son « minimum commun » ne soit dissout, qu’il demeure un possible. Autrement dit, l’espace érotique, oui, où dans la dénudation surgit une irrécupérable inobjectivité (le terme est de Le Brun) est celui d’une écriture donnée en partage comme digue.
Patrick-Autréaux : J’emploierais l’image du récif plutôt que de la digue. Pour moi l’inassimilable n’est pas quelque chose qui se choisit ou construit, mais une part non érodée, en dépit de l’effort pour la comprendre ou l’écrire (ce n’est évidemment pas une obscurité par paresse ou un hermétisme choisi). C’est un reste du lieu sauvage, primitif ou non, du lieu qui nous précède : soit qu’on ne parvienne pas à analyser, soit qu’on le découvre depuis l’œil animal en nous (inobjectif essentiellement). Inassimilable ou irrécupérable, ce serait aussi l’inanalysable. J.-B. Pontalis a parlé du droit à l’inanalysable, à ce qu’on ne veut ni ne peut déflorer, tout en ayant œuvré à le défricher en soi. Sans vouloir être trop réducteur, je crois que c’est cela qui se joue dans la différence entre Ernaux et Le Brun. L’intransigeance me séduit chez chacune certes, mais chez Le Brun une place primordiale est donnée à l’ombre ou plus largement à l’imagination et au rêve, à ce qui persiste à échapper et est profondément asocial (thème assez absent de l’œuvre d’Ernaux). Plusieurs divergences profondes entre elles sont évoquées dans cet article (tradition politique, attitudes envers le pouvoir et le monde institutionnel), mais ce que j’oppose n’est peut-être pas sans analogie avec ce qui se joue entre la raison de Descartes et son dépassement chez Pascal (chez lui, la raison se découvre impuissante à épuiser quelque chose de l’homme, et cela conduit au mystère – je simplifie) ; ou entre l’optimisme des Lumières et le nocturne du Romantisme allemand, dont je sens proche. Nous n’en avons pas parlé, mais c’est par ce mouvement littéraire, Novalis surtout (avec l’initiatique Heinrich von Ofterdingen et le projet du Brouillon Général), que j’ai pris goût adolescent à la littérature. C’est l’exploration des arcanes qui reprend avec ces auteurs (avant il y a eu les Grecs, les mystiques), là où l’éros-thanatos palpite au cœur de l’homme – cet appel vers ce qui l’accomplit et le dépasse, et risque aussi de le détruire. Leur pensée fait pénétrer dans le grand cercle du savoir. Revenir à Héraclite en quelque sorte, mais avec tout ce qu’on a pensé depuis. Qu’on y parvienne ou non en écrivant n’est pas la question, mais viser cela est une ambition qui maintient la nuit en éveil !
- Patrick Autréau, La Sainte de la Famille, Verdier 12 janvier 2021
- Patrick Autréau, Pussyboy, Verdier, 19 mai 2021
- Patrick Autréau, Le grand vivant, février 2016

















