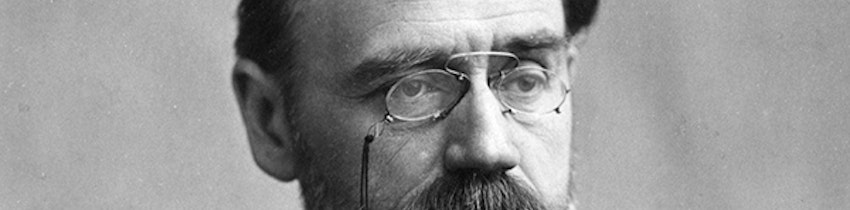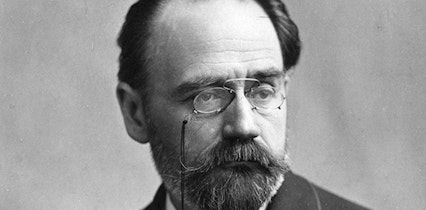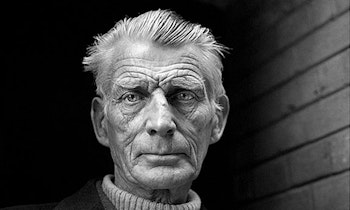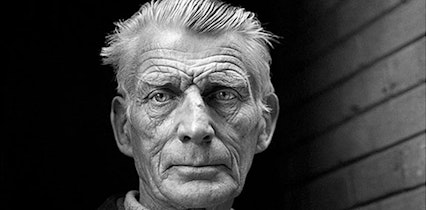En août dernier paraissait Chienne et Louve, le deuxième roman de Joffrine Donnadieu, aux éditions Gallimard. Si le lecteur averti pouvait y reconnaître la silhouette de Romy, protagoniste d’Une histoire de France, le premier roman de Joffrine Donnadieu, rien n’énonçait clairement qu’il en soit la suite. Dans Chienne et Louve, Romy, contrainte de se loger à moindre prix, trouve refuge chez Odette, une vieille dame qui vit seule dans son grand appartement de la place Gustave Toudouze. Se noue alors entre les deux femmes une relation particulière, entre affection et violence, tandis que pour payer sa formation au cours Florent, la jeune femme de vingt ans danse la nuit dans les clubs de strip-tease de Pigalle. L’intransigeance du théâtre, la danse, le corps en perpétuel mouvement sont au cœur de l’œuvre de Joffrine Donnadieu.
Rencontre avec une romancière à l’écriture en mouvement, qui n’hésite pas à faire de son propre corps le support nécessaire au déploiement de son imaginaire, quitte à se laisser entraîner dans la course folle de ses personnages : un entretien mené par Anne-Charlotte Peltier.
Quelle continuité entre Chienne et Louve et Une histoire de France, votre premier roman ? Si l’on retrouve le personnage de Romy, rien n’indique clairement qu’il s’agit de la suite. De plus, après un premier roman très sombre, Chienne et Louve apparaît plus lumineux, gonflé d’espoir d’une part, pailleté du sulfureux des clubs de Pigalle de l’autre…
Romy était un personnage très envahissant, si bien qu’après la parution de mon premier roman, je n’arrivais pas à m’en défaire malgré ma volonté de me renouveler. Je souhaitais continuer à travailler ses tocs et ses obsessions, mais sans faire la même chose que dans Une histoire de France. Il fallait que le lecteur qui l’avait lu s’y retrouve, sans léser celui qui ne l’avait pas lu.
L’univers de Chienne et Louve est ainsi bien différent : il naît de la volonté de tenter une mise en scène radicalement autre. Il est le fruit d’un défi, celui d’explorer quelque chose de tout à fait nouveau pour moi : Pigalle, le Crazy Horse et ses danseuses, les perruques roses et les strings à strass… D’une part, cela m’amusait de découvrir cet univers, d’autre part, cela me permettait d’interroger le rapport au corps et les diverses facettes de la féminité.

Bien que je ne sois pas allée sur scène, je viens du théâtre : comme Romy, j’ai suivi le cours Florent. Le corps et la voix qui sont l’outil du comédien sont également le point de départ de mon écriture. Je me sers de mes organes, de ce que je ressens dans mon ventre, dans ma poitrine, j’ai besoin d’éprouver, de ressentir physiquement les choses pour les écrire. Pour Chienne et Louve, j’ai dansé nue comme les danseuses du Crazy Horse pour tenter de saisir l’effet que procure la lumière de scène sur le corps à mesure que l’on bouge. De même, j’ai essayé de marcher avec le déambulateur que je prête à Odette dans le roman. C’est très physique ! Lorsque j’écris, j’ai besoin de faire le vide, d’évacuer, afin de ne pas prêter aux personnages des émotions qui sont les miennes et qui n’ont pas leur place dans le roman. J’ai mes rituels : avant d’écrire, comme au théâtre, je pratique la respiration ventrale pour faire le vide, ensuite, je ferme fenêtres et rideaux, comme pour ne pas être jugée par le monde extérieur et accepter d’aller vers le moche, l’inapproprié. Je danse aussi beaucoup, j’ai besoin de me dépenser, de m’étirer. Écrire, c’est très physique.
L’autre aspect que l’on retrouve, à travers vos personnages riches en nuance, c’est votre exploration du féminin.
J’avais à cœur d’explorer cette thématique. Le féminin est tout sauf une notion figée, c’est une boule à facettes aux multiples reflets. Par exemple, Romy a une forte part de noirceur mais également un côté très lumineux, et j’avais envie d’en explorer tous les aspects. J’aime travailler l’ambivalence et les nuances de cette féminité à travers les failles de mes personnages. Nora, par exemple, apparaît comme l’élève parfaite, issue d’un milieu privilégié, mais elle aussi a ses tares, ses parts d’ombre.
Ce qui m’intéresse tout particulièrement, c’est le côté border des personnages, presque sur le fil du rasoir. Je suis obsédée par le point de bascule, celui où le personnage est au bord de la folie, où l’on sent qu’il peut craquer à tout moment.
La littérature permet d’explorer des choses terribles qui dépassent le réel : la scène où Romy ligote Odette était jouissive à écrire. J’aime lorsque le personnage déborde et que je suis emportée par ses excès. Souvent, au cours de l’écriture arrive un déclic que le lecteur peut sentir au détour d’une phrase : c’est le moment où les personnages ont pris possession de l’histoire. Et puis, je crois que nous avons tous en nous ce point de bascule potentiel.
L’écriture est-elle un moyen de contrôler ce point de bascule ?
Je ne sais pas être légère : la littérature est un lieu qui permet d’explorer des sentiments et des émotions pas toujours confortables.
Il peut y avoir de ça : pour les besoins du récit, je suis capable de me mettre dans des états limites, tout en sachant qu’ils restent cadrés par le texte et que je peux en sortir. Toutefois, je me souviens d’un passage de Chienne et Louve particulièrement douloureux à écrire : parce qu’elle n��’a pas supporté être humiliée pendant son cours de théâtre, Romy se fracasse la tête contre le mur de sa douche. Cette scène était si éprouvante que je me suis demandé si j’allais en ressortir indemne, si j’allais réussir à briller comme Romy brille ensuite.
Je crois que la littérature s’apparente à l’exploration des terrains minés : il faut avancer pas à pas, désamorcer les bombes au fur et à mesure, tout peut exploser à tout moment, il se peut qu’on n’en revienne pas…Je ne sais pas être légère : la littérature est un lieu qui permet d’explorer des sentiments et des émotions pas toujours confortables. Il en va de même de mon rapport à la lecture : quand je lis, j’ai envie d’être bouleversée, de pleurer et de me remettre en question, avec ceci de beau qu’à la fin, ce n’est qu’un livre. On peut choisir de le refermer, mais il doit donner un écho, bousculer, photographier avec des mots la société.
Justement, le titre “Une histoire de France” renvoie l’idée d’une carte postale sociologique, qui viendrait mettre en lumière une certaine réalité, en l’occurrence Toul, une ville de garnison. Dans Chienne et Louve, vous décrivez avec force de détails l’intérieur des clubs de strip-tease de Pigalle, mais aussi, la réalité de l’intérieur d’une très vieille dame vivant seule dans son appartement parisien…
Mes histoires naissent de cette volonté de montrer l’invisible, pourtant omniprésent, de mettre en lumière les oubliés. Après le cours Florent, j’ai voulu arrêter le théâtre : je ne comprenais pas où était le public sans moyens. J’ai alors fait un rapport sur le public empêché, qui m’a ensuite conduite à travailler en psychiatrie à la Salpêtrière. De là vient mon intérêt pour les profils atypiques, en marge. L’écriture doit être universelle et parler au plus grand nombre, ce qui demande de dépasser ses petits problèmes.
Dans ce que vous dites, on retrouve l’idée de s’oublier au profit de l’histoire, de ne pas laisser ses propres émotions prendre le pas sur le récit. Pourtant, d’une certaine manière, le ressenti de l’auteur est souvent le point de départ de la littérature…
Je crois que tout romancier utilise nécessairement des parties de lui pour écrire, mais que le but est de les dépasser pour essayer de toucher à l’universel. Pour moi, le roman n’est pas mort, au contraire. On a aujourd’hui énormément besoin d’imaginaire pour fuir notre réalité et la littérature est un formidable territoire à explorer. Dans le roman, j’essaye de ne rien revendiquer : le roman est là pour montrer dans la description, pas pour apporter une morale. Morale comme règlements de comptes n’ont pas leur place dans le roman, contrairement à l’imaginaire. Je pense au Passe-Muraille de Marcel Aymé, aux nouvelles d’Edgar Poe ou même, à Stéphan Zweig : ces auteurs-là ont tous un rapport très fort à l’imaginaire, qui se perd aujourd’hui, ce que je regrette.
Quelle lectrice êtes-vous ? Quels auteurs vous portent ?
J’ai longtemps été plongée dans le théâtre avec le cours Florent -comme toute discipline, il y a un côté très totalitaire qui exige qu’on ne se consacre qu’à lui- au détriment de Joyce, Proust et Céline, découverts sur le tard. S’ajoute à cela un complexe d’infériorité du fait que je n’ai pas le bac. Ce n’est que tardivement que j’ai réussi à faire tomber cette barrière, et je suis devenue une lectrice boulimique, bien qu’il me manque encore beaucoup d’ouvrages au palmarès.
Quant aux auteurs qui m’ont marquée, je dirais que Marguerite Duras m’a donné l’autorisation de tout mélanger : elle faisait du théâtre, de la littérature, des films, allait d’un genre à un autre. Le Ravissement de Lol V. Stein m’a complétement transportée puisqu’elle s’inspire d’une femme à qui elle rend visite en psychiatrie et qui se trouve dans une forme d’errance. Ce livre a déverrouillé énormément de choses chez moi : j’ai compris qu’on pouvait tout se permettre en littérature car le lecteur a sa part part de chemin à faire et qu’il prend ce qu’il peut prendre. Enfin, Marie Ndiaye, m’a permis de comprendre que la violence pouvait s’immiscer en littérature sous toutes ses formes, ce qui m’a donné la possibilité de l’écrire.
Crédit photo : Francesca Mantovani – éditions Gallimard