
Dans son dernier ouvrage, Le pont flottant des rêves, la traductrice du japonais et autrice Corinne Atlan revient sur le sens qu’elle donne à l’acte de traduction. Le titre, qui fait référence au dernier chapitre du classique Dit du Genji, montre bien l’importance du passaged’une langue et d’une culture à une autre: transposer des mots permet de relier profondément les êtres. Cet ouvrage est le quatrième de la collection «Contrebande», déployée par les éditions La Contre Allée pour donner voix aux traducteurs.
Dans Le pont flottant des rêves, Corinne Atlan nous fait pénétrer dans son atelier de travail – au cœur de sa réflexion de praticienne. Elle met en avant les raisons qui l’attachent à l’acte traductif, dont elle a fait son métier et qui l’a amenée à transcrire en particulier les livres d’auteurs importants de la littérature japonaise (Ôgai Mori, Yasushi Inoue, Sôseki Natsume,…), y compris contemporains (Haruki Murakami, Keiichirô Hirano,…), dans des genres divers, pour une centaine d’œuvres en tout.
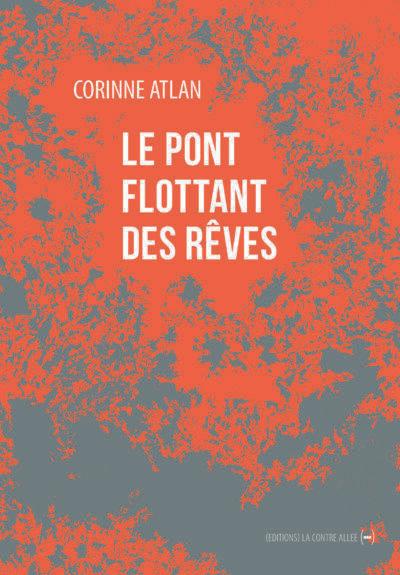
Elle décrit la traduction comme un voyage, qu’elle semble avoir initié dès qu’elle entama ses études, en choisissant le japonais et la linguistique alors que l’Extrême-Orient n’avait jusque-là aucunement attiré son attention – constituant une sorte d’inconnu dont elle ignorait tout.
La traduction apparaît alors comme un entre-deux. Celle qui est convaincue d’avoir entendu résonner plusieurs idiomes au cours de sa petite enfance en Kabylie tente d’expliquer son attrait pour le passage d’un langage à l’autre : il s’agirait pour elle d’un moyen de se réinventer pour combler le déracinement vis-à-vis de son histoire familiale. Bien plus, cela devient le moyen partageable de relier des cultures en apparence si différentes : « La traduction est pour moi recherche permanente de conciliation – ou de réconciliation – entre deux visions du monde, entre Orient et Occident. » Il s’agit donc ici de réparer mais aussi de transmettre ; si la traduction réclame des connaissances rigoureuses, elle permet avant tout de mettre en avant la sensibilité qui caractérise la démarche artistique de l’auteur.
Transformer les signes
La traductrice fait également part de son émerveillement face à la manière dont le langage prend sens à travers les signes : comme elle le rappelle, Pascal Quignard souligne que la lettre « A » était à l’origine le dessin d’une tête de taureau sacrifié (ce que l’on voit bien lorsqu’on la retourne). Atlan dresse alors un parallèle avec les idéogrammes présents dans plusieurs langues asiatiques, dont on peut parfois nettement voir l’origine dessinée : « Le taureau [sacrifié] ne différait sans doute guère du bovidé chinois dont les os ont présidé à la naissance des idéogrammes. » Ainsi les mots s’ancrent-ils dans le réel et en restituent-ils la chair : « Il s’agit en tout cas de découper, démembrer le réel, d’en racler les os et de résoudre ses intrigues pour que cela fasse sens, un sens à partager pour apaiser nos angoisses d’humains. »
De même que l’écriture, la traduction renvoie à la nécessité d’une transposition : Atlan montre comment, au vu des ressources qu’exploite parfois la langue traduite mais qui n’existent pas en français, elle est amenée à transposer de manière créative et compréhensible l’audace originelle des auteurs. Ce qu’elle fit par exemple pour les textes de Ryôichi Wagô, qui a publié ses courts poèmes sous forme de tweets au moment où les catastrophes naturelle et nucléaire eurent lieu au Japon en 2011. Lorsqu’un noyer plusieurs fois centenaire, contaminé comme d’autres arbres de Fukushima, a été abattu, il a publié plusieurs lignes composées entièrement (telles un cri répété) de l’idéogramme ki (木), signifiant « arbre », et dont les traits rappellent bien ce végétal. Comment, dès lors, transposer cette mise en abyme du signe représentant et signifiant dans le même temps l’arbre? La traductrice a fait le choix d’écrire sur de nombreuses lignes « L’arbre », mais en disposant les mots sous forme de calligramme représentant la plante, avec son tronc et son feuillage.
Elle précise ainsi que « [p]our traduire, il faut se laisser traverser. » Cela consiste non pas à essayer de transcrire directement le texte dans la langue d’arrivée mais à « [s]implement s’ouvrir à un processus de pensée, un imaginaire, un style, tout ce qui fait la singularité d’une œuvre […] et qui passe par cette langue-là. »
Traduire l’autre
L’autrice évoque donc le refuge qu’ont été pour elle la lecture et la littérature puis la traduction. Si en travaillant les langues sont appréhendées différentes cultures, comme on l’a vu, cela permet en réalité de faire le lien entre des visions singulières et individuelles qui se trouvent mises en contact. Le pont flottant des rêves du titre représente « l’entre-deux de la traduction » : « “deux lèvres”, deux langues, deux rives » – cette « [p]asserelle mouvante » qu’est le traducteur faisant lien.
Atlan souligne enfin ce qu’il y a d’ondoyant et d’instable dans le passage ainsi créé : le traducteur aboutit avec sa sensibilité à une représentation du texte d’origine, de même que le lecteur se représente ce qu’a voulu exprimer l’auteur. Il y a là interprétations, dans tous les sens du terme :
« Rien n’est statique dans le passage d’une mimésis à une autre. Représentation d’une représentation. Reflet mouvant, contours vagues. Mouvement qui floute les formes, comme sur une photographie tremblée. »
La lecture devient de cette manière une forme de rencontre permettant d’établir « le réseau de racines souterraines qui court au fond de chacun de nous et nous relie à notre insu les uns aux autres. » Ce qui constitue en définitive l’un des rôles de l’art : « Le lieu vibrant où se rejoignent la nostalgie de l’exil, le sentiment d’impermanence et le chagrin de la perte, voilà ce qu’est la littérature, voilà ce qu’est la traduction. »
Corinne Atlan, Le pont flottant des rêves, La Contre Allée, 2022
Crédit photo : Didier Atlani

















