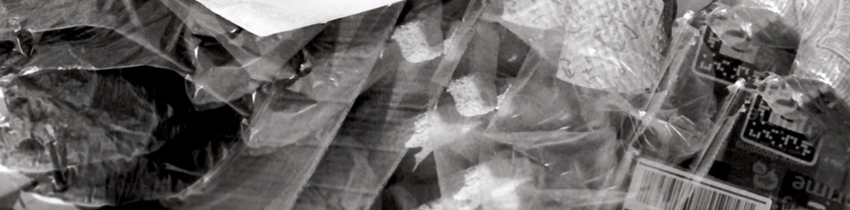C’était ma dernière journée à l’hôpital, où je devais me sevrer et de l’alcool et des benzodiazépines, et j’ai eu mon premier contact social depuis des jours. Je fumais devant la table de ping-pong, seul, comme depuis trois semaines où je végétais ici avec la conscience bien ténue que cela ne me servirait à rien. Il n’y avait personne aux alentours jusqu’à l’apparition de cette femme aux cheveux courts d’une cinquantaine d’années, vêtue de frusques sportifs, qui me proposa de faire une partie. N’ayant eu de contact jusqu’ici qu’avec mon psychiatre, un médecin, des infirmières et des femmes de chambre, j’avais comme perdu l’usage de la parole. Le “non” qui aurait dû se matérialiser sur mes lèvres s’est transformé en un “oui” autistique. Elle m’a demandé comment je m’appelais.
– Je te connais de nom, elle a fait.
Je n’ai pas voulu en savoir plus. Je savais qu’un traître se trouvait parmi les patients ou le personnel puisque ma condition d’écrivain de neuvième zone avait été dévoilée. Puis elle m’a donné le sien et c’est comme si un dieu hilare passait du bon temps au-dessus de ma tête : elle portait le même prénom que la femme qui venait de me quitter pour ivrognerie et autres méfaits. Pourquoi fallait-il que cela tombe sur elle, ma première interaction depuis trois semaines, pourquoi je ne l’ai pas, comme je l’aurais fait si je n’étais pas abruti par les médicaments de sevrage, envoyer chier avec son histoire de ping-pong, ce sport d’EPS ? Nous avons donc fait une partie. Elle s’est très vite lassée de mon revers approximatif, de ma lenteur à ramasser les balles ; bref, dès qu’elle a aperçu un autre zigue, elle l’a alpagué et, en silence, je les ai laissés faire mumuse ensemble et je suis retourné à mes cigarettes.
J’ai très mal dormi cette nuit-là puis au matin, après quelques signatures de papelards administratifs, j’étais libre – avec une ordonnance dont même un crackhead de la Chapelle se méfierait – et je n’avais rien à foutre dehors. Une amie m’a prêté son appartement. Je me suis aperçu que ça y était, les vacances, les grandes !, avaient commencé. Je crevais de chaud et, n’y tenant plus, après ma troisième bière (le sevrage n’est pas une science exacte), j’en ai eu ras le cul, j’en ai mis trois autres dans un sac et je suis descendu les descendre sur un banc sur l’esplanade.
Un petit vent avait commencé à souffler, ce qui rendait le tableau plus agréable, déjà, et c’est ce moment qu’a choisi un sourd-muet pour venir m’emmerder. Il faisait de grands gestes et se montrait de plus en plus agressif. Qu’y pouvais-je si je ne parlais pas sa langue ? Bientôt, la bave aux lèvres, il a serré le poing droit et, de l’autre, a fouillé sa poche gauche. C’était visible : il allait m’en coller une, voire pire. J’ai bu une dernière gorgée de bière et, à sa grande surprise, je lui ai décoché une baffe mi-poignet/mi-paume de la main. Son arcade sourcilière s’est ouverte et les flics ont déboulé (sans cela, probable que mon deuxième roman fut posthume). Ils nous ont fouillé. Bernardo, le sourd-muet, avait un couteau dans sa poche gauche (je ne m’étais pas trompé) et, surtout de la dope. J’ai dû expliquer aux flics que je ne connaissais pas ce gars et que nous n’étions pas amis de défonce. Mais l’autre débile ne pouvait confirmer.
– Je n’ai d’ailleurs pas d’ami, ai-je cru bon d’ajouter.
Ils ont menotté Bernardo et pas moi, ce qui m’a naïvement fait penser qu’ils m’avaient à la bonne, que je passerai une ou deux heures au commissariat puis que ce serait marre. Bernardo ne cessait de me jeter de sales œillades. Bon, ai-je pensé, ni lui ni moi ne ferons de la prison à vie et valait mieux que je ne le croise plus jamais, sauf si je voulais ...