Marsiho, d’André Suarès, nous révèle qu’un monde subsiste derrière les mots. Que du rêve à la réalité, des tourments intérieurs aux causes sociales, de l’individu au collectif, tout ce qui s’affiche autour de nous et en nous, par la littérature, peut inonder l’espace et remplacer les terrains vagues de l’existence. Suarès possède cette faculté éblouissante de déployer son regard ou l’étendue des nôtres. Il intercède dans notre chemin et le rend instantanément plus grand, plus haut, plus vrai. Sa puissance nous contamine et par la suite, car, comme une évidence, la littérature s’est manifestée, plus rien ne sera jamais comme avant.
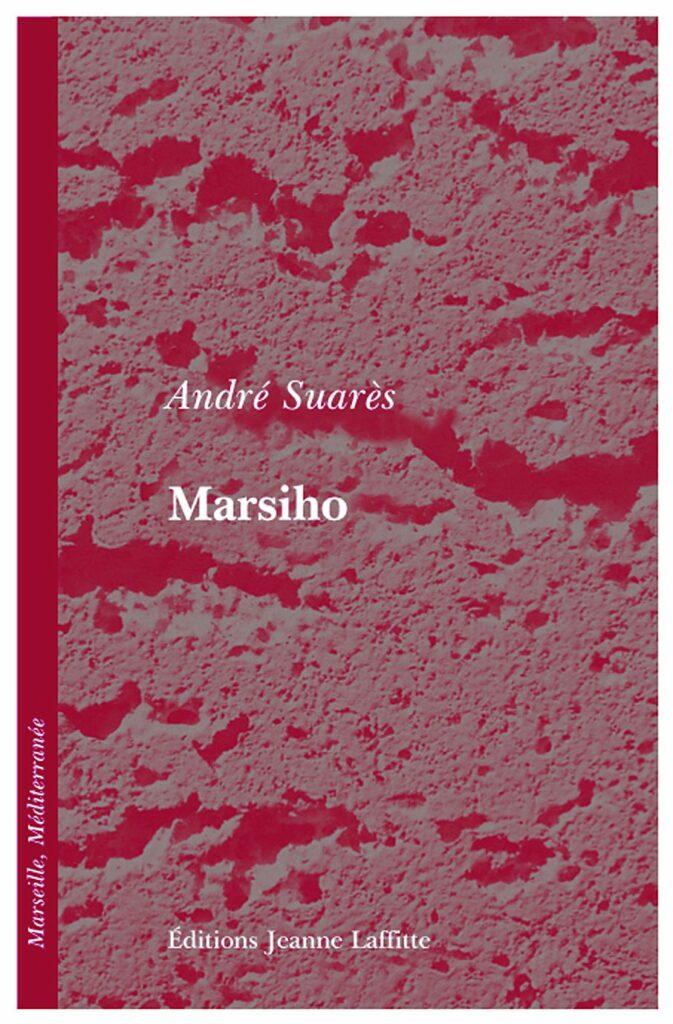
Là-bas sont les flots, les arts et les vents. Là-bas, ou ici-bas où pour l’auteur Marseille règne par son décor, son motif et son histoire, comme un mirage. Lorsque j’ai découvert André Suarès, à l’aube de mon errance littéraire, ce fut par Marsiho, un petit bouquin fait de courtes parties comme des morcellements de la ville et de son atmosphère. C’est par lui que j’ai compris ce que les autres appelaient un style en littérature. Par lui que j’ai rencontré un auteur qui m’accompagna jusqu’à ces derniers jours, et m’accompagnera pour le restant des miens. Et par lui encore, aussi, que j’ai mis l’œil sur Honoré Daumier, ce peintre et caricaturiste que, sans honte, je pourrais aisément réduire au qualificatif synthétique (mais par mes considérations exigeantes : rarement obtenu) d’artiste.
« On peut dire du snob qu’il est le contraire de Daumier. La moquerie de Daumier tonne. Il sera le fouet des prolétaires, à l’occasion, comme il est le fléau des bourgeois. Cependant, sa compassion de la misère humaine fait toujours pencher la balance du côté où la douleur, les victimes de l’abus et de l’injustice accumulent leurs poids écrasants et leurs charges méconnues. »
Dans la troisième phrase de cet extrait, l’artiste (André Suarès), confond les objets et permute les rôles. Le fouet étant communément l’objet des bourgeois (qui de surcroît s’abat sur les plus faibles) et le fléau étant (au-delà même de son double sens) cet instrument servant à battre les céréales que les agriculteurs utilisent, Suarès, en une phrase, forme le plus haut point métaphorique de la lutte des classes. Il décrit Daumier comme il décrierait l’obligatoire rôle de l’artiste. Il intervertie les réalités pour mieux les montrer, les dévoiler.
Après le peintre, le poète
Car, chez Suarès comme dans la vie, les humains ne sont que de passage
C’est donc comme ça, par cette phrase qui pourtant, dans son contexte, passe inaperçue, que j’ai appris la puissance des mots anodins. Car de ceux-là, Suarès regorge. Marsiho est son livre le plus direct, le plus franc et le plus intime. Sans retenues. Mais surtout sans divagations inutiles, et donc sans trop plein de litotes, d’asyndètes et d’accumulations. En étant épuré jusqu’aux lueurs poétiques, noble et lapidaire, cet ouvrage sur Marseille est une cartographie spatiale et temporelle parfaite. Une prose, dans un même cadre, dense et dépouillée, et bien loin d’être surfaite. Car Marsiho installe le lecteur dans un doux voyage précis. Il côtoie en vingt parties ses grands bords (canal du Rove, château Borély, mistral, phare Sainte-Marie, entre autres…) et il acère ses armes et tranche le genre. Il subjugue la prose des flatteries en surpassant les autres et les suivantes. Il dévalise la langue pour l’offrir aux démunis et il jaillit parmi les ombres, constituant ce texte que les entichés des cadences verbales attendaient tant. Marsiho pue la littérature comme l’humain sue. Il transpire son geste artistique sans retenues, sans crainte de brusquer, ni peur d’émouvoir. Il sait magnifiquement bien danser parmi les figures, car son style dose sans jamais s’aplatir ni frôler la nausée.
« Et toujours la foule, la foule mouvante, criarde, qui se hâte en flânant, et qui pressée s’attarde. Une vie frénétique, gourmande, goguenarde, insoucieuse, affichée. Un convoi funèbre passe, qui est, peut-être, une noce de croque-morts. »
Car, chez Suarès comme dans la vie, les humains ne sont que de passage. Seuls les paysages perdurent, survivent. Ils sont les corps de l’existence, expirant en souffles les vivants, morts-vivants qui d...

















