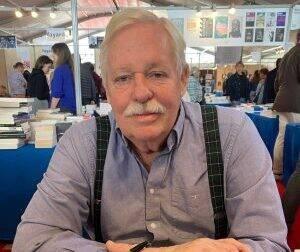Armistead Maupin, né en 1944 au sein d’une famille traditionnelle et conservatrice de Caroline du Nord, s’est fait connaître à partir des années 70 comme l’auteur des Chroniques de San Francisco, au retentissement mondial, et comme l’un des porte-voix, avec Harvey Milk, des revendications de la communauté homosexuelle.
Les Chroniques sont l’histoire en feuilleton, des années 70 aux années 2000, d’habitants d’une pension de famille de San Francisco, certains hétérosexuels, d’autres homosexuels, qui deviennent amis, se rapprochent ou se séparent, sous la férule d’une logeuse débonnaire et fantasque. Les romans, à ce jour au nombre de neuf, traitent sur un mode léger, humoristique mais également tragique des joies et des peines, et pour résumer de la vie elle-même, de ce petit monde attachant. On traverse ainsi sur plus de trente ans l’époque post-Woodstock de la libération sexuelle, celle de l’épidémie meurtrière du sida et enfin celle des applications de rencontre et de la drague en ligne.
Dans le cadre du Festival America, Zone Critique a rencontré le fondateur du 28 Barbary Lane.
- Vous êtes invité dans le cadre du Festival America, qui célèbre la littérature américaine. La France vous a connu avec un peu de retard (à la fin des années 90) mais a réservé un grand succès à votre œuvre. Que représente la culture française pour vous ?
Il est évident que les lecteurs français apprécient la lecture et éprouvent une certaine vénération pour le statut même de l’auteur. De fait, je suis toujours ravi de venir ici et de rencontrer des gens qui portent un réel intérêt littéraire à mon œuvre et à la littérature en général. C’est toujours flatteur et source d�’enrichissement mutuel. Ce n’est pas le cas en Amérique. L’attention accordée aux auteurs diffère selon que nous sommes de ce côté de l’Atlantique ou de l’autre. Et c’est ce que j’aime en France.
- Vous êtes principalement connu pour les Chroniques de San Francisco. Si cette série de romans a été l’un des fers de lance de la lutte pour les droits des homosexuels, elle a depuis dépassé cet aspect pour devenir une œuvre littéraire à part entière. Le fait de ne pas être catalogué, n’est-ce pas là la victoire de la normalisation ?
Tout à fait et ce n’est pas venu tout de suite. J’ai dû attendre un certain temps avant de convaincre les gens que je n’écrivais pas pour une niche ou une communauté mais pour le grand public en général. J’ai toujours fonctionné ainsi. Quand j’écrivais pour les journaux de San Francisco, mon intention était de raconter une histoire dans laquelle tout un chacun pouvait se retrouver. Cela ne signifiait pas pour autant que je voulais mettre de côté les questions relatives aux homosexuels ou que je répudiais de quelque façon ce qui a été le grand combat de ma vie. Mais le récit devait être inclusif et concerner tout le monde.
- Les Chroniques paraissaient à l’origine en feuilleton dans le San Francisco Chronicle pour lequel vous écriviez. Quel accueil ces chroniques ont-elles reçu à leur parution ?
Elles ont été accueillies avec horreur, amusement et également plaisir. Les gays n’arrivaient pas à en croire leurs yeux et que ce qu’ils vivaient au quotidien était retranscrit dans les journaux. Il était assez exaltant de savoir que des gens attendaient le prochain épisode avec impatience. Y compris ceux qui étaient quelque peu horrifiés par les thématiques homosexuelles du roman ne pouvaient pas s’empêcher de lire. Et je me suis rendu compte que l’acte le plus radical que je pouvais commettre était de tenir ces gens-là en haleine. Wilkie Collins, le grand feuilletoniste britannique, formulait ce credo : « Faites-les pleurer, faites-les rire, faites-les attendre ». Je m’y suis tenu.
- Avez-vous pris conscience très tôt du potentiel que pouvait avoir votre œuvre sur l’évolution des mœurs, d’autant plus dans un contexte difficile (après les émeutes de Stonewall, pendant la campagne Save our Children d’Anita Bryant…) ?
J’en ai pris conscience au moment où j’ai écrit la Lettre à Maman, qui était la véritable lettre que j’ai envoyée à mes propres parents. Je savais que cette campagne, Save our Children [Sauvez nos Enfants] avait une certaine portée politique et ma lettre a été en quelque sorte un coup de colère froide à l’encontre d’Anita Bryant. Mais j’ai pu faire cela dans le cadre d’une histoire drôle.
- On évoquait le fait de ne pas être catalogué. Pensez-vous que définir votre œuvre comme de la littérature engagée (non seulement pour les droits des homosexuels mais pour la tolérance en général et le droit à la différence, pensons par exemple à Maybe the Moon) serait trop réducteur ? La littérature peut-elle ou doit-elle être engagée ? Ou existe-t-elle par elle-même, tout dépend de l’interprétation qu’en font les lecteurs ?
J’ai simplement été guidé par ce que j’avais envie d’écrire, cela a toujours été mon mode de fonctionnement. Quand j’ai imaginé cette histoire d’amitié entre une actrice naine de 80 centimètres et un écrivain gay à Hollywood, mon objectif était de raconter une histoire et c’est ainsi qu’est né Maybe the Moon. Ce récit a eu les mêmes effets sur les gens de petite taille en Amérique que les Chroniques sur les homosexuels. Ils ont vu pour la première fois leur vie dépeinte avec bienveillance. Mais je n’ai pas de théorie grandiloquente sur moi-même, il est simplement de mon devoir d’écrire ces choses-là et de coucher sur le papier ce que je considère comme une bonne histoire à raconter. Et c’est aussi comme cela que je suis arrivé aux Chroniques, une histoire que j’ai narrée avec affection et vérité.
- Le temps de l’écriture est le présent immédiat. Peut-on dire que votre histoire, vos personnages et même votre style ont évolué en même temps que les mentalités ? Au début du premier volume, la thématique de l’homosexualité n’est pas encore omniprésente, comme s’il était encore difficile à l’époque de traiter de ce sujet.
J’ai dû m’y prendre de cette façon car c’était publié dans un journal ; je ne pouvais pas trop forcer ma chance, autrement la rédaction aurait pu décider de tout arrêter. C’était un risque. Mais ensuite, j’ai écrit Michal Tolliver est vivant, qui a été le moyen pour moi de dire : « voilà l’histoire d’un homme gay, écrite à la première personne etc. » Donc mon style a en effet évolué au cours du temps, de même que les mentalités changeaient en parallèle.
- On apprend dans vos mémoires, Mon Autre Famille, que vous êtes issu d’une famille conservatrice et que vous avez partagé ou fait semblant de partager ses idéaux durant votre jeunesse. Le fait de venir à San Francisco vous a libéré. Comment expliquer cette influence sur le jeune homme frustré que vous étiez ?
Eh bien parce que j’ai eu libre accès aux queues pour la première fois de ma vie ! J’ai tenté d’utiliser une expression similaire hier lors de ma conférence, quand j’ai dit que je n’avais qu’à suivre ma bite dans tout San Francisco, ce qui a embarrassé mon traducteur. Il s’en est finalement sorti en disant que je suivais mes instincts primaires dans tout San Francisco.
C’était bel et bien aussi simple que cela. J’ai ressenti ce soulagement de pouvoir traîner avec des hommes affectueux, ce qui représentait la chose la plus extraordinaire de ma vie et également une cause politique à défendre. Cela n’aurait jamais pu arriver dans mes jeunes années à Raleigh, en Caroline du Nord.
- On y apprend aussi que vous avez rencontré Richard Nixon, qui vous a reçu en tant que jeune vétéran de la guerre du Vietnam. Vous doutiez-vous à l’époque qu’il s’agissait d’une stratégie de communication pour montrer la guerre sous un meilleur jour vis-à-vis de la population ?
Ce n’est pas à ce Dick-là que je pensais ! C’était assurément un effort de propagande de sa part, pour faire en sorte de montrer que des jeunes aussi approuvaient la guerre. Alors il a invité une dizaine de vétérans du Vietnam à la Maison Blanche. J’ai réalisé immédiatement qu’il était profondément mal à l’aise et il transpirait abondamment. Quand il s’est finalement remis de ses émotions, il a commencé à évoquer des histoires coquines sur des femmes et à s’évertuer à nous parler de l’apparence très sexy des jeunes Vietnamiennes. Il a dit cela au seul suceur de bite de la pièce : moi ! Il était ridicule. Je l’ai vu tel qu’il était vraiment.
- Peut-on dire finalement que San Francisco, qui est omniprésente, est le personnage principal de votre œuvre ?

Je ne dirais pas cela maintenant car j’ai quitté San Francisco depuis trois ans et demi pour m’établir à Londres. Je me consacre à l’écriture de mon dernier roman, toujours dans la série des Chroniques, qui a lieu dans un cadre britannique et qui s’intercale au milieu de la série. Il revient sur la vie de Mona Ramsey dans son manoir anglais. Mais à part cela oui, je suppose qu’on peut dire que San Francisco est sans aucun doute le personnage principal, au moins des Chroniques, même si Maybe the Moon se déroule à Los Angeles. Il n’y a pas à tortiller.
- Vous écrivez dans vos mémoires que San Francisco a changé, qu’elle est devenue touristique et inabordable. Eprouvez-vous de la nostalgie pour l’ancienne ville de votre jeunesse ?
Je pense que tout le monde ressent de la nostalgie pour sa jeunesse. J’y ai vécu une époque merveilleuse et j’en ai des souvenirs fantastiques mais je n’ai pas besoin de rester figé dans le passé, pour le temps qu’il me reste à vivre. C’est derrière moi maintenant et nous vivons désormais une époque différente. Mais il est vrai que San Francisco a perdu un peu de sa magie à cause du règne de l’argent-roi qui a parasité toute l’Amérique. Mon histoire, dans les Chroniques, a lieu dans le quartier de Russian Hill. Dans les années 70, vous n’aviez pas besoin d’être riche pour y commencer votre vie. Ainsi, un de mes personnages, Brian, qui réside au 28 Barbary Lane, une adresse fictive dans ce quartier, est un simple serveur dans un bar ! Aujourd’hui, il ne pourrait même pas se permettre de payer le loyer.
- Votre arrivée à San Francisco puis votre écriture des Chroniques vous ont aidé à faire votre propre coming out (notamment dans votre fameuse Lettre à Maman). Le processus d’écriture a-t-il été pour vous une catharsis, qui a permis d’accoucher de votre vraie personnalité ?
Tout à fait ! Il n’y a aucun doute là-dessus. J’écrivais parfois ce qu’il m’arrivait réellement dans ma vie. Ainsi, quand je vivais quelque chose de particulier dans un bar un soir, cela se retrouvait retranscrit le lendemain dans le journal. C’était un bon moyen de faire le tri dans mes sentiments. Vous avez mentionné la Lettre à Maman. Je dois reconnaître que je suis assez fier de l’impact qu’elle a eu, qui n’était pas du tout prévu au départ, et de son résultat sur les gays qui ont pu, dès lors, trouver la force de sortir du placard grâce à cela. Elle a même été lue de nombreuses fois en public, y compris par mon ami l’acteur Ian McKellen. Ce que j’ai écrit m’a libéré et a libéré également d’autres personnes, même si ce n’était pas intentionnel.
- Deux des personnages principaux, Mary Ann Singleton et Michael Tolliver, sont de jeunes provinciaux naïfs qui, petit à petit, prennent confiance en eux et osent affirmer leur personnalité. Peut-on dire qu’il y a de vous dans ces deux personnages ? Peut-être davantage dans celui de Mary Ann, qui a sa part de secrets ?
Michael était ce que j’étais en train de devenir, Mary Ann ce que j’avais été. J’éprouve une vraie affection pour elle. Elle a été moi à mes débuts, quand j’ai commencé à écrire les premiers chapitres : une jeune fille un peu coincée venant de Cleveland, Ohio (j’étais de Raleigh, en Caroline du Nord) qui ne connaissait pas encore grand-chose à la vie. Une fois arrivé à San Francisco, ma vie gay s’est épanouie petit à petit et je suis devenu un peu plus comme Michael, ce jeune homme enjoué à la recherche perpétuelle du grand amour de sa vie.
- Michael Tolliver est vivant est, dans toute la série, un opus différent : il s’agit du seul qui soit rédigé à la première personne du singulier, par la voix de Michael, trente ans après le début des Chroniques. Le récit décrit un Michael vieillissant, dans la cinquantaine, en proie au doute et qui se rassure en trouvant l’amour dans les bras d’un jeune homme de vingt à trente ans son cadet. Ce roman occupe-t-il une place particulière à vos yeux ?
Sans aucun doute ! Parce que toutes les choses que j’ai décrites dans ce roman m’étaient arrivées. Je venais de rencontrer mon mari Christopher Turner, qui a trente ans de moins que moi, tout comme Ben, le mari de Michael. Je voulais célébrer tous les survivants de l’épidémie du sida, qui a été un énorme traumatisme. Même ceux qui, comme Michael, sont toujours atteints de la maladie. Dans un certain sens, c’était mon roman le plus personnel, celui où j’ai mis le plus de moi-même. Michael a vieilli, est devenu un peu ventripotent, moins confiant en raison de son âge et de sa santé. Même s’il a trouvé le véritable amour, il est toujours vulnérable et j’ai mis en évidence cette fragilité dans le roman.
- Michael est un peu dépassé par les nouveaux enjeux de société (le transgenre etc.). Et pourtant, vous avez été pionnier dans le traitement de ces questions. Ainsi, le personnage d’Anna Madrigal, la propriétaire maternelle et bien intentionnée du 28 Barbary Lane, était un homme avant son changement de sexe et elle est peut-être l’un des premiers personnages transgenres importants de l’histoire de la littérature moderne. N’est-ce pas contradictoire ?
Dans le roman, Michael tombe sur un type dans un bar et le prend pour un homme, mais ce dernier n’a pas d’organes génitaux masculins à proprement parler. Il doit donc faire face à cette situation, mais je pense qu’il l’a très bien gérée. Tout cela était nouveau pour moi lorsque j’ai commencé à écrire sur les hommes trans à San Francisco. Pour mieux comprendre, j’ai commencé à poser des questions à mon coiffeur, qui était lui-même trans. Je lui ai donc demandé un jour si je pouvais aller déjeuner avec lui et lui poser des questions personnelles sur ce sujet. J’ai toujours essayé de laisser mon cœur ouvert à toute nouveauté, quoi qu’il arrive. Anna Madrigal dit, dans lesChroniques : « Tu n’as pas à suivre le mouvement, chéri, tu dois simplement rester ouvert ». C’est la consigne que je me suis donnée.
- Michael décrit aussi l’existence de la communauté gay à l’heure d’Internet, des applications de rencontre. Qu’est-ce que cela révèle de notre société ? Les relations humaines ont- elles irrémédiablement changé ? Sont-elles devenues artificielles ? Etes-vous pessimiste ?
Je ne veux pas penser à tout cela, cela m’épuise ! Techniquement, tout ce qu’il se passe sur Internet me laisse un peu perplexe. Je pense qu’il est fantastique que les gens aient à leur disposition de nouveaux moyens de se rencontrer. Mon mari, par exemple, est le fondateur de Daddyhunt, un site qui met en relation des hommes plus âgés et des plus jeunes. On fait ce qu’on peut. Je n’ai pas de grande déclaration à faire là-dessus, je ne dis pas qu’Internet est bon ou mauvais. C’est un outil que vous devez manier avec précaution. Les gens ont tendance à tomber instantanément amoureux de parfaits étrangers, sans bien les connaître. Et c’est peut-être le plus grand changement qui a eu lieu par rapport à mon « époque ». D’un côté, il est plus facile de rencontrer des gens, sans même avoir à quitter son canapé, mais de l’autre, c’est dangereux car vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber.
- Il y a en effet un fossé entre les générations. Peut-on dire que l’ancienne génération et la nouvelle vivent dans des mondes séparés ? Comment peut-on dès lors se comprendre et se parler ?
Mon expérience personnelle m’a valu un grand éclat rire lorsque j’ai dit : « Je ne comprends pas ces jeunes avec leurs applications. Quand j’étais moi-même jeune, je devais marcher 15 km dans la neige juste pour sucer une bite ! ». C’était ma façon de dire qu’il ne faut pas tomber dans le piège de la méfiance automatique vis-à-vis des nouvelles générations. Chacun fait avec ce qu’il a en main. Je n’ai pas de jugement à porter là-dessus.
- L’écrivain et académicien français Dominique Fernandez, né en 1929, a publié deux ouvrages récemment, intitulés L’Homme de trop. Il apparaît déchiré entre le bonheur qu’il éprouve à voir que les mentalités ont évolué de façon positive et le regret voire la mélancolie de voir à quel point les homosexuels, autrefois une force vive de protestation, se sont embourgeoisés dans le confort de leur liberté nouvelle. Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Je ne suis pas sûr du point de vue qu’il expose mais je ne crois pas un seul instant qu’on peut dire que c’était mieux avant, si c’est vraiment ce qu’il a voulu dire. Il signifie peut-être qu’il pouvait mieux se cacher autrefois, que les gays pouvaient passer pour des hétérosexuels et autres concepts démodés que je ne reprends pas à mon compte. Encore une fois, c’est le monde dans lequel nous devons vivre maintenant. Ce n’était pas mieux avant quand les gens se faisaient tabasser ou tuer en raison de leur sexualité. Certaines personnes regrettent leur époque passée mais cela a toujours été le cas.
- La traduction française de Tales of a City est Chroniques de San Francisco. Le titre insiste davantage sur l’aspect temporel que sur l’aspect narratif. Est-ce que vous le regrettez ? Peut-on dire de votre roman qu’il s’agit d’un conte de fées moderne et réaliste, décrivant un endroit (le 28 Barbary Lane) comme une sorte de cocon où tout le monde rêverait de vivre ?
Oui, le côté « conte de fées » était tout à fait assumé car mon histoire est, dans un sens, un conte réaliste. Il parle de la vraie vie, donc ce n’est pas déconnecté de la réalité. Mais on peut également dire que le 28 Barbary Lane est un endroit douillet où tout le monde se sent en sécurité, en accord avec ses sentiments et libre de s’exprimer librement. Je ne sais pas pourquoi l’édition française n’a pas traduit par « les Contes de la Cité » ou « les Contes de San Francisco ». C’est ironique car mes histoires ont paru dans le San Francisco Chronicle, il s’agit peut-être d’un clin d’œil au journal. Il faut faire avec.
- La grande menace est bien sûr l’épidémie du sida qui marque la fin de l’insouciance. Vos romans ont été écrits avant, pendant et après l’épidémie. Vous avez choisi de montrer cette maladie dans son horreur (les morts successives de nombreux personnages, l’agonie de Jon Fielding…) et d’évoquer ses conséquences au quotidien (Michael a attrapé le VIH et se bourre de médicaments, ce qui entraîne des conséquences sur sa santé). Était-il important pour vous de montrer cette maladie telle qu’elle est réellement ? Comment avez-vous surmonté le problème de sa description dans votre œuvre à l’époque où il s’agissait d’une « maladie honteuse » qui, soi-disant, ne touchait que les homosexuels ?
Tout d’abord, je n’ai jamais considéré pour ma part que c’était une maladie honteuse. Je me suis senti obligé d’écrire sur ce sujet car j’ai perdu un ami très cher du sida en 1982 et je voulais transposer cette douleur sur le papier. Donc j’ai tué un des personnages principaux, Jon Fielding, ainsi que d’autres personnages secondaires pour que les lecteurs éprouvent un chagrin fictif qui correspondait à ce que j’avais éprouvé personnellement dans la vraie vie. C’était intentionnel et je savais que c’était risqué car, dans mon contrat, il était stipulé que je devais divertir le lectorat du quotidien. Mais j’ai estimé qu’il aurait été irresponsable de faire l’impasse dessus et de taire cette tragédie.
- Notre revue Zone Critique a dédié son dernier numéro à la famille. Vous faites une distinction entre famille biologique et famille logique (qui est le titre de vos mémoires). Quelle est plus précisément votre conception de la famille ? Peut-on la choisir en fonction d’affinités particulières ?

Une famille logique est cette sorte de famille que les gens d’aujourd’hui se créent. Certains sont attachés aux liens biologiques et aux racines familiales, mais pour ma part je ne le suis plus. J’ai une sœur que j’aime tendrement et nous sommes toujours en contact. Mon frère est un idiot fanatique de Trump, on ne se parle plus et je m’en fiche. Il s’agit de la famille que vous vous construisez pour vous-même, tout le monde en a une, qu’on soit gay ou hétéro. Cela arrive très souvent de nos jours.
- Néanmoins, vous avez réussi à renouer les liens avec vos parents, notamment votre père âgé et très conservateur à qui vous avez rendu visite pour la dernière fois avec votre mari, de même que Michael qui a rendu visite à sa mère mourante avec laquelle il avait pris ses distances. Il peut donc toujours y avoir de l’espoir, même quand les familles ont du mal à rester unies.
Je ne décourage personne d’essayer de conserver ou de renouer les liens avec leur famille biologique. Dans mon cas personnel, c’est une vieille histoire : mes parents sont morts, mon frère est un abruti et je n’ai quasi plus personne avec qui m’entretenir. Et je suis heureux d’avoir une très forte famille logique qui me soutient considérablement et cela seul compte. Je ne veux simplement pas que des gens tentent de maintenir désespérément un lien affectif avec une famille qui ne les accepte pas et ne les aime pas pour ce qu’ils sont. C’est très simple, finalement. Si vous êtes un esprit libre, si vous êtes maître de votre propre vie, vous n’avez pas à supporter ce genre de situation « merdique ».
- Il arrive que les contes se terminent mal. Si la tonalité humoristique prédomine, il y a également un côté tragique très prégnant. On peut penser à l’incompréhension insurmontable entre les membres d’une même famille (celle de Michael par exemple, qui ne comprend pas et choisit d’ignorer son homosexualité malgré la lettre) et l’impossibilité de communiquer qui en découle.
Je voulais que les lecteurs ressentent ces deux choses : le côté léger et humoristique de la vie mais aussi son côté sombre et tragique. Je souhaitais qu’il y ait de la joie et des rires ainsi que de la tragédie, qui est celle de la vie. J’ai tenté de couvrir tous ces aspects. Même dans Michael Tolliver est vivant, Michael ne parvient pas complètement à renouer le lien avec sa mère mourante, mais elle a conservé malgré tout avec elle cette photo de Michael et son mari. Cela aide Michael et lui montre qu’il est libre de mener sa vie comme il l’entend. Donc il y a toujours un espoir, en effet.
- Quel regard portez-vous sur les séries qui ont été adaptées de vos romans en 1993 et 2019 ? Vous avez d’ailleurs développé des liens d’amitié avec Laura Linney et Olympia Dukakis.
Je suis particulièrement heureux de ces séries, parce qu’elles m’ont fait connaître Laura et Olympia, qui ont pris une place importante dans ma vie. Laura a baptisé son fils Bennett Armistead en mon honneur, j’en ai été très ému et j’en suis très fier. Ces séries ont invité de nombreuses personnes dans ma vie. De plus, les adaptations sont très fidèles aux romans, surtout la première version, celle de 1993, qui est britannique. La seconde version, celle de Netflix, a été scénarisée par une jeune équipe de queers, et tout ce qui a trait de près ou de loin à la vie queer était représenté dans cette équipe. Donc ils ont été une source d’informations intéressantes et non négligeables pour l’histoire. Ils ont changé quelques petites choses, ce qui m’a chagriné un peu, mais je me suis rendu à l’évidence et j’ai laissé faire pour que la série puisse se concrétiser.
- Vous mentionnez souvent W.H. Auden ainsi que Christopher Isherwood dans vos mémoires. Ont-il été des maîtres à penser ?

Oui, on peut le dire, en quelque sorte. Auden à un degré moindre mais il est malgré tout un modèle. Isherwood, avec lequel je suis devenu ami, était la personne que je voulais devenir. Il était en couple avec un homme beaucoup plus jeune, le peintre Don Bachardy qui est toujours un ami, et je suis moi-même avec un photographe bien plus jeune. Et c’est ironique car Isherwood a déménagé de Grande-Bretagne pour se rendre en Amérique alors que j’ai fait le trajet inverse.
- Finalement, si vous deviez faire le bilan des quarante dernières années, que diriez-vous ? Etes-vous optimiste ou pessimiste quant à l’avenir de la communauté homosexuelle ? Reste-il des efforts à faire pour que les mentalités évoluent encore ?
Il y a encore du travail à faire, bien sûr. Nous avons parcouru un long chemin mais on doit encore défendre les droits de nos frères et sœurs trans, qui ne sont toujours pas sécurisés, tout spécialement en Grande-Bretagne où l’on voit des gens qui se nomment Trans Exclusionary Radical Feminists (TERF). Je ne sais même pas comment ce genre de choses peut exister. Par exemple, ces féministes refusent de voir des femmes trans dans les toilettes pour femmes. C’est vraiment un regard très primitif porté sur autrui. C’est malveillant et cela ne prend pas en compte l’apport considérable des trans dès les débuts de notre mouvement. C’est là que j’aimerais que des promesses soient faites.
Bibliographie :
Chroniques de San Francisco
- Chroniques de San Francisco, Passage du Marais, 1994 ((en) Tales of the City, 1978)
- Nouvelles Chroniques de San Francisco, Passage du Marais, 1995 ((en) More Tales of the City, 1980)
- Autres Chroniques de San Francisco, Passage du Marais, 1996 ((en) Further Tales of the City, 1982)
- Babycakes, Passage du Marais, 1997 ((en) Babycakes, 1984)
- D’un bord à l’autre, Passage du Marais, 1997 ((en) Significant Others, 1987)
- Bye-bye Barbary Lane, Passage du Marais, 1998 ((en) Sure of You, 1989)
- Michael Tolliver est vivant, Éditions de l’Olivier, 2008 ((en) Michael Tolliver Lives, 2007)
- Mary Ann en automne, Éditions de l’Olivier, 2011 ((en) Mary Ann in Autumn, 2010)
- Anna Madrigal, Éditions de l’Olivier, 2015 ((en) The Days of Anna Madrigal, 2014)
Autres romans
- Maybe the Moon, 1999 ((en) Maybe the Moon, 1992)
- Une voix dans la nuit, 2001 ((en) The Night Listener, 2000)
Mémoires
- Mon autre famille, Éditions de l’Olivier, 2018 ((en) Logical Family: A Memoir, 2017)
English version
Armistead Maupin : The Tales of the City are a realistic fairy tale
Armistead Maupin, born in 1944 into a traditional, conservative North Carolina family, became known in the 1970s as the author of the internationally acclaimed Tales of the City and, along with Harvey Milk, as one of the leading voices for the gay community.
The Tales are the serialized stories, from the 1970s to the 2000s, of residents of a San Francisco boarding house, some heterosexual, some homosexual, who become friends, grow closer or separate, under the rule of a debonair and whimsical landlady. The novels, of which there are nine to date, deal in a light, humorous but also tragic way with the joys and sorrows, and in short, with life itself, of this small but endearing world. Over a period of more than thirty years, we pass through the post-Woodstock era of sexual liberation, that of the deadly AIDS epidemic and finally that of dating applications and online dating.
As part of the America Festival, Zone Critique met the founder of 28 Barbary Lane.
- You are invited to the America Festival, which celebrates American literature. France was a little late in discovering you (in the late 90s) but your work has been a great success. What does French culture mean to you?
It is apparent that French readers love reading and revere authors. So I am delighted to come here and meet people who really care about my work and literature in general. It is always flattering and a source of mutual enrichment. That is not true in America. The status of authors and the reverence they can be accorded differ from one side of the Atlantic to the other. That is what I like in France.
- You are mainly known for Tales of the City. While this series of novels was one of the spearheads of the struggle for gay rights, it has since moved beyond that to become a literary work in its own right. Is this not the victory of normalisation? Not being pigeonholed.
Yes and it did not come right away, I had to wait for a long time to convince people that I was not writing for a niche or a community but for the world at large. I have always been doing that. When I wrote for the newspapers, that was my intention to tell a story where everybody can be involved in. It does not mean that I do not want to deal with gay matters or that I would repudiate in some sort what has been considered as the great struggle of my life but it has to include everyone.
- The Tales originally appeared as a serial in the San Francisco Chronicle, for which you wrote as a journalist. How were they received when they were published in 1976?
They were received with horror, amusement and also delight. Gay people couldn’t believe they were reading about their own lives in the newspaper. It was quite exhilarating to know that people were waiting for the next episode. Even those who were slightly horrified by the gay content could not stop reading. And it strucked me that the most radical act I could commit was to keep them in suspense. Wilkie Collins, the great British serialist, had this credo : ‘make ’em cry, make ’em laugh, make ’em wait’. And that’s what I was doing.
- Did you realise very early on the potential of your work for changing mentalities, especially in a difficult context (after the Stonewall riots, during Anita Bryant’s Save our Children campaign…)?
I realized as soon as I wrote the Letter to Mama, because it was actually my letter to my parents. I knew this event, the Save our Children campaign, had a certain political strength and this letter was a kind of a cold-blooded anger against Anita Bryant. But I could do it in a context of an amusing story.
- We talked about not being pigeonholed. Do you think that defining your work as engaged literature (not only for gay rights but for tolerance in general and the right to be different, I’m thinking for example of Maybe the Moon) would be too reductive? Can or should literature be committed? Or does it exist by itself, depending on the interpretation of the readers?
I was just guided by what I wanted to write about, I have always been governed by that. When I imagined a friendship between this 31 inch dwarf actress and a gay writer in Hollywood, I wanted to tell a story and that’s how Maybe the Moon came about. It had the same effect on little people in America than Tales of the City had for gay people. They saw their lives recreated sympathetically for the first time. But I don’t have some high-flown concept of myself, this is my duty to do these things and to write what I consider as just a good story. And I came to Tales of the City, which is a story that I wanted to tell affectionately and truthfully.
- The time of writing is the immediate present. Can we say that your story, your characters and even your style have evolved along with the times? At the beginning of the first volume, the theme of homosexuality is not yet omnipresent, as if it was still difficult to deal with this subject at the time (for instance, the main character at the very beginning is not Michael Tolliver, the gay hero, but Mary Ann Singleton, an inhibited young girl form Cleveland).
I had to do it that way because it was published in a newspaper, I couldn’t press my luck too much ; otherwise, the editorial staff could have shut it down. It was a risk. But later, I wrote Michael Tolliver lives, and that was my way of saying « this is about a gay man, story told in the first person etc. ». So my style did evolve over the years, while mentalities were also changing in parallel.
- We learn in your memoirs, My Logical Family, that you come from a conservative family and that you shared or pretended to share your family’s ideals during your youth. Coming to San Francisco kind of liberated you. How do you explain this influence on the frustrated young man you were?
I was given free access to dick for the first time in my life. I tried to use that turn of phrase yesterday at the conference, when I said ‘I followed my dick around San Francisco’ and my translator was quite embarrassed. He finally translated into ‘I followed my instincts around San Francisco.’
It was that simple, actually. I had the relief of being able to hang out with affectionate men and that was the most amazing thing in the world. Also, that made a political cause for me. It would not have happened during my early days in Raleigh, North Carolina.
- We also learn that you met Richard Nixon, who received you as a young veteran of the Vietnam war. Did you suspect at the time that this was a communication strategy to show the war in a better light to the population?
That was not the Dick I was referring to! It was clearly a propaganda effort on his part, to make it look like young men were supporting the war. So he invited these ten Vietnam veterans to the Oval Office. Immediately, I realized that he was deeply insecure, he was sweating profusely. When he finally fell at ease, he started telling stories about women and how sexy young Vietnamese women were. He did it with the only cocksucker in the room : me ! He was just ridiculous. I saw him as who he really was.
- Can we finally say that San Francisco, which is omnipresent throughout the novels, is the main character of your work?
I won’t say that now because I haven’t lived in San Francisco for three and a half years. I live in London now. And I am writing about English themes in my next Tales novel, which is an interstitial novel which fits into the middle of the series. It involves Mona Ramsey’s times in an English manor house. Yes, I suppose you can say that but Maybe the Moon was set in Los Angeles. San Francisco is definitely a character in the Tales, there is no question about it.
- You write in your memoirs that San Francisco has changed, that it has become touristy and unaffordable. Do you feel nostalgic for the old San Francisco of your youth?
I think everybody feels nostalgic for their youth. I had a wonderful time there and made some wonderful memories but I don’t need to live on that, for whatever time I have left. It’s behind me and we live in a different time now. But it is true that San Francisco has lost some of its magic because of the reign of the money king that has affected the whole of America. My story, in Tales of the City, takes place in the Russian Hill area. During the 70’s, you didn’t need to be wealthy to start a life there. One of my characters, Brian, who resides at Barbary Lane, a fictitious address in the Russian Hill neighbourhood, is waiter in a bar ; nowadays, he could’nt afford to pay the rent.
- Your arrival in San Francisco and then your writing of the Tales helped you to come out. We talked earlier about the famous Letter to Mama. Was the writing process a catharsis, that allowed you to give birth to your true personality?
Yes ! There’s no question about it. I was writing about my own life sometimes ; thus, something happened to me one night in a bar and the next day, it was in my story in the newspapers. So it was a good way to sort out my feelings. You mentioned the Letter to Mama. I must say that I am proud of its impact, which I did not foresee at all at the outset, and of the result it has had on gay people who have been able to find the strength to come out of the closet thanks to it. It’s even been read many times in public, including by my friend Ian McKellen. So what I wrote freed me, and freed many other people, even if it wasn’t intentional at the beginning.
- Two of the main characters, Mary Ann Singleton and Michael Tolliver, are naive young provincials who gradually gain confidence and dare to assert their personalities. Is there any of you in either of these characters? Perhaps more in Mary Ann’s character, who has her share of secrets, whereas Michael is more like an open book?
Michael was what I was becoming, Mary Ann was what I had been. I have a real affection for her. She was me when I started to write the first chapters : a quite uptight and naive young lady coming from Cleveland, Ohio (I was from Raleigh, North Carolina) who didn’t know much about life yet. Once in San Francisco, my gay life was flourishing little by little and I became more like Michael, this cheerful young man seeking for the love of his life.
- Michael Tolliver lives is, in the whole series, a different opus: it is the only one written in the first person singular, by Michael’s voice, thirty years after the beginning of the Tales. The story describes an ageing Michael, in his fifties, plagued by self-doubt and reassured by finding love in the arms of a young man twenty to thirty years his junior. Does this novel have a special place in your eyes and your heart?
Definitely ! Because all the things were true of me. I had met Christopher Turner, who was thirty years my junior, like Ben, who is Michael’s husband. I wanted to celebrate everybody who’s still there, who made it through the AIDS crisis, which has been a tremendous trauma. Even those who, like Michael, are still ill. In some ways, it was my more personal novel, the one I put the most of myself into. Michael has aged, has become a bit chunky, less self-confident due to age and health reasons. Even if he has found true love, he is still vulnerable and I highlighted this fragility in this novel.
- Michael is a bit overwhelmed by the new issues in society (transgenderism etc.). And yet, you have been a pioneer in dealing with such questions. Thus, the Anna Madrigal character, the motherly and well-intentioned landlady who owns the 28 Barbary Lane, had been a man beofre her sex change and she’s maybe one of the first important transgender character in the history of modern literature. Isn’t that contradictory ?
In the story, Michael picks up a guy in a bar and he thinks he’s a man, but actually he has no male genitalia. So he has to deal with it but I think he dealt with it very well. That was new stuff to me when I first started writing on trans males in the City and in order to undertsand better, I began to ask questions to my barber, who was trans. So I asked him one day if I could go to lunch with him and ask some personal questions on that matter. I have always tried to let my heart be opened in every turn, whatever comes along. Anna Madrigal says : ‘you don’t have to keep up, darling, you just have to keep open’. That was my instruction to myself.
- Michael also describes the existence of the gay community in the age of the Internet, of dating apps. What does this reveal about our society? Have human relationships changed irrevocably? Have they become artificial? Are you pessimistic?
I don’t want to think about it, it exhausts me! Technically, anything that happens on the Internet is slightly confusing to me. I think it is wonderful for people to find new ways to meet each other. My husband founded a website called DaddyHunt, a site for older men and younger men looking for dates etc. We do what we can do. I don’t have any big pronoucement to make, I don’t think it is bad or not, it is a tool and you have to be very careful about how it’s used. People tend to fall in love with total strangers without spending any time with them… And that is a big change from the time I knew. On the one hand, it is easier to meet new people, without even having to leave home, but on the other hand, it is dangerous because you don’t know exactly who you’re gonna meet.
- There is indeed a gap between generations. May we say that ancient and new generations live in separate worlds? How can we still understand each other and talk to each other?
I got a big laugh from my personal experience when I said : ‘I don’t know about these young people with their apps. When I was young, I had to walk ten miles in the snow just to suck a cock !’. That was my way of saying we can’t fall in that trap of distrusting the new generations. Everybody is dealing with what they’ve got in hand. I have no judgement to make on that.
- The French writer and academician Dominique Fernandez, born in 1929, published two novels this year entitled L’Homme de trop (The Man who is too much). He is torn between the happiness of noting the considerable progress in morals, and the regret and melancholy of seeing how gays, once a living force of protest in society, are gradually becoming gentrified in the comfort of freedom. What do you think about this?
I’m not quite sure what his point of view is but I don’t believe for a second it was better before, if he really meant that. He may have simply meant he could hide better before, that gay people in the closet could swip with the straight men and few other outdated concepts I don’t agree with. Again, it’s just the world we have today. It wasn’t better when people were getting killed because of their sexuality. Some people are missing their past but it has always been the case.
- The French translation of Tales of a City is Chroniques de San Francisco. The French title insists more on the temporal aspect than on the narrative aspect, un like the original version. Do you regret this? Can your novel be described as a modern, realistic fairy tale, describing a place (28 Barbary Lane) as a kind of cocoon where everyone would like to live?
Yes, this fairy tale aspect was totally intentional because my story is in some way a tale yet realistic. It deals with the fact of life, so it’s not disconnected from reality. But we can indeed say that 28 Barbary Lane is a cosy place where everybody feels secure an at ease with their feelings they can express freely. I don’t know why the French edition did not translate into ‘LesContes de la Cité’ or ‘Les Contes de San Francisco’. It’s ironic because my stories appeared in the San Francisco Chronicle, maybe it’s a nod to the newspaper. We have to deal with it.
- The great threat is of course the AIDS epidemic, which marks the end of carefree living. Your novels were written before, during and after the epidemic. You chose to show this disease in its horror (the successive deaths of many characters, Jon Fielding’s agony…) and to evoke its consequences in everyday life (Michael has caught HIV and is overloaded with drugs, which has consequences on his health). Was it important for you to show this disease as it really is? How did you overcome the problem of portraying it in your work at a time when it was a shameful disease that supposedly only affected gay men?
First of all, I never considered this as shameful but I had to write about it because I had lost a dear friend to AIDS in 1982 and I wanted to make my pain felt on the page. So I killed off a main character, Jon Fielding, and a lot of secondary ones to make the readers feel some fictional grief that corresponded to what I was feeling. That was intentional and I knew it was a risky thing to do because I had to keep the audience amused in the daily newspaper. But I thought it would have been irresponsible not to do or say anything about this tragedy.
- Our magazine has dedicated its latest paper issue to family. You make a distinction between biological and logical families (which is the title of your memoirs). What is more precisely your conception of family? Can it be chosen on the basis of particular affinities?
A logical family is a kind of family people make nowadays. Some people are attached to biological connections and family roots, I am not any more. I have a sister that I love dearly and we’re still connected. My brother is a Trump idiot, we are not talking any more and I don’t care. It’s just about the family you make for yourself, everybody has one, gay or straight. It happens quite commonly nowadays.
- Nevertheles, you succeeded in reconnecting with your parents, notably your very conservative old father when you visited him for the last time with your husband, as well as Michael when he visited his once estranged mother on her deathbed. There may be still hope, even when families have dificulties to keep united.
I don’t discourage anyone from trying to make connections with their biological families. In my personal case, that was a long time ago, both my parents are dead, my brother, once again, is an idiot and so, there is no one left to connect with. And I am happy to have a very strong logical family that sustains me in a big way, the only way, really. I just don’t want to see people trying desperately to maintain a love over a family who does not accept and love them for who they are. It’s pretty simple. If you’re a free spirit, if you own your proper life, you don’t have to put up with that kind of shit.
- Tales sometimes end badly. Although the humorous tone predominates in Tales of the City, there is also a very strong tragic side. One can think of the insurmountable incomprehension between members of the same family (Michael’s for example, who does not understand and chooses to ignore his homosexuality despite his letter) and the resulting impossibility to communicate.
I wanted readers to feel both sides : the light-hearted tone and the sad aspect of life. I wanted there to be joy and laughter as well as the tragedy of life. I tried to cover all the territories. Even in Michael Tolliver lives, he can’t quite connect with his dying mother but she still has with her this picture of Michael and his husband. It helps him and shows him that he has free way to lead his life as he wishes. So there is still hope, indeed.
- How do you view the series that were adapted from your novels in 1993 and 2019? You have developed friendships with the actresses Laura Linney and Olympia Dukakis for example.
I am particularly happy with the series because they brought Laura and Olympa to my life in a big way. Laura named her son Bennett Armistead, I was very touched by that and I’m so proud. It brought a lot of wonderful people into my life. Besides, the adaptations are pretty faithful to the novels, especially the first one, which was British. The latest one, on Netflix, was written by a young team of queers, so everything you can name in queer life was represented in that team. So they brought a lot of interesting informations into the story. They changed a few things that were not especially right to me but I knew I had to let go to see this thing happen.
- You often mention the writers W.H. Auden and Christopher Isherwood in your memoirs. Were they masters of thought?
Yes,I think so, in some sort. Auden to a lesser degree but still a model. Isherwood, with whom I became friend, was who I wanted to be. He was in a relationship with a younger man, the painter Don Bachardy who is still a friend, and I myself am with a younger man who is photographer. And it’s ironic because Isherwood moved from Britain to America and I am going the other way around.
- Finally, if you were to look back over the last forty years, what would you say? Are you optimistic or pessimistic about the future of gay community? Is there still work to do on mentalities ?
There is still work to do, of course. We’ve come a long way but we need to defend our trans brothers and sisters, whose rights are still not secured, especially in Britain where there are people called Trans Exclusionary Radical Feminists. I don’t know how there can be possibly such a thing. For example, they don’t want to see trans women in their toilets. It’s such a primitive way of looking at things. It’s unkind and it doesn’t take into account the great contributions of trans people from the very beginning of our movement. That’s where I’d like to see promises being made.
Entretien mené et traduit par Guillaume Narguet
Crédit photo : © Guillaume Narguet