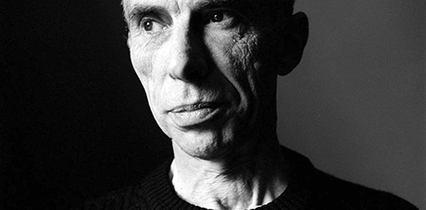« Je n’écoute pas ce que disent les critiques d’art. Je ne connais personne qui ait besoin d’un critique pour savoir ce qu’est l’art. », dit Jean-Michel Basquiat. Trente ans après sa mort, la Fondation Louis Vuitton nous propose jusqu’au 14 janvier une rétrospective de l’un des plus grands peintres de la fin du siècle dernier. Images fugaces, mots, poésie, rythmes, une exposition qui se voit, s’écoute, se vit.

Un événement. Le mot est sur toutes les lèvres, et c’est peu dire, voici presque une décennie que la France n’avait pas accueilli une telle rétrospective de l’œuvre de Jean-Michel Basquiat. Un retour en force, quatre niveaux lui étant consacré, balayant l’ensemble de la courte – mais prolifique – vie artistique du peintre new-yorkais.
Ambiance et espace
Dès la première salle on est frappé par la sobriété de la composition, une philosophie de la simplicité
On entre timide et inquiet dans les grands espaces blancs, entrecoupés quelques fois de tableaux, sous de hauts plafonds. Le silence et l’espace. Dès la première salle on est frappé par la sobriété de la composition, une philosophie de la simplicité : les encadrés ne se perdant pas en interprétations fantasmatiques et en circonvolutions excessives accompagnent un nombre réduit de toiles, imposantes et doublées à bon escient de claires explications. On perçoit rapidement le fil conducteur, les obsessions qui rythment la vie de l’artiste, la vie de l’homme, les points de tangence. Des couloirs exigus, on monte les escaliers, l’espace devant nous d’arbres et de tours, un bassin frissonnant sous la pluie, du petit carrelage, puis de nouvelles salles, du blanc encore, une variation gracieuse des espaces. On se laisse guider par une scénographie immobile de figures picturales. Le spectateur se retrouve face à un ensemble de notes, on lui laisse la liberté du tempo, habilement guidé dans l’agencement par des explications qui évitent la lourdeur il compose un dialogue qui se veut personnel avec les œuvres de l’artiste, mises en abîme dans la relation visuelle, physique, lumineuse qu’on entretient dès notre entrée avec l’ouvrage. On est enveloppé sans pour autant s’y sentir oppressé. Une atmosphère qui nous porte jusqu’aux dernières salles, tout s’accélère, l’Afrique, Warhol, la ségrégation et la musique, le tempo encore, et le spectateur ravi, jusqu’à l’écriteau de fin d’exposition, se laisse porter par une symphonie cohérente : l’héliocentrisme artistique du génie, l’épuisement de quelques thèmes – les variations sensibles d’une rapide mais mature évolution – la tension croissante, l’explosion d’un orchestre de couleurs et de message, puis le silence. Il n’y aura pas de retour, on ne rejouera pas un mouvement, et c’est suffisant comme cela. Le message est passé.
Rage et langage
« Je ne pense pas à l’art quand je travaille, je pense à la vie »

La vie, Basquiat en a fait une courte expérience, 28 années pour faire table rase de l’art contemporain. Une expérience furtive, mais chez l’enfant de Brooklyn, il semble que l’important réside dans l’exercice qu’il a fait de celle-ci. L’interrogation de l’identité – son identité, puis celle de ceux qu’il côtoya à Brooklyn – est un thème récurrent dans sa démarche artistique. Né d’un père haïtien et d’une mère portoricaine, dans le cosmopolitisme et la précarité du Brooklyn des années 1960, Basquiat fait rapidement l’expérience de la différence, et du questionnement de son identité. Père francophone – il porte d’ailleurs lui-même un prénom et un nom français – et une mère hispanophone, noir de peau dans une société anglophone marqué par la ségrégation et les plaies encore vives de l’esclavage – qu’on retrouve dans Slave Auction, où les visages effarés d’esclaves sans noms et mis à la vente traduisent à la fois la cruauté de cette époque et le fait que la culture afro-américaine y a survécu – le graffeur des rues lépreuses de Manhattan, qu’il taillait à vif d’un SAMO©, « SameOld shit », va rapidement prendre conscience de la nécessité de traduire et transmettre l’exercice qu’il fait de l’altérité. Il va chercher à se démarquer conceptuellement des jeunes artistes alors fleurissant à New-York en changeant de paradigme : le mot prend le dessus sur le dessin, l’écriture est érigée en valeur esthétique de premier ordre. La poésie prend place sur la toile, et prend sens quand elle devient une manière d’enrichir la toile, une poésie des mots, mais également un ensemble de composantes sémiotiques appartenant à la gestuelle : les rythmes, les postures, un pont entre l’Afrique noire, le blues et le jazz afro-américain des années 1960 et la culture Hip-hop et underground de New-York dont il est l’un des précurseurs. Toujours dans le rythme, Basquiat va produire une série de tableau sur le jazz, rendant hommage à Charlie Parker ou à Dizzy Gillepsie, il nous rappelle aussi que dans sa peinture comme dans le jazz, la composition – indissociable de l’improvisation – renvoie inévitablement à une nécessité de structure et de rythme, et à quel point l’artiste se doit de conserver cette cohérence sous-jacente à toute fulgurance.
Basquiat c’est le langage du corps et du mot, de la couleur également, avec le frappant Boy and dog in Johnnypump (1982), où les couleurs se superposent, se recouvrent, créant cette impression d’espace, de perspective, tout en densifiant chaque centimètre de la toile. La tension navigue dans un ballet de tonalités froides puis chaudes, le noir au centre, un surgissement violent, taché de rouge, un squelette noir, contrepoint violent dans un ensemble doux, un mélange multicolore et enfantin.
Une décennie, mille toiles et deux mille dessins. Il faudra plus d’un article et d’une exposition pour comprendre Basquiat, la fulgurance et la souffrance, la poésie d’Haïti et de la rue, une altérité toujours rejetée et cultivée.
La rage de vivre, et le mélange des styles, un désordre où se côtoient Matisse, les collages de John Dos Passos, le deejaying underground new-yorkais et le pop-art de Warhol, avec lequel il collaborera quelques années, produisant des toiles étranges et envoûtantes qui capteront le spectateur en fin d’exposition. Plutôt qu’un autodidacte sauvage, il faut voir dans Basquiat un papier buvard toujours assoiffé, se nourrissant de ce qu’il voit et vit ; le Grillo de 1984 fait la synthèse d’une passion religieuse pour le vaudou, de son histoire de noir natif de Brooklyn mâtiné d’afro-américanisme et d’influences occidentales. D’autres toiles mélangent quant à elles société africaine « primitive » et société de consommation américaine, s’y rencontrent marques, statuettes et toujours les mots.
Une décennie, mille toiles et deux mille dessins. Il faudra plus d’un article et d’une exposition pour comprendre Basquiat, la fulgurance et la souffrance, la poésie d’Haïti et de la rue, une altérité toujours rejetée et cultivée. Cette exposition est une porte d’entrée dans son univers, la possibilité de continuer l’expérience et de s’interroger, à l’aube de ce siècle, sur les questions de l’identité, de la (post- ?) consommation et de l’art ; la fonction sociale de l’artiste à un moment où semble primer l’efficacité et la rationalité maximisatrice de profit. Jean-Michel Basquiat est emporté par une overdose le 12 août 1988, laissant l’art contemporain orphelin d’une figure, il lui offre l’éternité rimbaldienne de la jeunesse et du renouveau.
- Jean-Michel Basquiat, Fondation Louis Vuitton, jusqu’au 14 janvier 2019.