
L’œuvre de Boris Pahor, c’est aussi un récit de la survivance, un témoignage de premier plan sur l’horreur des camps de concentration. Boris Pahor en a connu cinq : Natzweiller-Struthof (le seul camp de travail et de concentration de France), Dachau, Dora-Mittelbau, Harzungen et Bergen-Belsen. Il a su mettre les mots sur cette expérience indicible, dans son classique Pèlerin parmi les ombres (Nécropole dans son titre original). Une seule question : Comment avez-vous survécu, du 28 février 1944 (date de la première déportation à Dachau), au 16 avril 1945 (date de votre libération) ? Puis les souvenirs défilent, grâce à une mémoire sans faille. C’est son expérience de presque deux ans dans les camps de la mort que Boris Pahor partage aujourd’hui avec Zone Critique.
« Nous devrons tout faire pour que le monde ne tire pas un rideau d’oubli sur ce qui s’est passé. » (in Le Berceau du monde)
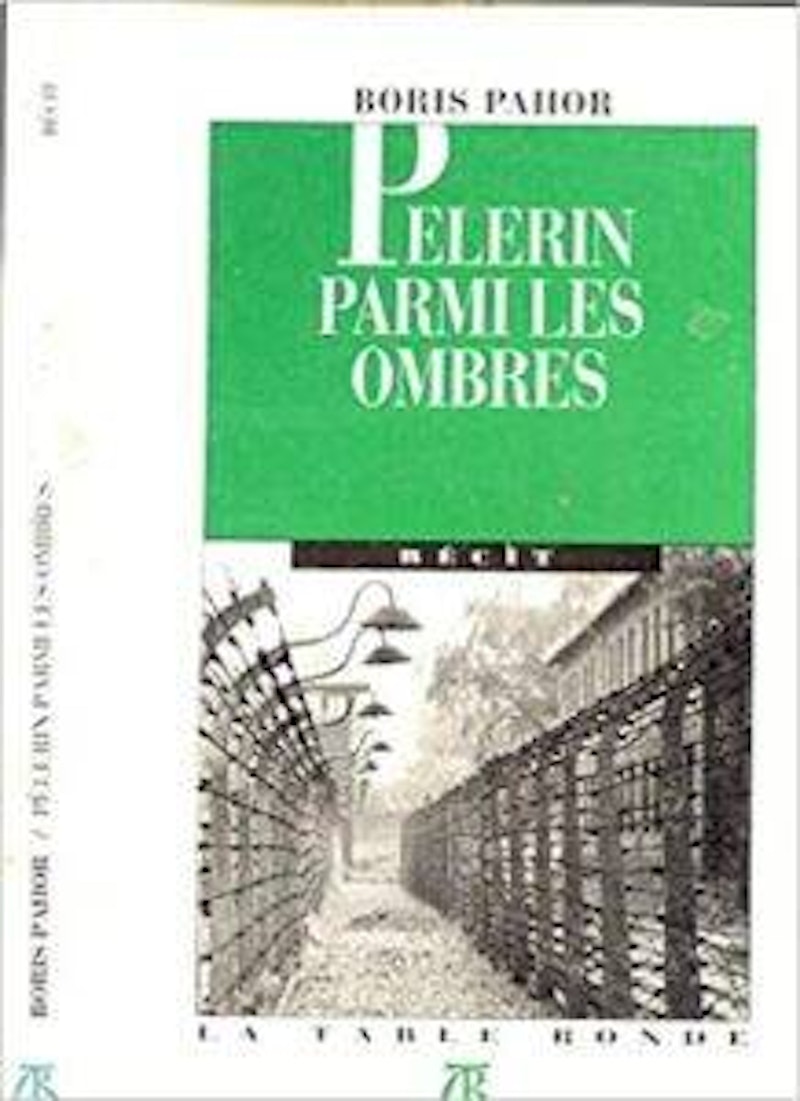
« On afflue de tous les pays d’Europe sur ces terrasses de montagnes où la méchanceté humaine, marquant la mort du sceau de l’éternité, a triomphé de la souffrance humaine. Ce n’est pas la sublimation miraculeuse de leurs désirs qui attire les pèlerins d’aujourd’hui ; ils viennent ici fouler un sol véritablement sacré et s’incliner devant les cendres de leurs semblables dont la présence muette marque dans la conscience populaire une borne inamovible de l’histoire humaine. » (in Pèlerin parmi les ombres, 1990).
« C’était une sorte de boucherie»
Dans ce livre, mon témoignage débute au camp de Natzweiler-Struthof, en Alsace, où j’ai été déporté après avoir été dénoncé par des fascistes slovènes en 1943, puis détenu par la police secrète allemande à Trieste et envoyé une première fois à Dachau.
Au Struthof, les déportés étaient pour la plupart des « triangles rouges », des détenus politiques, des résistants de toute l’Europe et des prisonniers de droit commun. Il s’agissait d’un camp de concentration de travail, c’est-à-dire que nous étions tous destinés à mourir de faim et de fatigue, du fait d’un travail incessant, qui commençait le matin à 6h et se terminait à 17h, avec une pause entre midi et 13h.

Nous étions sans cesse contrôlés dans notre travail et s’il arrivait qu’un prisonnier tombe pendant son service, il fallait immédiatement qu’il se relève et reparte à la tâche, sinon les kapos le rouaient de coups de bottes pour le contraindre à travailler encore. Ceux qui ne pouvaient plus exercer leurs tâches étaient tassés dans les baraques où on les laissait mourir. Si un prisonnier mourait à la tâche, il était de suite remplacé.
Nous n’avions alors qu’une soupe pour tout déjeuner et un morceau de pain à 17h. Je me nourrissais aussi en extrayant le sucre de pommes séchées. Ce « repas » n’était bien sûr pas suffisant et cela provoquait des pertes de poids dramatique. Nous étions en sursis, cela n’incitait bien sûr pas l’administration des camps à nous fournir de la nourriture suffisante pour travailler.
Quand j’ai écrit Pèlerin parmi les ombres, je me suis rendu compte que peu de Français connaissaient l’existence de ce camp. Le Struthof n’était pas très grand. Il se trouve à 800 mètres de hauteur, à 8 kilomètres de la gare de Rothau. Il fallait s’y rendre en voiture ou en bus, et à pied pour les déportés et pour ce faire, nous devions emprunter des escaliers dans la montagne. Il était en effet construit en gradins et les baraques des prisonniers étaient situées autour de deux escaliers de granit. Plusieurs fois par jour, nous devions nous rendre sur la place centrale, dite l’Appelplatz, qui dominait les baraques et où avaient lieu des exécutions.

C’était également un endroit où l’on expérimentait des recherches sur les corps humains, notamment par les chercheurs nazis de l’université de Strasbourg. Le but était de démontrer que les communistes et les juifs n’étaient pas aussi développés, physiquement et mentalement, que les autres hommes, surtout les aryens. C’était une sorte de boucherie. J’y travaillais en tant qu’infirmier, j’étais donc en quelque sorte aux premières loges de cette boucherie. J’avais d’ailleurs sur moi une petite médaille de la Madone, que ma mère m’avait confiée, et je priais en me disant que je sauverais pour me rendre en pèlerinage dans les Alpes juliennes, au Chemin céleste[2].
Mais c’est justement parce que j’étais infirmier que j’ai pu survivre. Mon travail n’était pas aussi harassant que pour les autres, qui devaient casser des pierres dans la carrière pendant des heures, bien souvent dans le froid et sous la neige. L’hiver, il pouvait faire jusqu’à -20 degrés.
Comment êtes-vous devenu infirmier ?
Je m’étais, à un moment donné, blessé la main gauche, qui s’était infectée. Le chirurgien belge (un autre déporté), avec qui je m’étais lié d’amitié et qui s‘appelait Georges Bogaerts, m’avait fait trois incisions dans la paume. Je dus alors porter un bandage en papier crépon, que j’ai gardé longtemps afin d’éviter d’être enrôlé par les kapos pour travailler dans la carrière et que j’ai porté comme s’il s’agissait d’un enfant. J’ai conservé ce pansement tant que j’ai pu, jusqu’à ce qu’il pourrisse, toujours pour éviter la sélection pour le travail. Le typhus s’était déclaré au même moment et nous étions en quarantaine, ce qui m’a permis de repousser encore plus le moment fatidique. Nous craignions par-dessus tout cette maladie car les symptômes étaient terribles et l’issue en était la plupart du temps fatale.
Le docteur Jean s’est moqué gentiment de mon pansement, en me disant que ce n’était pas normal d’avoir un pansement aussi décomposé, ce à quoi j’ai répondu : « Mais qu’est-ce qui est normal dans un tel endroit ? ».
Au bout d’un moment, un jeune docteur français, appelé Jean, nous a examinés. Nombreux étaient les malades qui, pour se faire soigner, faisaient la queue dans ces baraques qu’on appelle également blocs. Les blocs des malades étaient des « reviers » (il y en avait alors huit sur les seize blocs que comptait le camp). Le docteur Jean s’est moqué gentiment de mon pansement, en me disant que ce n’était pas normal d’avoir un pansement aussi décomposé, ce à quoi j’ai répondu : « Mais qu’est-ce qui est normal dans un tel endroit ? ». Il a changé mon bandage et s’est étonné que je parle aussi bien le français car pour lui, j’étais citoyen italien. Je lui ai rétorqué que j’étais un cas assez particulier : un Slovène d’Italie. Ma nation était d’abord la Slovénie (bien qu’elle n’existât pas encore), qu’on partageait avec les Croates et les Serbes, qui eux-mêmes parlaient deux langues. Je pratiquais donc le slovène, l’italien, j’avais quelques notions de croate qui m’avaient servi pendant mon service en Afrique et j’avais appris le français lors de mes études à l’université de Padoue, où j’avais étudié Baudelaire.
– Mais alors, s’il se présente un régiment de Slaves, de Polonais surtout, de Tchèques, de Russes, tu saurais les comprendre ?
– Mieux que toi, certainement.
Puis il s’est intéressé à mon niveau d’allemand. « Ici, il faut savoir l’allemand, car sans cela, on ne peut pas s’en sortir ». Je n’avais qu’un niveau d’allemand scolaire, je le lisais et l’écrivais comme on l’avait pratiqué à l’école, à Trieste. Mais mon professeur était un vieux monsieur déjà à la retraite, qui n’avait pas pour principal souci de nous enseigner correctement l’allemand, alors qu’à Ljubljana, les Slovènes étaient nombreux à pratiquer cette langue, car le pays avait été sous domination autrichienne pendant des siècles. Tous les intellectuels le connaissaient.
« L’important, c’est que tu saches l’écrire sous la dictée ». Nous parlions de tout cela alors que les malades se bousculaient en nombre pour être examinés. Il avait pensé à moi pour seconder le médecin chef du revier, le docteur norvégien Leif Poulson, un homme très chic, qui, lui, ne savait que l’allemand et l’anglais.
Quinze jours après, alors que j’étais dans le bloc en train de manger ma soupe, le docteur Leif, qui me cherchait depuis quelque temps, m’a appelé. J’ai alors dit « hier ! » (ici, en allemand) et il m’a ordonné, de mauvaise humeur car j’avais mis du temps à répondre, de me rendre à la direction du camp pour servir d’interprète au personnel administratif. C’est comme cela que je suis devenu infirmier et traducteur. On peut dire que mon don pour les langues m’a aussi sauvé.
On peut dire que mon don pour les langues m’a aussi sauvé.
On m’a très vite présenté à un autre médecin français, André Ragot, avec qui je rendais visite aux malades. Il y avait ceux qui étaient atteints de dysenterie et qui se vidaient de toute substance sous nos yeux, ceux qui avaient du mal à manger le pain qu’on leur donnait la journée et qu’il fallait aider à faire passer avec de l’eau froide, ceux qui mouraient lentement et qu’il fallait accompagner… Alors on les réconfortait, si possible dans leur langue. Puis on habillait leur cadavre et on les emportait le plus délicatement possible au four, qui se trouvait derrière le camp, après des escaliers en pierre.
Le départ vers Dachau
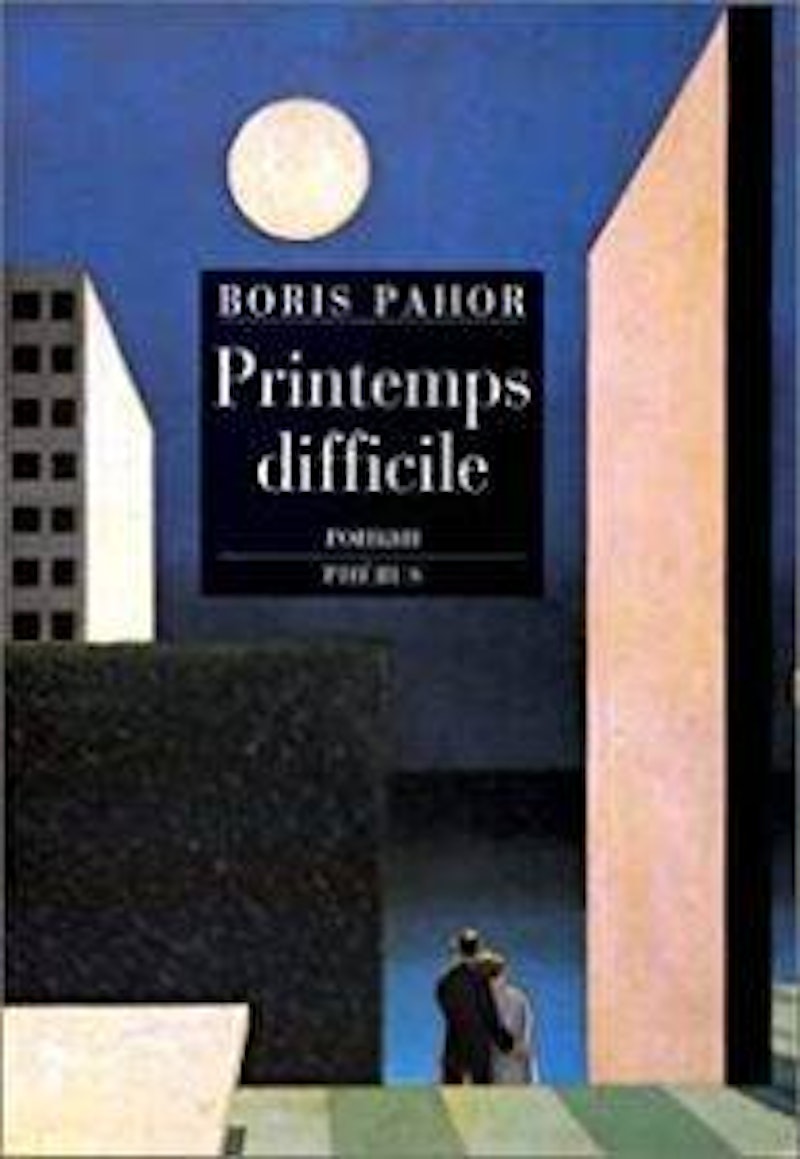
Devant l’avancée des Alliés, les Allemands ont décidé de vider les camps. Pour ce faire, les déportés ont dû descendre la montagne à pied. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer ont été transportés par camion, puis nous avons tous été entassés dans des wagons à bestiaux. Le train s’est rendu d’Alsace à Dachau, on a traversé toute l’Allemagne pendant des jours, peut-être six ou sept. Tous les malades se tassaient dans le train et n’avaient qu’une couverture par-dessus leur chemise de toile courte pour survivre au froid et à la neige.
« Un après-midi, nous traversions Niedersachswerfen au retour. Les rangs traînaient péniblement leurs jambes enflées, quatre gars portaient un corps inconscient qu’ils tenaient chacun par un membre sur leurs épaules courbées laissant pendre le corps comme une grande araignée. C’est alors que deux filles passèrent dans la rue silencieuse et blanche d’hiver sans jeter le moindre regard à la colonne qui marchait d’un pas lourd ; or, il était impossible qu’elles ne voient pas les galoches qui dépassaient des épaules des premiers. Non, elles ne remarquèrent même pas la longue procession des six cents habits rayés ; comme si la rue était vide et qu’il n’y avait rien dessus excepté la neige sur les pavés et les trottoirs. Cela veut dire qu’il est possible d’inoculer aux gens la négation radicale des races inférieures, que deux fillettes par leur froideur peuvent annihiler une procession d’esclaves et marcher sur le trottoir comme s’il n’y avait autour d’elle que la neige dans une atmosphère paisible et ensoleillée. »
Une fois arrivés, nous passions à la douche. Ceux qui tenaient encore debout devaient se laver avec du savon ordinaire jaune, couleur urine de cheval, et qui sentait très fort ; ceux qui n’avaient pas la force de se relever restaient couchés à attendre l’eau.
Sur le moment, personne n’a conscience que la salle de bains est située juste au-dessus du four dans lequel, nuit et jour, le chauffeur dispose des bûches humaines.
« Quel plaisir pour les corps léchés par ces nombreuses langues chaudes ; sur le moment […], personne n’a conscience que la salle de bains est située juste au-dessus du four dans lequel, nuit et jour, le chauffeur dispose des bûches humaines. Et même si les corps pensaient qu’on allait prochainement chauffer l’eau avec eux, grande serait encore la jouissance que leur procure la chaleur humide. Alors ils se hâtent de se savonner et leur pubis ne brûle plus ; même les dents de ceux qui sont allongés sur le dos à même le ciment claquent plus lentement. […] Un corps voûté est accroupi sur le ciment à côté d’un corps étendu, l’eau ricoche sur leurs crânes lisses comme sur des têtes de pierre au centre d’une fontaine romaine et un ruisseau jaune coule sous le corps allongé. »
Là encore, on devait travailler la pierre dans des carrières et des tunnels. J’y ai d’ailleurs retrouvé des Slovènes déportés, quelques-uns travaillant dans les bureaux de l’administration de Dachau. Certains de ces Slovènes ont enduré les Procès de Dachau après la guerre[3].
J’y exerçais toujours en tant qu’infirmier. Comme au Struthof, la dysenterie faisait des ravages. On nous donnait des cuillères de charbon pour limiter la diarrhée, et de la poudre blanche, qui avait un goût de craie. Il s’agissait en fait de sulfamides, qui servaient de tests pour de nouveaux médicaments. Parfois, on m’en apportait pour que je puisse soulager certains détenus.
« Sur la table, près de la fenêtre, il y avait le thermomètre, une boîte de poudre blanche et une boîte de charbon en poudre. C’étaient les médicaments de la chambre. Trois fois par jour, je mélangeais la poudre blanche à de l’eau pour fabriquer un plâtre mou. J’allais de lit en lit et j’introduisais une cuillerée de ce mélange blanc entre les lèvres desséchées, entre les dents jaunes à demi écartées. Certains malades saisissaient voracement le mortier blanc de la cuillère avec leurs dents pour retenir la vie qui s’écoulait d’eux sur la paillasse ; d’autres n’avaient plus conscience de la cuillère devant la bouche, pourtant, même faiblement, ils faisaient claquer la langue en déglutissant le mélange collant. Quand ils rendaient l’âme, ils avaient du ciment blanchâtre sur les dents et tout autour des lèvres. Ou bien c’était la distribution du charbon en poudre. Produit relativement plus embêtant car la bouche le soufflait de la cuillère ou bien de la cavité buccale s’ils avaient déjà vidé la cuillère. C’était alors le jour des cadavres aux dents et aux lèvres noires, et bien qu’ils fussent tout osseux et longs, c’était le trait noir autour de la bouche qu’on voyait le plus. »
Le camp de Dora-Mittelbau

Puis on m’a transféré au camp de Dora-Mittelbau, où on avait besoin d’infirmiers. Là-bas, nous étions contraints de fabriquer des missiles V2, ces grands cigares de feu qui étaient ensuite largués en Angleterre et qui ont servi notamment au bombardement de Londres. Mais ces missiles étaient souvent sabotés de telle sorte que les avions larguaient les bombes qui tombaient sans exploser. C’est la raison pour laquelle les nazis vérifiaient très souvent si les missiles étaient viables. Des recherches très fouillées étaient menées. Quand la section où se trouvaient un ou plusieurs saboteurs était découverte, tous les membres de cette section étaient pendus. Les nazis ne perdaient pas de temps à identifier le vrai coupable. Ainsi, deux jours avant mon arrivée à Dora, on venait d’en pendre dix. Après mon départ, trente.
J’avais été envoyé travailler au Kommando[4] de Harzungen (Harz étant le nom de la montagne), un petit camp d’où l’on se rendait chaque jour sur les chantiers en train. On y allait à 8h et on revenait la nuit, parfois par une température de moins de zéro. On emportait dans la montagne des affaires, de l’essence, de l’eau, tout ce qui nous servirait au sabotage. On était sûr de notre succès et de notre organisation.
« Miran parla du travail dans les tunnels où on assemblait les fusées V2. Il décrit la tâche des infirmiers dans le ventre de la montagne, les liaisons dans la baraque, l’atmosphère sous terre où les détenus participaient au Montag des cylindres volants mortifères. Au terme d’un plan prudemment exécuté, leur sabotage qui rendait inutilisable toute une livraison de fusées réussissait parfois. Vol brisé sur la Manche. Mais suivi par une monstrueuse démonstration de vengeance. C’est ce qui s‘était passé peu de temps auparavant quand ils avaient pendu à une traverse un groupe de jeunes Russes. Ceux-ci comme d’habitude avaient regardé le cérémonial macabre avec un sourire de mépris. » (nouvelle Vol brisé, in Place Oberdan à Trieste).
Je ne suis resté à Harzungen que quelques jours, on m’a renvoyé à Dora à cause de mon hémoptysie. Puis, de Dora, on m’a envoyé à Bergen-Belsen en train, un des camps de la mort les plus connus. Le voyage a duré trois jours et quatre nuits. On y envoyait les malades et alités dont on savait qu’ils n’avaient plus beaucoup de temps à vivre. A notre arrivée, le camp était déjà plein. Dans certains blocs, on ne pouvait pas entrer car ils étaient remplis de morts. On était alors parqués dans des petites baraques.
C’est aussi le camp où a été détenue Anne Frank.
« Ravensbruck. Oranienburg. Je ne connais pas. Belsen. Celui-là, je le connais. Mais uniquement ses baraques militaires, nous n’avons même pas vu l’endroit où les restes humains se décomposaient lentement. Il semble que nous en étions très près. Mais nous avions assez à faire avec nous. Nous ne connûmes Anne Frank qu’après la guerre, il y avait alors des dizaines de milliers d’Anne. »
Nous ne connûmes Anne Frank qu’après la guerre, il y avait alors des dizaines de milliers d’Anne. »
A Belsen, ma maladie s’est aggravée. Je toussais beaucoup et crachais le sang, il s’est avéré que j’avais attrapé la tuberculose au contact de mes malades avec qui je dormais. Je souffrais également du foie. Nous avons été libérés par les Anglais le 16 avril 1945. J’y ai rencontré, à ce moment-là, un Français et un Belge, qui n’ont pas attendu les ordres et sont partis de leur propre initiative. C’est en leur compagnie que je me suis rendu à pied, bien que je fusse malade, en Hollande. On est passés en Belgique puis on a pris le train jusqu’en France, à Lille où nous nous sommes réfugiés dans un abri de la Croix-Rouge. Nous étions toujours en tenue de déportés et nous déambulions ainsi dans les rues.
« Nous nous engageons dans une rue latérale, déserte, qui monte doucement. De temps à autre, un passant solitaire arrive au coin de la rue et, à la vue des trois fantômes, retient son pas. On a l’impression qu’il va crier au secours mais ensuite, embarrassé, il cherche protection sous un porche sombre ; enfin, il accélère le pas mais il a perdu son rythme et sans doute son but quotidien. […] Rien n’est plus simple que de reconnaître le doute dans le regard des piétons, sur les trottoirs, devant une patrouille zébrée […] qui symbolise l’outre-tombe faisant le tour des rues vivantes. S’il y a un peu de joie dans les yeux surpris, ces étincelles sont en même temps captives d’une surprise gênée. Comme si se manifestait soudain une réalité sismique qui allait changer l’ordonnancement des trottoirs et des maisons. » (in la nouvelle le Berceau du monde).
C’est à Lille que j’ai appris que Mussolini et Clara Petacci avaient été exécutés et pendus par les pieds. La boucle était bouclée.
Pèlerin parmi les ombres a été publié la première fois en 1967 mais ce n’est que trente ans plus tard, à partir de 1995, qu’il a commencé à intéresser les traducteurs internationaux, d’abord anglais, puis français, allemands, etc. L’Italie n’a traduit mon livre qu’en 2008.
« Ça n’a aucun sens d’avoir le soleil, si ensuite on nous donne les crématoires. Ça n’a aucun sens de découvrir les sulfamides pour faire ensuite Hiroshima. Aucun sens. On a d’abord eu Goethe, Mozart et Beethoven, puis on a relié les livres avec de la peau humaine et fumé les pots de fleurs avec leurs cendres. Personne n’est autorisé à lever la main sur l’homme. Aucun prétexte ne peut justifier un tel péché, ni la conscience de sa propre puissance et de sa singularité, ni le bien-être de la majorité, ni la perspective des lendemains qui chantent. Il n’est pas possible d’accorder du prix au collectif et de tuer l’individu. Ce n’est pas possible. Il faut respecter l’homme. A tout prix. Voilà. Voilà la seule loi. L’alpha et l’oméga. » (in Printemps difficile).
Propos recueillis par Guillaume Narguet
[1] Camp de concentration édifié en avril 1941 après l’annexion de l’Alsace et la Moselle par le Troisième Reich. Environ 52 000 prisonniers y auraient été détenus pendant son activité. Les prisonniers appartenaient principalement aux mouvements de résistance des territoires occupés par les Allemands. C’était un camp de travail, un camp de transit et, au fur et à mesure de la guerre, un lieu d’exécution. Certains sont morts des efforts de leur travail et de la malnutrition. On estime à 22 000 le nombre de morts dans le camp.
[2] Chemin de pèlerinage qui relie les lieux de culte de l’Autriche à l’Italie en passant par la Slovénie. La partie italienne fait 205 kilomètres, la partie slovène 75 kilomètres et la partie autrichienne 80 kilomètres, soit 360 kilomètres au total.
[3] Série de procès qui ont eu lieu entre 1947 et 1949 et qui ont été intentés par le régime communiste yougoslave à l’encontre d’anciens déportés slovènes de Dachau, accusés d’avoir collaboré avec les nazis.
[4] Désigne une unité de travail forcé et, lorsque l’unité est physiquement autonome, le camp qui l’abrite.

















