
Christian Guillet, né en 1934, est un écrivain méconnu de ses contemporains qui résume à lui seul la tragédie d’un auteur sans lecteurs, ou si peu. Pendant quarante ans, des années cinquante aux années quatre-vingt-dix, il a tenu le pari d’édifier une œuvre autobiographique inédite dans sa forme, exigeante et sans concessions sur soi-même et les autres, motivée par la recherche inlassable de l’esthétique : le récit, au fil de neuf ouvrages de l’enfance aux débuts de la vieillesse et qui forment un tout, d’une vie banale transposée en œuvre d’art universelle et intemporelle. Il a accepté de revenir, pour Zone Critique, sur sa conception de la famille, un des thèmes centraux de son œuvre. Une famille qu’il a élevée, par un choix « monstrueux mais inévitable », sur l’autel de l’Art. Mais quel grand écrivain ne s’y plie pas ?
- Vous avez comme projet artistique de transposer votre vie « banale » d’homme et d’écrivain en œuvre d’art ; pourquoi avoir choisi la forme autobiographique et non la fiction ?
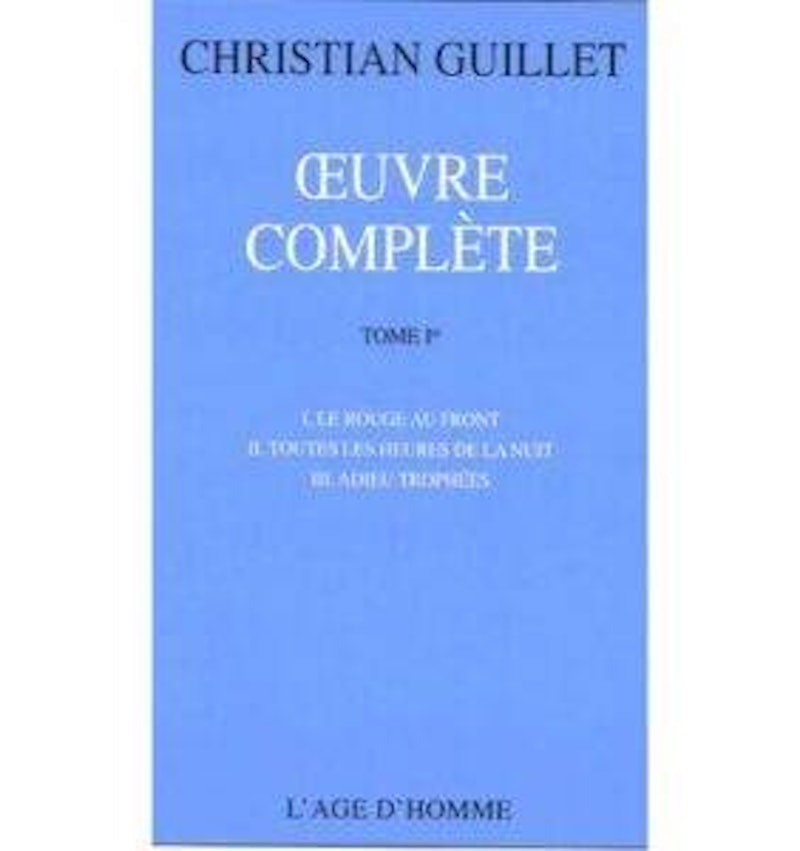
- Vous refusez tout élément de fiction mais vous semblez avoir reçu l’influence de Saint-Simon à propos duquel vous dites que « l’art est présent à tant de niveaux qu’on oublie que ses personnages sont historiques et non point fictifs. » Était-ce chez vous le but recherché également ?
Tout à fait. Un lecteur m’a dit un jour : « Quand on vous lit, on sait que vous ne mentez pas mais on a le sentiment d’évoluer dans un univers de fiction. » Relier ces deux éléments contradictoires en apparence est le miracle de toute autobiographie réussie. Pour moi, un écrivain vraiment littéraire ne peut pas prendre la plume, quel que soit le sujet, sans faire œuvre d’art.
- Comment parvenez-vous à identifier le potentiel d’un fait banal qui mérite d’être retranscrit sous une forme artistique dans votre œuvre ?
À partir des faits qui se sont déroulés pendant ma vie, j’extrais ce qui se prête à l’art et à la littérature.
Je n’étais pas maître de ce choix, je guettais devant n’importe quel être ce qui allait se présenter à moi et qui me semblait digne d’intérêt, tel un pêcheur avec sa ligne. Mon père occupe une très grande place dans mon autobiographie mais ce que je dis de lui est finalement réduit : on devine l’être qu’il était mais de nombreuses facettes de sa personnalité et de son caractère restent dans l’ombre. Je ne cherche pas à produire un photomaton parfaitement exact, je sélectionne. Il m’est arrivé, par exemple, de croiser telle femme dont le sourire m’a ému très vivement et dans lequel j’ai décelé un potentiel artistique qui pourrait me servir pour l’ébauche du portrait d’une toute autre femme. J’ai donc isolé ce sourire puis je l’ai adapté pour qu’il s’applique à une femme, qui apparaissait déjà dans mon œuvre. Vous pourriez m’objecter qu’il s’agit là d’un travail de romancier. Certes, mais la raison en est que, chez cette femme, seul le sourire m’intéressait, artistiquement parlant. Je ne ressentais donc pas le besoin de la faire intervenir à part entière dans mon récit.
- Votre œuvre est tout entière fondée sur votre propre expérience autobiographique sur quarante ans. Elle débute à l’enfance, au sein du cercle familial, et s’achève à la mort de votre père. Elle forme donc un cycle qui part de votre famille pour y revenir. Peut-on dire dès lors que, davantage qu’une autobiographie, il s’agit d’un condensé de ce qu’est la vie banale d’un homme et de son milieu familial, qui vise à dépeindre une vérité universelle ?
Je prenais des notes au jour le jour et m’efforçais, tout au long de la rédaction de mon œuvre, de me poser cette question : quelle valeur ces notes, relatives à tel événement en particulier, ont-elles d’un point de vue universel ? Je suis en cela une sorte d’écrivain du XVIIe siècle, qui cherche à dresser des portraits psychologiques à visée générale. Si l’on se penche plus précisément sur le sujet de la famille, il faut s’entendre sur la définition ou le périmètre qu’on lui accorde. Ma famille, telle que je la dépeins dans mon œuvre, n’existe qu’à travers mon regard nombriliste et par le portrait que j’en dresse le plus fidèlement possible. Si certains membres de ma famille sont absents, ce n’est pas en raison d’une quelconque hostilité que je leur aurais portée mais parce qu’ils ne m’ont inspiré aucun sentiment que je puisse transfigurer en élément artistique.
- Dès le départ, votre famille semblait « bancale » : vous portez un amour immodéré à votre père, qui en est le noyau, alors que les relations avec votre mère ou vos frères et sœurs ont d’abord été lointaines, puis au fil du temps inexistantes.
Mon père était un homme d’une extrême complexité et d’un extraordinaire égoïsme, quoiqu’inconscient. Il était assez incapable d’aimer quiconque, à moins qu’on ne lui ressemblât, et d’avoir une relation qui ne fût pas fondée sur des centres d’intérêt culturels communs. J’ai pu bâtir ce genre de relation avec lui, contrairement à mes quatre frères et sœurs qui ont souffert de son manque de considération et qui se sont réfugiés dans un certain mutisme vis-à-vis de lui, de peur de ne pas avoir le répondant suffisant.
À mon humble niveau, je peux dire que je n’ai finalement écrit qu’un seul livre, sur une continuité de cinquante ans.
Il faut dire que les membres de ma proche famille étaient en effet très dissemblables : une de mes sœurs était athée alors qu’une autre était religieuse carmélite, ce qui ne les empêchait pas de s’aimer et s’apprécier. Il n’y avait donc pas beaucoup d’unité dans cette famille, même si j’étais très attaché à cette idée. Et le couple que formaient mes parents, que je n’aimais pas de la même façon, ne me laissait pas indifférent. J’ai bien conscience que j’obéis à un certain conformisme dans la notion que j’ai de la famille, mais j’y suis très attaché : pour moi, la question du sang, de la filiation et de la transmission y est primordiale et la famille en est le produit. Il est certes possible de se sentir plus proche d’une personne étrangère que d’un frère ou d’une sœur mais je ne peux pas être indifférent au sang. Au passage, c’est un thème biblique. Quant à la transmission, l’on peut penser tout simplement à celle du patronyme, qui est un élément essentiel dans la constitution d’une famille. La transmission par le nom, qui vous prédestine en quelque sorte, est le thème balzacien par excellence.
Je vais donner un exemple relatif à l’importance que revêt pour moi la filiation : grâce à mon père, je me suis intéressé à l’artisanat, particulièrement celui de l’Ancien Régime, et à l’intelligence de la matière que peuvent avoir les artisans. Ma grand-mère possédait un beau cartel Louis XV sur lequel il était inscrit : « Julien Leroy, successeur de son père ». Pour moi, c’était capital et si j’admire tant l’Ancien Régime, c’est pour l’importance que représentait la transmission de génération en génération sur des siècles, et c’est particulièrement vrai dans l’artisanat. Les artisans, issus de cette longue continuité, sont parvenus, au fil du temps, à une perfection de leur art. À mon humble niveau, je peux dire que je n’ai finalement écrit qu’un seul livre, sur une continuité de cinquante ans. Étudier la famille, c’est remonter les générations et les siècles, chercher les liens étranges qui existent entre les ancêtres et leurs descendants (qu’on pense aux lois de Mendel, à l’atavisme etc.).
Cette transmission peut également se produire, plus rarement peut-être, dans le domaine artistique ; que l’on pense aux familles Bach et Strauss en musique par exemple. Mais pour moi, la beauté de l’artisanat est une composante essentielle du génie d’un pays.
- La transmission a également été primordiale dans votre propre cas puisque sans votre père, qui vous a légué sa passion pour la littérature et la langue, vous n’auriez pas été écrivain. Votre environnement social et culturel, au sein de la cellule familiale, vous a-t-il prédisposé à être l’homme que vous êtes ?
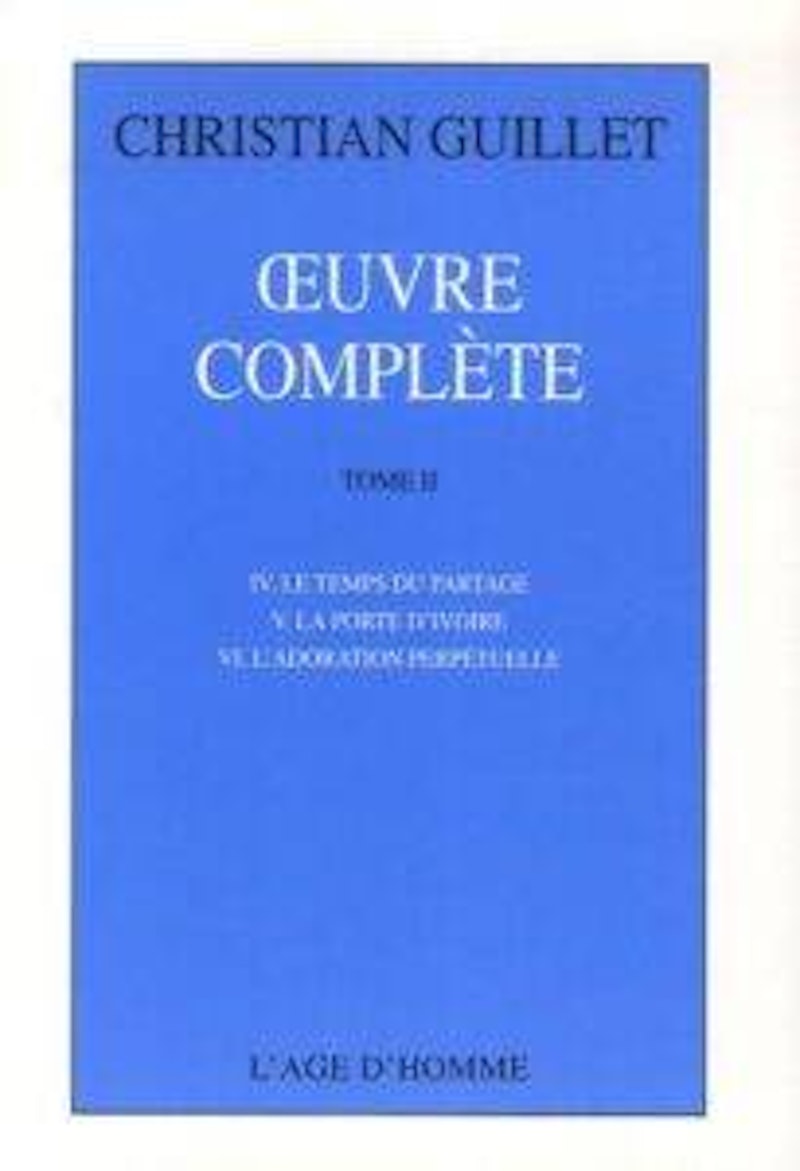
Je crois qu’il y a des êtres qui ont un degré d’originalité de tempérament extrême. Je n’avais pas cette originalité et en cela, je suis reconnaissant à ma famille car elle m’a permis d’être ce que je suis, même si je suis sévère à son égard. Mon père en est certes à l’origine mais je pourrais évoquer d’autres membres de ma famille, comme ma grand-mère paternelle, qui était douée d’un raffinement extraordinaire. Cela s’est perdu de nos jours et les nouvelles générations ne peuvent plus le comprendre. Ce raffinement lui venait de son ascendance britannique, car elle était la fille naturelle d’un membre de la famille Russell. Je pense également à mon autre grand-mère, qui m’a légué son bon sens de la bourgeoisie terrienne. Je pense qu’une combinaison de ces éléments se retrouve dans mon œuvre.
- Vous indiquez plusieurs fois « tout sacrifier » à l’art. Quelles incidences cela a-t-il eu sur votre famille, dont les membres sont régulièrement dépeints tout au long de votre œuvre dans la vérité la plus âpre, pour reprendre Stendhal ?
Je suis une sorte d’écrivain du XVIIe siècle, qui cherche à dresser des portraits psychologiques à visée générale.
Il est indiscutable que ma passion pour la littérature, en tant que lecteur dans un premier temps, et qui m’a accaparé tout entier, a entraîné des répercussions sur les relations que j’ai eues, ou que je n’ai pas eues, avec ma famille, notamment mes frères et sœurs, avec qui je n’avais que peu de centres d’intérêts communs. A l’image de mon père, je n’ai jamais pu entamer ou entretenir une relation suivie avec quelqu’un si je n’avais pas d’atomes crochus d’un point de vue culturel avec cette personne. Quand je suis devenu écrivain, à l’âge de 22 ans après que certaines personnes au jugement sûr m’ont encouragé à persévérer dans cette voie, j’ai consacré toutes les heures de ma vie au livre en cours, ce qui me privait d’échange avec autrui. En effet, l’élaboration de mon œuvre ne me laissait que très peu de temps libre, ce qui me rendait assez largement indisponible. Cela avait un caractère monstrueux et malheureusement inévitable, à condition d’arrêter d’écrire. Et tout écrivain qui a pour ambition de bâtir une œuvre digne de ce nom se trouve réduit à cette extrémité. Ainsi, jusqu’à 22 ans, les relations avec mes frères et sœurs étaient très limitées ; au-delà, elles ne sont devenues que des apparences ponctuelles.
- Pour vous citer : « Je n’ai pas toujours su les aimer dans mes livres où ils communient pourtant les uns avec les autres jusqu’à confirmer ma solitude ». Votre famille semble avoir joué le rôle inverse d’une famille classique en renforçant votre solitude.
Mais le début de cette phrase est en fait un reproche que je m’adresse qui confirme que mon obsession pour la littérature m’a empêché de développer des relations qu’on pourrait qualifier de « normales » avec mes proches. Il fallait que je fusse toujours vigilant car une idée pour mon œuvre pouvait me venir au moment où je m’y attendais le moins. Me revient en mémoire cette anecdote : une mondaine demande un jour à Pasteur par quel moyen il a trouvé le vaccin contre la rage ; ce dernier lui répond : « En y pensant toujours ». Eh bien je pensais toujours à mon œuvre, au détriment du foyer que j’avais construit. Dans la fin de ma phrase, c’est plutôt l’écrivain qui s’exprime, celui qui cherche l’esthétique.
- Dans Chapelle ardente, vous écrivez : « Mon père constituait la meilleure part de moi ». Votre œuvre n’est-elle finalement pas une longue déclaration d’amour à votre père ?
Oui car elle a pris fin à sa mort. Je ne pouvais plus écrire. Il était le personnage-clef, auquel j’ai attaché un prix infini. C’est la raison pour laquelle j’ai très mal supporté le fait qu’il n’ait pas pu lire mon dernier livre, celui qui évoque sa disparition.
- Dans Au Nom du père, vous conduisez votre second enfant sur la tombe de son arrière-grand-père, Léon Guillet, où vous engagez une sorte de dialogue et où vous faites le constat de l’atténuation du lien familial. La transmission que vous évoquiez a-t-elle été rompue ?
Il faut dire que mon grand-père était un scientifique, ce que je n’étais pas ni mon fils. Il reste des liens mais ils sont ténus. Cet homme avait des relations avec des artistes et c’est grâce à cela que mon père a été initié à la culture. Mon grand-père a servi de trait d’union avec mon père, qui a par la suite beaucoup souffert d’avoir évolué dans un univers qui lui semblait étranger.
- Vous avez cherché une sorte de famille de substitution dans la franc-maçonnerie, expérience que vous abandonnez pourtant très vite, ce que vous racontez dans La Porte d’ivoire : « J’adoptai dans l’euphorie la société maçonnique telle une autre famille, assez discrète pour ignorer qui j’étais et ne demander même pas de raconter mon histoire. »

- Vous évoquez, dans Les Dernières Tentations, les faiblesses de l’homme mûr, qui pourraient conduire à la désintégration de la famille et du foyer que vous aviez construit.
Comme j’avais toujours vécu en dehors de la vie réelle, par mon obsession de la littérature, j’étais prédisposé à la nostalgie. J’ai été soumis à des tentations lors de ce qu’on appelle communément le « retour d’âge ». Je n’étais pourtant pas un être très sensuel (hormis éventuellement par écrit, dans mes premiers livres), ce que je ne regrettais pas au demeurant. Je reprends le mot de Gide : « Que d’hommes ne sont sages que par leur déficience ». La littérature obsessionnelle coupe les moyens physiques.
- Y a-t-il des œuvres dans la littérature sur la famille qui vous auraient marqué ?
Je dirais celle de Montaigne pour qui le thème de la filiation est majeur. Du côté de sa famille paternelle, il était issu de la bourgeoisie intellectuelle, pourvue d’une éducation de grand prix et qui employait des précepteurs de grande qualité. Il a écrit l’Apologie de Raymond Sebon (un chapitre des Essais qui fait 400 pages) car son père le lui avait demandé, ce qui est extraordinaire. Du côté de sa mère, il descendait de marchands de poissons portugais, d’où lui venait peut-être son bon sens concret et un style plus sensuel. Nous savons que la mortalité infantile était à cette époque très courante ; si l’on en croit Céline, Montaigne aurait un jour écrit à son épouse, qui venait de faire une fausse couche : « Je t’en referai un dès que je reviendrai. » La notion de la famille n’était pas du tout la même que de nos jours, bien sûr, et a été très complexe pendant des siècles. On ne s’attachait pas aux enfants instinctivement. Finalement, la famille telle qu’on la connaît est une invention récente.
Bibliographie :
GUILLET, Christian, Le Rouge au front, Paris, Flammarion, 1959.
GUILLET, Christian,Toutes les Heures de la nuit, Paris, Flammarion, 1960.
GUILLET, Christian, Adieu Trophées, Paris, Flammarion, 1964.
GUILLET, Christian, Le Temps du partage, Paris, Flammarion, 1967.
GUILLET, Christian, La Porte d’ivoire, Paris, Flammarion, 1973.
GUILLET, Christian, L’Adoration perpétuelle, Paris, Flammarion, 1979.
GUILLET, Christian, Au Nom du père, Paris, Flammarion, 1984.
GUILLET, Christian, Les Dernières Tentations, Paris, Flammarion, 1990.
GUILLET, Christian,Chapelle ardente, Paris, Paris, L’Harmattan, 1998.
GUILLET, Christian, Œuvre complète en trois tomes, Lausanne, L’Âge d’homme, 2006.
GUILLET, Christian, Pièces à conviction (anthologie), Lausanne, L’Âge d’homme, 2007.
GUILLET, Christian, Ma correspondance, 4ème édition, Lausanne, L’Âge d’homme, 2019.

















