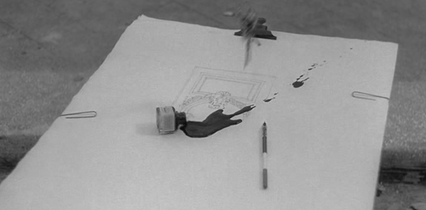Pour sa 46ᵉ édition, le Cinéma du Réel aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses de festival parallèle, mettant en avant un grand nombre de films qui, malheureusement, ne trouveront jamais le chemin des salles françaises. C’est un constat attendu (le cinéma documentaire n’est évidemment pas le plus attractif) mais toujours désolant.
Si certains parviendront à se frayer un chemin aux milieux des nombreuses sorties hebdomadaires – comme Chienne de rouge, présenté l’année dernière – la plupart se verra affubler du titre de films de festivals, avant que, pour les plus chanceux d’entre eux, une plateforme ne les ajoute à leur catalogue. Pourtant, comme chaque année depuis que Zone Critique couvre le festival, les rédacteurs auront pu voir, pendant cette dense semaine, parmi les œuvres les plus radicales de l’année. On peut s’imaginer, à tort, que le Cinéma du Réel se limite à la définition étroite du documentaire. Au contraire, de nombreux films sélectionnés proposent des formes expérimentales, comme ce fut le cas de Light, Noise, Smoke and Light, Noise, Smoke du japonais Tomori Nishikawa, court-métrage dont le titre est à prendre au sens très littéral et qui transforme des feux d’artifices en images abstraites. À l’opposé, Sauve qui peut de la française Alexe Poukine, adopte complètement les codes du genre pour mettre en lumière la formation à l’empathie de jeunes soignants, nous montrant par la même occasion la lente destruction de notre système de santé. Enfin, entre les deux, se trouve Louis et les langues d’Aurélien Froment, une réflexion sur le langage des personnes atteintes de schizophrénie qui se manifeste par l’association de plans chimériques et de bandes audio récoltées çà et là.
Comme souvent au Cinéma du Réel, il aura été question d’espace. Des espaces cloisonnés, comme dans Republic ou Boolean Vivarium, le premier s’intéressant au microcosme politique de la chambre d’un jeune chinois, le second à une pièce virtuelle en pleine putréfaction. Des espaces aux contraires infinis, comme ce fut le cas de La Laguna del Soldado qui offre toute la profondeur de champ possible à la cordillère des Andes, ou dans le point de fuite insaisissable du désert de Gobi dans The Periphery of the base. On pourrait mentionner tous les films de la compétition tant le festival s’intéresse à cette notion d’espace et à notre rapport d’êtres humains qui l’occupent. Parfois pour le pire, comme le désert du Naqab détourné par Sylvester Stallone et le tournage de Rambo III dans Under a Blue Sun, parfois pour le meilleur lorsqu’un guide japonais nous ramène à la mémoire d’une grotte dans laquelle de nombreux civils se sont suicidés durant la Seconde Guerre Mondiale.
La capacité des images de cinéma à imprimer la mémoire sur les écrans
Ce film, Gama, réalisé par Kaori Oda, convoque notre attention sur un autre thème récurrent de cette compétition : la capacité des images de cinéma à imprimer la mémoire sur les écrans. La mémoire des mouvements anticolonialistes en République démocratique du Congo dans Soundtrack to a coup d’état mais aussi la mémoire d’un mouvement pacifiste, féminin et antifasciste qui opéra à la fin des années 30 aux Pays-Bas dans Remanence de Sabine Growenewegen. Cette mémoire est d’ailleurs souvent affiliée à des femmes brutalisées par un monde masculin. Des militantes algériennes torturées et que le cinéaste Raphaël Pillosio tente de retrouver cinquante ans plus tard dans Les mots qu’elles eurent un jour, des femmes torturées, violées et souvent tuées durant la guerre de Bosnie-Herzégovine dans Silence of Reason : la réalisatrice Kumjana s’efforçant de mettre en lumière ces horreurs bien trop souvent qualifiées de dommages collatéraux. Des espaces aux contours parfois très définis : la déambulation d’une jeune exilée Russe dans les rues de Monaco dans le nouveau film de Virgil Vernier, Imperial Princess ; une autre déambulation, à vélo, et qui décrypte dans le moindre détail le vide de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle dans Aeroflux de Nicolas Boone. À l’inverse, certaines études de lieux sont motivées par des buts très définis. C’est notamment le cas dans The Signal Line, où Simon Ripoll-Hurier s’intéresse au travail de la CIA sur les médiums et l’invention d’Internet, deux études qui, par une étrange coïncidence, se déroulaient au même moment dans la Silicon Valley. Autre film qui étudie les conséquences du passé sur le présent, Sous les feuilles, de Florence Lazar qui décrit la réparation d’une Martinique frappée de plein fouet par le cyclone Dean il y a quinze ans de cela.
Il faut aussi noter la capacité du cinéma documentaire à lier l’être humain à la nature. Parfois pour décrire une totale harmonie, lorsqu’un preneur de son reconnecte avec un champ dans On the battlefield réalisé par le collectif Little Egypt, ou lorsqu’une communauté de Guinée-Bissau se consacre aux pratiques agro poétiques dans Resonance Spiral. Parfois, l’humain agit directement sur la nature pour sauver une espèce d’hirondelles dans Homing de Tamer Hassan, ou pour étudier le comportement d’insectes dans Modèle Animal et, dans ce second cas, nous avons plus de réserves sur le bien-fondé de l’opération. Enfin, pour terminer ce tour d’horizon d’un festival qu’il serait difficile de résumer en un simple texte récapitulatif, on constate que le cinéma documentaire parle d’abord de notre monde et de son actualité. Une actualité tragique dans The Roller, the life, the fight, réalisé par Elettra Bisogno et Hazem Alqaddi qui relate la rencontre entre un réfugié gazaoui et une étudiante italienne. Au contraire, même si The Garden Cadences de Dane Komljen raconte les derniers jours du collectif queer-féministe les Mollies, le cinéaste parvient à trouver un élan d’espoir en filmant des fleurs aux couleurs exacerbées. Comme le festival tout entier dont Direct Action de Guillaume Cailleau et Ben Russell est sûrement l’exemple le plus frappant, c’est dans un mouvement dissident que se crée le cinéma/futur qui tente par tous les moyens de briser les codes.