Critique redoutable et redouté qui a fait trembler le Tout-Paris littéraire mais également romancier à la langue musicale et d’une mélancolie suave, originaire d’une Corse sauvage et rêche mais amoureux inconditionnel de Paris, Angelo Rinaldi de l’Académie française, homme de contrastes, aussi affable en ville qu’il a pu être tranchant (et par là même, jubilatoire) dans ses articles, véritables armes de destruction massive des fausses idoles, nous livre cette année une première pièce de théâtre, Laissez-moi vous aimer, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Bijou d’ironie mordante et emblématique d’un art de la répartie typiquement français, cette pièce n’attend plus qu’une résidence pour y faire briller ses étoiles. Zone Critique est partie recueillir la confession dans les collines de M. Rinaldi.
Laissez-moi vous aimer, une « certaine folie » rinaldienne

On vous connaît davantage comme romancier et critique. C’est la première fois que vous nous donnez une pièce de théâtre. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette entreprise ?
Au fond, je ne le sais pas bien moi-même. Je pense que cela coïncide avec la disparition d’un ami d’enfance qui a négligé de se soigner à temps et que j’ai pour ainsi dire vu s’écrouler sous mes yeux. Cela m’a tellement bouleversé que par réaction, et pour guérir ma tristesse, je me suis lancé dans la rédaction d’une pièce, qui m’a pris une petite année. J’avais déjà la Comtesse en tête, qui est le personnage principal et qui me faisait de l’œil depuis belle lurette.
J’avoue humblement que j’ai beaucoup ri en l’écrivant, et aussi avec celle qui, par amitié, m’a servie de secrétaire et également de cobaye : je testais l’effet comique de mes répliques sur elle et selon sa réaction, je les conservais ou je les supprimais. C’est une ancienne critique de théâtre, donc elle connaît plutôt bien son affaire. Il ne me reste plus maintenant, pour faire jouer la pièce, qu’à trouver l’actrice, le théâtre, le producteur, et c’est presque l’équivalent d’une vente de réfrigérateurs en Islande. C’est compliqué car tantôt vous avez la salle et non la comédienne, tantôt l’inverse. Il y a toujours un élément du puzzle qui manque. Mais on verra bien.
Quel genre d’amateur de théâtre êtes-vous ?
Je ne vais presque jamais au théâtre, mais je suis un lecteur de pièces. Je rechigne à sortir le soir car c’est le moment où je travaille. Je lis plutôt. Je me rappelle mes lectures adolescentes de Six personnages en quête d’auteur, de Pirandello, et les fortes impressions que m’avaient laissé les personnages. Il y a d’ailleurs une certaine tournure pirandellienne dans ma pièce, en souvenir de mes quinze ans qui, bien sûr, n’avaient compris que par intuition.
Le premier acte de la pièce consiste en un dialogue entre une Comtesse et sa domestique. La Comtesse est un personnage truculent, assez cynique et n’ayant plus beaucoup d’illusions sur la vie (qu’il s’agisse de l’amour, de la famille, des relations sociales…). Y a-t-il un peu de vous dans ce personnage qui n’hésite pas à dire ce qu’il pense ?
C’est une question à laquelle l’auteur ne saurait vraiment répondre. Le fait est que la Comtesse m’a beaucoup amusé. Tous les personnages de la pièce sont symboliques d’un monde que j’ai connu.
Malgré son amertume, la Comtesse a beaucoup d’humour et prend ses distances avec tout. Chacune de ses sentences définitives pourrait ainsi constituer une maxime, par exemple : « Chez les hommes, la nature pointe jusqu’au bout ». Ce registre comique, où les bons mots fusent à chaque réplique, est plutôt inhabituel chez vous. Qu’est-ce qui vous a inspiré ?
Peut-être qu’une certaine fantaisie s’épanouit davantage dans le théâtre, qui demande de la rapidité, la mise au point d’une pièce ne nécessitant pas de rester assis des années sur une chaise comme pour un roman. C’est cela qui m’a plu dans la rédaction de Laissez-moi vous aimer et je me suis laissé aller à une certaine folie, qui a abouti à des répliques que j’ai trouvées amusantes ou bien senties.
Malgré le registre comique de la pièce, il y a, en arrière-fond, un côté tragique, qui ajoute à la mélancolie ambiante. Pourrait-on dire qu’il s’agit d’une tragicomédie ?
Oui, on pourrait le voir ainsi. Comédie est certes un mot séduisant mais l’histoire relate quand même la vie d’une femme seule, d’un certain milieu, trompée par son mari et flanquée d’une belle-fille banale et épouvantable. Elle ne peut plus se raccrocher qu’à son fils. La mélancolie est sans doute un aspect de mon caractère. Je me console en me disant que la mélancolie est le seul sentiment qui pense. Cela dit, je préfère insister sur le côté comique.
Cet humour caustique et cruel se retrouve surtout dans la description de sa vie maritale morne, voire catastrophique par certains côtés, puisque son mari, personnage ridicule et pathétique, la trompe allègrement.
Elle n’a pour elle que l’amour de son fils et elle va au-delà de la morale, en tout cas celle de son milieu, puisqu’elle se débarrasse de sa belle-fille en poussant son fils dans les bras d’un garçon d’écurie. C’est la Genitrix de Mauriac, d’une certaine manière. On peut y voir aussi un côté marquise de Merteuil, notamment dans la vengeance qui vise sa bru, elle-même adultère, et la délectation qu’elle en tire. D’ailleurs, les Liaisons dangereuses sont une des grandes lectures de mes dix-huit ans.
Dans votre pièce, l’amour n’est pas conjugal mais filial, celui d’une mère pour son fils. Croyez-vous en une forme plus large de l’amour, comme don désintéressé d’une personne vis-à-vis d’une autre, ou pensez-vous, à l’instar de Proust, qu’il s’agit d’une illusion généralisée ?
L’amour est une illusion heureuse. Il n’y a pas d’autre possibilité de sortir de soi-même que de se consacrer à autrui par ce sentiment. Mais il est vrai qu’on quitte plus facilement un sentiment qu’une habitude. Dans la pièce, la Comtesse dit qu’il n’y a d’amour véritable que celui qu’une mère porte à son fils, ce que je crois profondément du reste.
Le titre de votre œuvre, tiré d’une chanson de Tino Rossi, est à ce titre assez ironique car la Comtesse n’aime pas grand-monde, hormis son fils et son chat empaillé.
Absolument. Nous sommes également à la veille des accords de Munich ; Tino Rossi est à l’époque à l’apogée de sa gloire et les femmes se jettent sur sa voiture Delahaye comme elles se jetteront plus tard sur la moto de Johnny Hallyday. C’est la France du pacifisme et du refus de la guerre, d’où le titre finalement assez naïf de cette chanson. C’est aussi la France de la belote qui préfère Pétain plutôt que de donner huit jours de congé à la bonne.
C’est d’ailleurs l’une des répliques de votre pièce où la Comtesse dit : « Laissons le Maréchal tranquille, nous en aurons peut-être besoin un de ces jours. »
Vous êtes un lecteur attentif. J’ai placé l’action dans ce climat historique de crise, somme toute inhabituel sous ma plume, pour s’exprimer noblement, afin de décrire un monde au bord de l’abîme, celui d’une bourgeoisie et d’un certain état d’esprit français. Mais la bourgeoisie en a vu d’autres et, que je sache, nous ne vivons pas sous le régime des Soviets ni dans des kolkhozes. Elle se porte même très bien, la bourgeoisie. L’un des personnages dit quelque part : « De Gaulle avait raison, l’argent a gagné. »
Augustine, la domestique, issue du petit peuple, a des sentiments plus sincères, où n’entrent ni le cynisme ni le calcul. Il y a toujours eu, dans vos livres, une certaine tendresse pour les gens simples, au sens de Flaubert dans un Cœur simple, face à la sophistication d’une bourgeoisie calculatrice et jouisseuse.
Oui car c’est le milieu d’où je viens – paysans, bergers, femmes de ménage, employées de magasin. Mon père a été berger et garçon de café, avant d’entrer dans la Résistance. Mais passons là-dessus, le courage n’est pas héréditaire.
Cependant, pour citer l’une des tirades : « La vie sociale ne serait plus possible sans le mensonge qui est, en prime, une forme de générosité, une preuve de délicatesse ». Pensez-vous que la vie est une comédie, où chacun doit jouer un rôle, celui qui lui est assigné par le concours des circonstances ?
Rappelez-vous que Nietzsche dit que l’amitié est l’art de se taire. Il faut plutôt savoir écouter l’autre car là se trouve l’intelligence et la condition d’avoir la paix.
Vos romans se déroulent généralement dans le Sud, une province jamais nommée, et à Paris ; ici, c’est la Touraine, ce qui est inédit.
Tout simplement parce que c’est une région que j’aime. Ainsi, dans un de mes livres, l’intrigue se déroule en partie à Vendôme. Je ne me souviens plus duquel il s’agit. C’est la tragédie de tout narrateur : on consacre des années à un récit puis on oublie. De toute façon, le livre appartient ensuite au lecteur, c’est la raison pour laquelle on ne peut répondre ni aux compliments ni aux critiques. Le lecteur fait du livre ce qu’il veut.
D’habitude, mes romans (comme La dernière fête de l’Empire par exemple) se déroulent dans ce Sud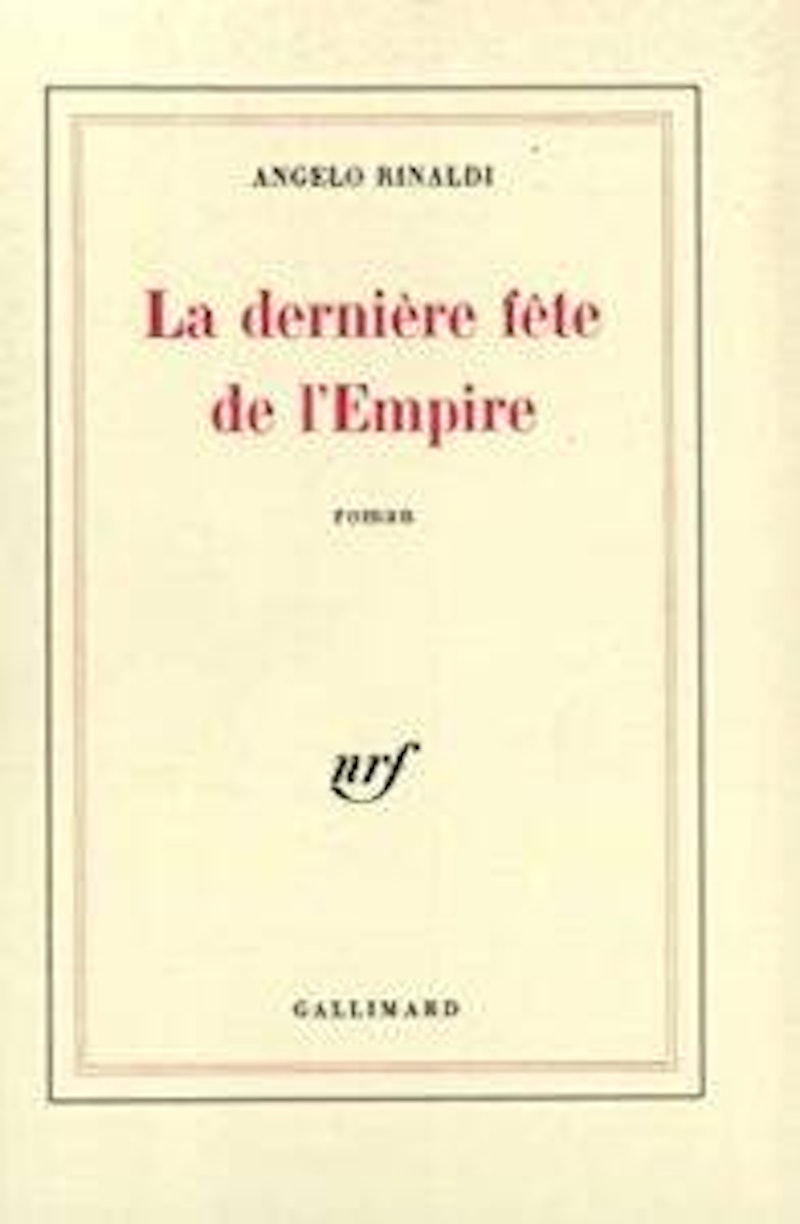
On reconnaît parfois l’admirateur de Cioran que vous êtes, quand la Comtesse prononce cette belle phrase : « La véritable douleur, c’est d’être né et le besoin de consolation est impossible à rassasier ». Etes-vous également un pessimiste ?
J’ai bien connu Cioran, qui m’a fait, dans une dédicace, le plus beau compliment que j’aie reçu de ma vie. Il m’a écrit, d’une encre verte (couleur que je déteste, à l’instar des comédiens) : « Je vous aime beaucoup parce que vous n’êtes jamais tiède. » Mais je ne me définirais pas exactement comme un pessimiste, c’est mon personnage qui l’est. Est-ce que l’on se connaît soi-même ? Quelle idée de moi donné-je à l’autre ? Nous revenons là à des thèmes très pirandelliens. J’ai plutôt un tempérament que Cioran a bien voulu saluer. Disons seulement que si j’ai écrit des histoires, je ne m’en raconte pas trop à moi-même.
Des propos que vous aviez tenus lors d’un entretien radiophonique se retrouvent dans la bouche de la Comtesse, à savoir : « J’ai toujours pensé que l’Italie était une invention de Verdi dans ses opéras ».
C’est une idée qui m’est chère et qui ne me semble pas éloignée de la réalité. Cela renvoie au film Senso de Visconti où Alida Valli, qui n’a jamais été plus belle et talentueuse, assiste à l’interruption d’une représentation d’Il Trovatore de Verdi par des patriotes italiens qui distribuent des tracts. Pour moi, c’est l’inventeur de l’Italie, qui est une création fraîche puisqu’elle remonte à 1860. Et le pays est encore très partagé entre Nord et Sud. Quand on descend à Naples depuis Rome, qui n’est pourtant qu’à deux heures de train, on voit la différence.
La partie de l’Italie qui a ma faveur, c’est la région des Lacs, qui est d’une mélancolie cinglante.
Une autre phrase intrigue : « Il se peut que la mort, on la savoure ». Est-ce également votre sentiment ? Quelle importance attachez-vous à la postérité ?
Aucune ! Hic et nunc, ici et maintenant, le reste n’a pas d’importance. Les livres me permettent de rencontrer quelques personnes, ils déplacent des ondes amicales. C’est déjà une très bonne chose. Quant à la suite, si c’est pour que je finisse sur une plaque d’émail bleu au fond d’un cul-de-sac, que voulez-vous que cela me fasse ? Je trouve cela assez dérisoire, comme si la vie de quelqu’un se résumait à cela. L’idée de savoir ce que je pourrai laisser derrière moi ne me tourmente pas, mais paradoxalement, je le regrette pour une chose : j’avais dédié un de mes romans à une femme merveilleuse qui s’est suicidée après la mort de son mari et mon livre est une manière de perpétuer son souvenir. Si je n’ai plus de lecteurs, et moi parti, qui se souviendra jamais d’elle ?
La fin de la pièce est une mise en abyme, une discussion entre l’auteur, le metteur en scène et les acteurs de la pièce. Le metteur en scène rappelle ainsi à l’auteur que ses dernières productions n’ont pas eu beaucoup de succès : « Vous n’êtes plus tout à fait dans le coup ». Y a-t-il une part d’auto-dérision ?
Je me suis amusé à écrire cela mais je n’écris pas pour dorloter mes faillites intimes. Tout de même, les personnages ont leur autonomie ! Je me suis inspiré des comédiens que j’ai pu rencontrer dans le passé. Quand on est journaliste, on traverse de nombreux milieux, c’est ce qui fait le charme de ce métier. J’ai même été membre d’une troupe de théâtre dans ma jeunesse en province, où l’on jouait En attendant Godot, jusqu’à ce que je parte à Paris pour me glisser dans le journalisme. Il m’a apporté beaucoup de plaisir et j’ai eu la chance de travailler avec des gens de l’envergure de Françoise Giroud, de Jean-François Revel…, mes maîtres dans le métier. A l’Express régnait une cordialité sportive, je n’en ai que des souvenirs heureux. A cette époque en tout cas, la presse était florissante. De plus, Françoise et Jean-François étaient des écrivains.
Il y a enfin une diatribe contre l’argent, « le diabète des parvenus », qui a gagné contre le théâtre engagé qui n’existe plus. Y a-t-il chez vous une certaine nostalgie pour un temps qui n’est plus, un coup de gueule contre une modernité désacralisatrice, où plus rien de gratuit ne compte, même la littérature ?
L’argent a toujours régné. Mais il va de soi que si la Comédie Française et l’Odéon n’existaient plus, beaucoup de pièces modernes ou classiques ne seraient pas jouées. J’habite un quartier de théâtres, où le théâtre Antoine avoisine celui de la Renaissance, de la Porte Saint-Martin etc. Il ne faut pas se leurrer, le public n’a pas beaucoup de talent, l’art demande un effort. Les gens ne savent pas à côté de quelle liberté ils passent. L’argent déploie sa toute-puissance à la télévision notamment et la recherche de la rentabilité anime aussi certaines pièces de mauvaise qualité, où l’on assiste à des déhanchements obscènes. Il ne manque plus que le pétomane du Pont-Neuf sous Louis XIV. Il est effarant de voir jusqu’où la vulgarité peut aller. A côté de cela, il y a des garçons de talent comme Antoine Rault et Jean-Marie Besset. Mais je ne vois personne aujourd’hui qui ait l’envergure d’Anouilh, que j’admire beaucoup au demeurant, malgré ses idées d’un pessimisme parfois répétitif et son côté réactionnaire.
Les romans d’Angelo Rinaldi, une plongée musicale dans le souvenir

J’imagine qu’il y a des thèmes qui se retrouvent régulièrement dans mes livres mais comment se voir en pied ? Comme lorsqu’on se regarde dans un miroir : on se voit plus beau que l’on n’est. On ne traite pas directement de soi-même dans un roman, c’est au lecteur d’interpréter ce qu’il pense être l’intention de l’auteur cachée derrière telle ou telle phrase, telle ou telle image. Il s’approprie le livre et les images qu’il contient. Et chaque livre est le premier et le dernier. Mais l’image de l’eau qui remonte à sa source comme le fleuve Alphée dans la mythologie peut en effet renvoyer au mécanisme du souvenir. Cela étant dit, je ne me suis jamais considéré comme un romancier professionnel. Si tel avait été mon optimisme, j’aurais fini aux Restos du Cœur.
Vous êtes l’auteur d’une phrase fameuse : « Le roman est une dépression nerveuse dominée par la syntaxe ». Le pensez-vous toujours ? Le processus étrange aboutissant à la rédaction d’un roman est-il toujours le résultat d’un mal-être ?
Je l’avais utilisée à l’occasion de mon discours de réception à l’Académie. Je ne la renie absolument pas. On a tous des moments de creux, que j’ai retrouvés en écho dans le Journal de Virginia Woolf, qui avait le génie en plus. Le roman n’est pas le chemin du bonheur, mais en même temps, comme dirait un président de la République, quand il est terminé, on a comme le sentiment d’avoir, à l’instar de certains animaux, laissé une peau morte sur le bord de la route.
On peut peut-être y voir un processus d’autodestruction, si l’on repense à Virginia Woolf qui a fini par en mourir.
Ce n’est pas la cause principale de son suicide. C’est surtout parce qu’elle a été victime d’abus sexuels dans son enfance et qu’elle ne s’en est jamais remise. Je ne dis pas que la recherche de la perfection en littérature ne soit pas épuisante mais le dossier Virginia Woolf contient bien d’autres choses que l’angoisse d’écrire. Cela me fait penser à cette biographie d’Hermione Lee, aux éditions Autrement, qui est tellement scrupuleuse dans la description de sa vie que j’ai mis six mois à la terminer entre deux lectures. Elle décrit tout, du premier vagissement jusqu’à la fin. Oscar Wilde disait : « La peur d’une biographie ajoute une crainte à la mort. » Il a tout dit, Oscar…
On vous a, depuis votre premier livre, comparé à Proust. Est-ce une parenté que vous acceptez ? Revendiquez ?
Sur le bandeau de mon premier livre, la Loge du gouverneur, était écrit : « le Proust de la bourgeoisie corse. » Mais c’est réducteur et j’en ai encore tant de honte que je l’ai fait arracher. Le philosophe Francis Kaplan a bien vu dans l’un de ses ouvrages que j’essayais de trouver une autre façon de raconter. Je regrette que tant de romans, actuellement, soient écrits au présent. Le présent fluidifie les choses. Les romans intégralement au présent sont des hologrammes, un signe de paresse. Il y a certes des passages rédigés au présent dans Torrent, quand François retourne sur les lieux de son enfance. Mais c’est une manière de raviver son passé, sa vie familiale et amoureuse, qui ne sont pas les miens. Torrent est mon livre le plus volumineux et c’est aussi celui qui m’a le plus coûté de temps et d’efforts. Est-ce le dernier ? Peut-être.
L’écrivain René Boylesve, à qui vous avez consacré un article critique, avait eu la malchance de venir avant Proust et ses romans, qui traitaient des mêmes thèmes (la recherche du temps perdu etc.) sans le génie de ce dernier, ont été éclipsés. Comment peut-on écrire sur le temps perdu après Proust ?
Mais voyons, tous les romans dignes de ce nom sont écrits à l’imparfait ! L’amour, la mort, l’amitié, ces thèmes-là sont toujours les mêmes, chez tout le monde. Et il faut sortir du côté provincial. Il n’y a pas que l’illustre Marcel, il y a aussi Faulkner, Thomas Mann… Je me sens plus proche du sud de Faulkner, avec les mules, les récoltes dans les champs et l’usage des armes que du salon de la duchesse de Guermantes. Je mets quand même à part Sodome et Gomorrhe, qui est un chef-d’œuvre de comique. Mais je donnerais tout le reste de la Recherche pour Lumière d’août de Faulkner. Il est vrai que les Français sont toujours un peu chauvins en matière de littérature. Ouvrons un peu les fenêtres ! Lisons le merveilleux Carlo Emilio Gadda, qui utilisait un mélange d’italien et de dialecte romain, dans l’Affreux pastis de la rue des Merles par exemple. Il y a aussi Musil, qui est un inescamotable, et Italo Svevo, avec la Conscience de Zeno notamment, qui fonde le roman autobiographique moderne. Tous des écrivains dont les phrases sont assez longuettes. Le pauvre Proust a eu tellement de mal à s’imposer de son vivant. Il n’a rien eu à part le Goncourt. Et puis est survenue une éclipse après sa mort. Ainsi, dans les années 30, Malraux disait : « C’est l’époque des idéologies, ces histoires de duchesses ne nous intéressent plus. » C’est le même Malraux qui écrira plus tard les Antimémoires… Julien Green, qui est né avec le siècle, m’a raconté un jour qu’au moment de l’attribution du Goncourt, Proust était devenu soudain la coqueluche de Paris ; puis, cela s’est ralenti, du fait de la montée des idéologies de guerre, du nazisme, qui ont relégué sa littérature au second plan. Jusqu’aux années 60 avec George D. Painter, qui l’a remis en selle.
La littérature d’Angelo Rinaldi, c’est aussi un style exigeant et musical, fait de subordonnées, de coordinations, de prédicats, d’inversions du sujet etc. De fait, votre langue semble être une musique. Flaubert avait pour habitude de « gueuler » ses phrases après les avoir écrites. Vous, les chantez-vous ?
C’est le plus beau compliment qu’on me puisse faire. Dans les rares cas où je suis satisfait de ce que j’ai écrit, quitte à déchanter le lendemain, j’entends la phrase, je la murmure. On n’a pas besoin de la crier. Une phrase ne peut pas contenir trois mots qui finissent en -tion, par exemple. J’aide en ce moment un ami à réviser une traduction, exercice très utile pour tourner les phrases de manière à éviter les redites et les rendre plus musicales. La prose, qui ne nuit d’ailleurs pas au réalisme, doit tendre vers la musique. Pensez à la scène où Madame Bovary court à travers champs rejoindre Rodolphe.
On vous a souvent accusé d’élitisme alors que c’est plutôt de l’exigence, qui demande un effort, pour savourer le texte. Pensez-vous que de nos jours, cet effort de lecture est de moins en moins fourni ? Atteignable ?
Elitisme ? Qu’est-ce donc ? Que je fais trop confiance à la finesse de l’éventuel lecteur ?
La littérature est exigeante et demande un effort, ce qui ne me semble pas être la vertu principale que l’on enseigne de nos jours aux jeunes générations. L’éducation y a sa part bien sûr, mais aussi la télévision, Internet etc. qui n’encouragent pas à prendre son temps, à lire en silence mais à zapper, dans un bruit de fond perpétuel. Et comment prendre l’habitude de lire quand on se familiarise dès le plus jeune âge au maniement des tablettes numériques ? Je suis un farouche défenseur du papier. Mais je ne suis pas inquiet quant à son avenir. Au demeurant, la culture a été et sera toujours l’apanage de la minorité qui sait que Raymond Roussel a existé.
Le passé et le présent se mêlent sans cesse, ce qui ajoute à l’aspect onirique, fugace du souvenir, de votre œuvre. La dernière phrase des Roses de Pline semble sinon résumer, du moins expliquer cet aspect de vos romans : « Bruyères blanches ou bruyères jaunes, qui vit vit ; qui meurt meurt et les morts sont des enfants qui nous viennent à mesure que nous vieillissons ».
Cette phrase me fait penser à mon amie Florence Malraux, qui vient de mourir. C’est une des phrases que je revendique le plus. Je suis très sensible à la disparition des amis, des proches. Une fois disparus, ils n’ont plus que nous pour perpétuer leur souvenir. Il faut dire que je suis originaire d’un pays que ne singularise pas la gaieté. Ne sous-estimons pas la mélancolie des îles. Ce sentiment se retrouve en Sardaigne, en Sicile, malgré les apparences (les Siciliens sont, en effet, souvent taciturnes, silencieux, dénués d’humour). Rien à voir avec Mascarille, ce personnage de bouffon de la comédie italienne que l’on retrouve aussi chez Molière.
Un autre thème récurrent : les amours masculines, omniprésentes dans vos romans. Ces amours se vivent cachées, sous le sceau du secret. L’homosexuel est marginal. Maintenant, à l’heure où la tendance consiste plutôt à exhiber ses sentiments et sa vie privée, cette vie dans le secret peut apparaître surannée. Regrettez-vous cette mutation des mœurs ?
Quelle mutation ? Les mœurs changent mais lentement. Et le ministère de l’Intérieur signale une augmentation de 10% des actes homophobes. L’omerta s’abat encore trop souvent sur les homosexuels. Il ne faut pas seulement adopter le point de vue des milieux libéraux (ou parisiens) où nous vivons. Du moins, cette pensée ne s’applique-t-elle pas partout en Ile-de-France. Si vous allez à Bobigny, c’est un autre problème… Ainsi, je pense à ce procédé, que j’ai trouvé déplorable, de Michel Onfray, consistant à s’attaquer, il y a quelques semaines à la vie privée d’Emmanuel Macron. Quel que soit le jugement ou l’opinion que nous réservons à l’homme ou à sa politique, c’est viser en-dessous de la ceinture. Honteux…
Antoine, dans les Dames de France, doute et se demande si sa vie, entre rêves et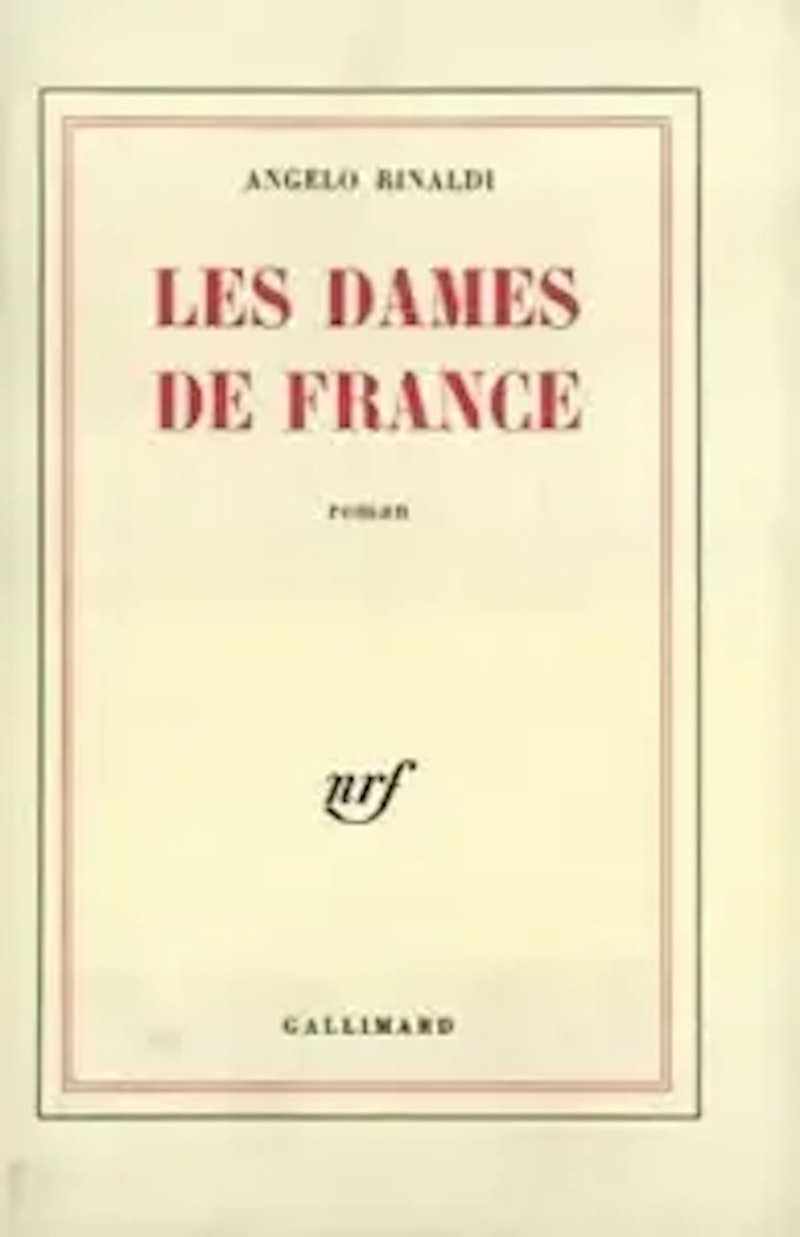
Je pense surtout à l’amitié, un sentiment très important pour moi. Ainsi, le but d’un livre est-il de déplacer des ondes amicales. Le ou les livres que vous avez feuilletés vous ont conduit à notre rencontre aujourd’hui et cela, en soi, c’est déjà une réussite, une récompense, ne serait-ce que d’une ou deux personnes qui peuvent bouleverser notre vie.
Dans un état critique
En plus d’être romancier et maintenant dramaturge, vous avez également été critique, à l’Express, au Point, au Nouvel Observateur, au Figaro.
Très peu de temps au Nouvel Observateur. Après avoir pratiqué le journalisme sous les formes les plus diverses, la critique a été mon gagne-pain. On n’écrit pas un roman à la même vitesse qu’un article. Pour parler en métaphore, si j’écris un roman, je roule en seconde. Ce sont des domaines (et je ne dis pas des arts car ce serait trop prétentieux) absolument différents. Je mets généralement trois-quatre ans entre l’écriture de chaque livre, et j’en sors éreinté. C’est pourquoi j’ai fini par écrire une pièce, pour des raisons de santé oserais-je dire.
Vous aviez une réputation de critique sans concession, à la plume meurtrière. Comme le disait Plaute, on préfère un compliment menteur à une critique sincère. Vous vous définissez plutôt comme intègre, ne vous compromettant pas avec les coteries littéraires. La sincérité, du moins dans le domaine de la critique, est-elle une valeur que vous jugez en voie de disparition ?
Jean-François Revel, qui a bien voulu, dans sa générosité, préfacer mon recueil de critiques, Service de
Vous avez été sévère avec des écrivains comme Marguerite Duras, Louis Aragon, Alain Robbe-Grillet. Quelques années plus tard, avez-vous toujours le même avis sur ces auteurs ?
Tout à fait, mon avis n’a pas changé d’un iota. Je pense toujours que Duras est une chambre à air vide. Vous me direz, plus c’est court, plus cela réduit les fautes de syntaxe ! Elle a toujours été pour moi une fausse idole à qui l’on rendait un culte, d’autant plus qu’elle est démodée et qu’on ne la lira plus dans cent ans, à l’instar de Robbe-Grillet, de ce mouvement dit du Nouveau Roman, qui cachait son manque d’imagination et la pauvreté des idées dans des romans d’arpenteur. Pensez au poète Béranger, immensément célébré de son vivant, plus encore que son contemporain Victor Hugo. Qui le connaît de nos jours ?
Vous avez été particulièrement sévère avec Claude Simon, jusqu’à attribuer son prix Nobel à l’action du KGB. Vous avez même dit de lui qu’il était « l’écrivain le plus ennuyeux et le plus artificiel depuis la disparition de Casimir Delavigne. » Le prix était-il à ce point usurpé ? Depuis, on l’a bien attribué à Le Clézio…
Mais pas à Valéry, à Giono, à Yves Bonnefoy, à René Char… J’avais surtout dit que ce prix était incompréhensible. Le KGB n’était qu’une blague quand je me demandais, sur un ton ironique, si l’académie de Stockholm avait été infiltrée pour discréditer la France. Je regrette que tant d’écrivains talentueux, qui mériteraient cent fois mieux d’être primés, ne soient pas reconnus à la juste mesure de leur talent. Je crois savoir que l’académie est actuellement secouée par des scandales sexuels, raison pour laquelle le Nobel de littérature n’a pas été décerné cette année. Il fallait s’y attendre, avec ces sociétés luthériennes et puritaines. Je suis soulagé qu’ici, en France, les jésuites l’aient emporté sur les jansénistes, autrement la vie n’aurait pas été bien drôle.
Vous avez également encensé certains auteurs comme Olivier Larronde, Shelby Foote ou Jean Rhys. Ce sont bien souvent des auteurs en déficit de notoriété. Pensez-vous avoir contribué à les sortir un tant soit peu de l’oubli ?
Je suis le premier à le déplorer. J’ai apporté ma pierre à l’édifice en tentant de les faire connaître. J’ai été l’un des premiers, avec Jean-Louis Bory, à parler d’Elizabeth Taylor, morte en 1975 et traduite seulement quinze ans plus tard, avec Mrs Palfrey, Hôtel Claremont, un roman merveilleux sur la solitude et le sentiment d’abandon d’une vieille femme. J’ai fait ce que j’ai pu pour faire part de mes goûts et mes enthousiasmes, mais si l’on n’est pas suivi, vogue la galère. Si j’ai pu attirer au moins un lecteur curieux, c’est toujours cela de gagné.
Et dans le même temps, il y a aussi des écrivains autrefois célèbres et célébrés qu’on ne lit plus, tel Jouhandeau qui a pourtant écrit un chef-d’œuvre, les Pincengrain.
Et également Chardonne, dans le même style ? Les éditions Albin Michel rééditent actuellement plusieurs de ses œuvres.
Chardonne est plus maniéré et précieux dans sa phrase. Un écrivain pour notables lettrés.
Et sur le milieu du journalisme ? Les choses ont-elles finalement beaucoup changé depuis Balzac et Lucien de Rubempré ?
Rien du tout n’a changé et pourquoi cela aurait-il été le cas ? Je donne souvent comme conseil, pour faire du journalisme mais pas seulement, de lire Balzac car tout y est.
Deux choses comptent pour les organes de presse : les ventes et l’influence. Ils n’ont pas forcément l’un et l’autre, il faut parfois choisir.
Avez-vous des modèles de critique littéraire ? Sainte-Beuve, Léautaud, Thibaudet ?
Non, je n’ai pas de modèle particulier. L’essentiel est d’écrire avec honnêteté, et en accord avec ce que l’on pense de la littérature. Toutefois, Jean Paulhan est un critique que j’apprécie beaucoup. Il n’a pas de parti pris ; pour lui, un livre se juge aux résultats et sans préjugé. D’où un ton de liberté dans les opinions qu’il porte sur ses contemporains et qu’on peut lire dans ses lettres. Une correspondance importante qu’il a entretenue avec des gens très différents tels Blanchot ou Audiberti. Je ne vois pas actuellement de critique prescripteur. Quels sont les moyens de nos jours qui permettraient de faire vendre ou de faire connaître un auteur ? Il n’y a pas, à mon avis, de meilleur moyen qu’un article. Mais actuellement, la critique se résume à trois minutes à la télévision. Ce n’est pas ainsi qu’une pensée peut se construire sur un ouvrage. Nous n’avons plus de temps à consacrer et je le regrette.
Sainte-Beuve donnait pour mission au critique de renouveler les choses connues et vulgariser les choses neuves. Etes-vous d’accord ?
Oui, je suis d’accord avec lui. Mais c’est sans doute la seule chose vraie qu’il ait dite. Il s’est quand même trompé sur tout et pas seulement sur Baudelaire ; ainsi, il est dithyrambique sur M. de Saint-Martin, qui n’en méritait pas tant. Sainte-Beuve est surtout connu d’abord grâce à Proust et ensuite par la liaison qu’il a entretenue avec la femme de Victor Hugo. Pour cette dernière, il a eu ce mot très drôle : « Plantons ensemble le clou d’or de l’amitié. »
Il a quand même écrit Port-Royal, qui est un monument.
Quel est le dernier auteur que vous avez découvert et dont vous souhaiteriez recommander la lecture ?
Dominique Fabre, le tendre romancier des banlieues grises et des destins sans issue. Mais on m’envoie très peu de livres, donc je ne saurais pas vous en recommander un qui soit l’œuf du jour.
Vous êtes un peu dans la situation que Raymond Devos appelait « l’auteur critique ou un cas de dédoublement ». Subir à votre tour la critique en tant qu’auteur vous a-t-il mis dans une situation critique, pour paraphraser Devos ?
Non, car quand j’avais la réputation de critique de quelque influence, on m’adressait beaucoup de louanges. Mais après cela, c’est le quasi-silence qui a prévalu. Et c’est dans l’ordre des choses.
Vous avez dit, dans un entretien en 1980 pour le magazine Lire : « Pour répondre librement à l’interview, il faudrait être octogénaire. On ne doit la vérité qu’aux morts et, à 80 ans, on a l’avantage d’avoir enterré presque tout le monde. A ce moment-là seulement, on peut parler ». Que pouvez-vous dire maintenant que vous ne pouviez pas auparavant ?
Vous m’accorderez la faveur de préciser que je n’ai pas encore atteint cet âge.
Tout ce que je sais de l’Académie : un engagement au service de la langue
Vous êtes académicien depuis 2001. Quelle raison vous a poussé à vous présenter ? La défense de la langue française ?
Cela s’est fait assez naturellement, en trois mois. Être entouré de gens de bonne compagnie, participer aux séances du dictionnaire (qui sont très enrichissantes), promouvoir la langue française et défendre ses richesses étaient autant de raisons qui m’y ont poussé. Et puis j’étais également parrainé par Jean-François Revel, qui m’a mis le pied à l’étrier, ce qui était une très bonne raison de rejoindre l’Académie. Je lui dois beaucoup de choses, ainsi qu’à Maurice Nadeau, qui m’a fait suffisamment confiance pour publier mon premier roman, posté en province et signé d’un inconnu. Je m’y sens très bien et je suis assidu aux séances du jeudi, bien qu’on ne m’écoute pas beaucoup et que de mauvaises langues m’accusent de mettre des croix lorsque des candidats se présentent. N’oubliez pas que l’Académie est le dernier refuge d’une courtoisie morte ailleurs.
Vous avez succédé à José Cabanis, un auteur prolifique mais un peu oublié de nos jours. Que pense le critique Rinaldi à son sujet ? Mérite-t-il d’être redécouvert ?
Un très bon romancier, mais hélas négligé de nos jours en effet. II n’était pas si prolifique que cela. C’était un catholique de gauche, sincère dans sa foi, pas du tout bigot comme Mauriac a pu l’être dans son Bloc-Notes : ce dernier renvoyait sempiternellement à des versets de l’Evangile. Bernanos, lui, n’en avait pas besoin.
« L’anglais n’est jamais que du français mal prononcé » (dans Laissez-moi vous aimer). Vous avez été président de l’association Défense de la langue française. Pensez-vous que notre langue est en danger ? Quid du langage inclusif ? Etes-vous optimiste quant à l’évolution de la langue ?
L’anglais est très envahissant, les jeunes générations en sont pétries et je ne sais pas à quoi cela aboutira plus tard. Le français est certes menacé mais d’abord par les Français eux-mêmes, les publicitaires en tête. Le salut, selon moi, viendra de l’Afrique francophone, qui est dynamique et inventive et en même temps attachée au bien-dire, à la langue. Voyez les écrivains algériens par exemple. Je suis, bien sûr, contre le langage inclusif, qui est une mode, une atteinte à la musique et qui finira par passer, et la féminisation à outrance de la langue. Pourquoi écrire « Madame la procureure » ? Il n’y a aucune nécessité d’alourdir la langue avec des pataquès. C’est d’un féminisme extrémiste qui dessert la cause, on ferait mieux d’établir l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes.
Vous vous êtes engagé en 2014 pour le sauvetage de la librairie Delamain. Ce combat pour les petites librairies, salutaire pour la culture, n’est-il pas perdu d’avance ?
Il y a quand même une librairie qui vient de s’ouvrir dans mon quartier, la librairie Ici au boulevard Poissonnière. Mais en effet, le combat est difficile pour les librairies face aux énormes groupes que sont Amazon etc. Nous perdons, avec les librairies, un havre, une proximité humaine ; c’est en errant dans les librairies que je trouve des nouveautés, étant donné qu’on ne m’en envoie plus, et il est important de conserver ce lien, ce lieu où la culture est abordable. A ce propos, citons encore Revel : « La culture est toujours facultative. » Et tous les artistes – écrivains, compositeurs, peintres – ont matériellement une vie difficile. Mais, comme disait Cioran, s’il faut rater sa vie, mieux vaut la rater à Paris qu’ailleurs.
Entretien réalisé par Guillaume Narguet
Crédit photo : le Point

















