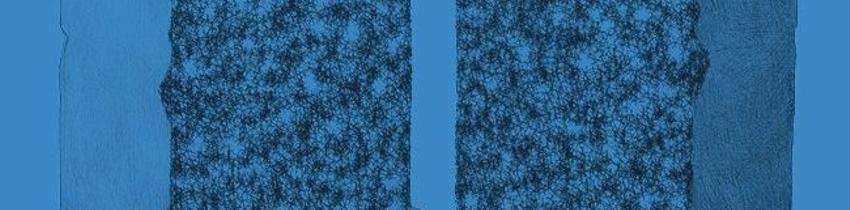Rémi Brague, l’auteur d’Europe, la voie romaine et du Règne de l’Homme, se dit volontiers « modérément moderne ». Catholique et fin connaisseur des monothéismes en général, il souligne les défauts d’une culture européenne qui tend à renier ses sources religieuses. Le professeur émérite de philosophie médiévale revient pour Zone Critique sur sa critique de l’humanitarisme, la christologie et la question de la légitimité de l’Homme.
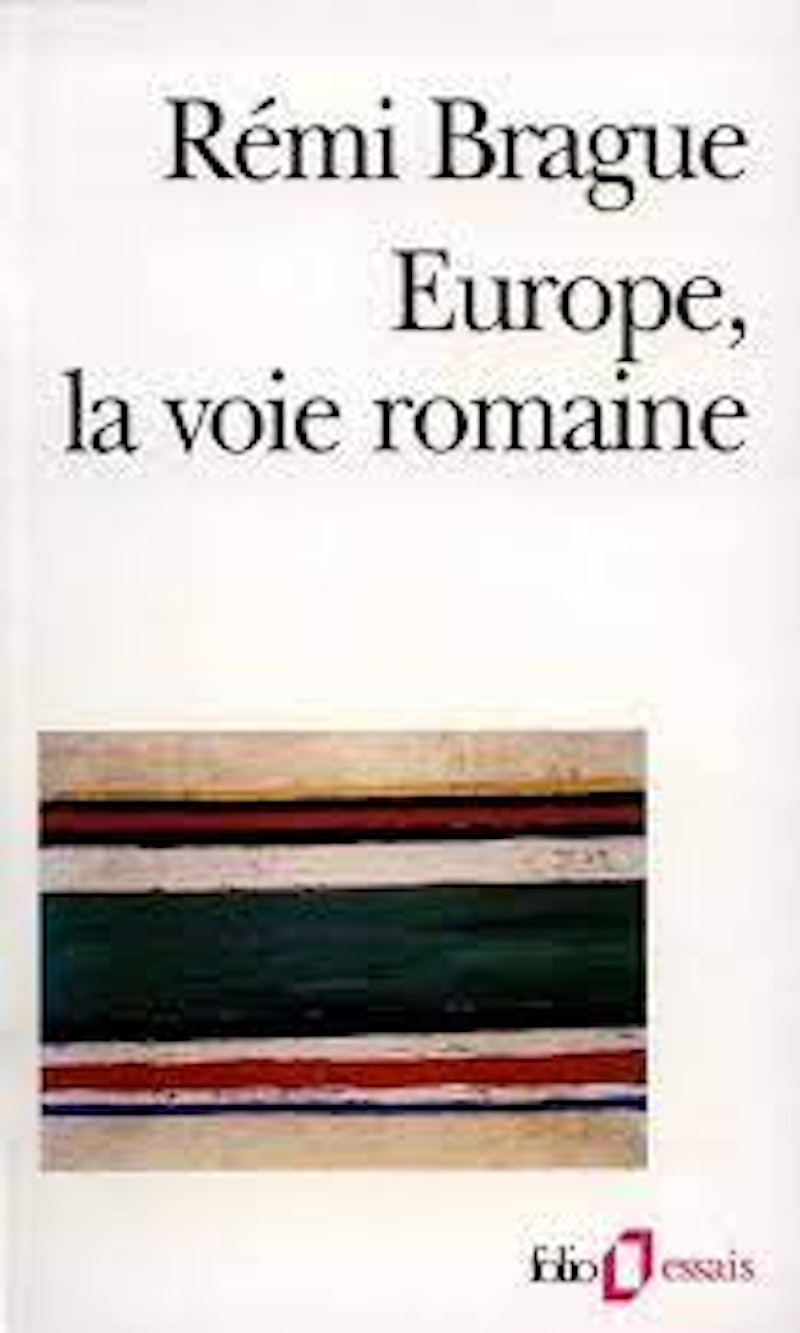
J’ai accordé une large place à la culture européenne pour trois raisons : d’une part, je la connais moins mal que d’autres, indienne, chinoise, africaine, etc. ; d’autre part j’en suis l’héritier reconnaissant ; enfin, je la sens aujourd’hui menacée. Sur la « voie romaine », je ne puis guère que renvoyer au livre de ce titre, qui a déjà plus de trente ans d’âge. Ce jeu de mots désigne la façon dont, comme les Romains de l’histoire, l’Europe a su se reconnaître secondaire par rapport à ses deux sources grecque et juive. Ce pourquoi elle a pu ne cesser d’y retourner pour de toujours nouvelles appropriations. Une culture comme celle de l’islam médiéval, pour lequel la langue de l’élite était l’arabe, a très largement traduit du grec—en fait à peu près tout ce qui était disponible du savoir grec (mathématiques, médecine, philosophie, etc.), mais elle l’a digéré en une seule fois. L’Europe latine, elle, est passée par toute une série de renaissances, de retours à l’Antiquité.
La modernité fait l’objet de nombreuses critiques sous votre plume. Pourriez-vous lui reconnaître, malgré tout, des qualités ?
Je distingue les temps modernes et ce que j’appelle, après d’autres, le projet moderne. Le premier terme désigne une période historique commençant, selon les goûts, en 1453, 1492 ou 1517 et toujours inachevée ; le second est une attitude d’esprit. L’ère moderne a apporté autant de bien que de mal, comme d’ailleurs toute période historique. Loin de moi l’idée de vouloir nier les apports positifs des temps modernes, comme la science mathématisée de la nature, la démocratie, ou encore une saine séparation des compétences entre le politique et le religieux, sans parler des avancées de la médecine. Elles représentent, au niveau même de la vie quotidienne, ce qui peut le mieux nous convaincre de la réalité du progrès. Je n’ai donc aucun mal à admettre sans réticence aucune l’évidence massive de ces qualités. Ce que je souhaite, c’est même que lesdites améliorations croissent et embellissent. Et, pour ce faire, je m’interroge sur les conditions qui les rendent possibles. Or, il me semble que le projet moderne compromet ces conditions.
Vous prétendez que la légitimité de l’Homme doit être fondée sur une transcendance religieuse. Un chemin vers un salut sans Dieu est-il impensable ?
La légitimité n’est pas le salut (en grec : sôtêria), lequel est l’objet de la sotériologie. Mais elle la précède : il faut déjà croire que l’existence de l’humain est légitime pour savoir qu’il mérite d’être sauvé. Si ce n’est pas le cas, ce qu’il faudra sauver, ce sera non pas l’homme, mais bien plutôt autre chose : « la Planète ! », par exemple, et au besoin en demandant la disparition de l’espèce humaine.
Un de vos ouvrages porte le titre Le Règne de l’Homme. Pourriez-vous définir ce dernier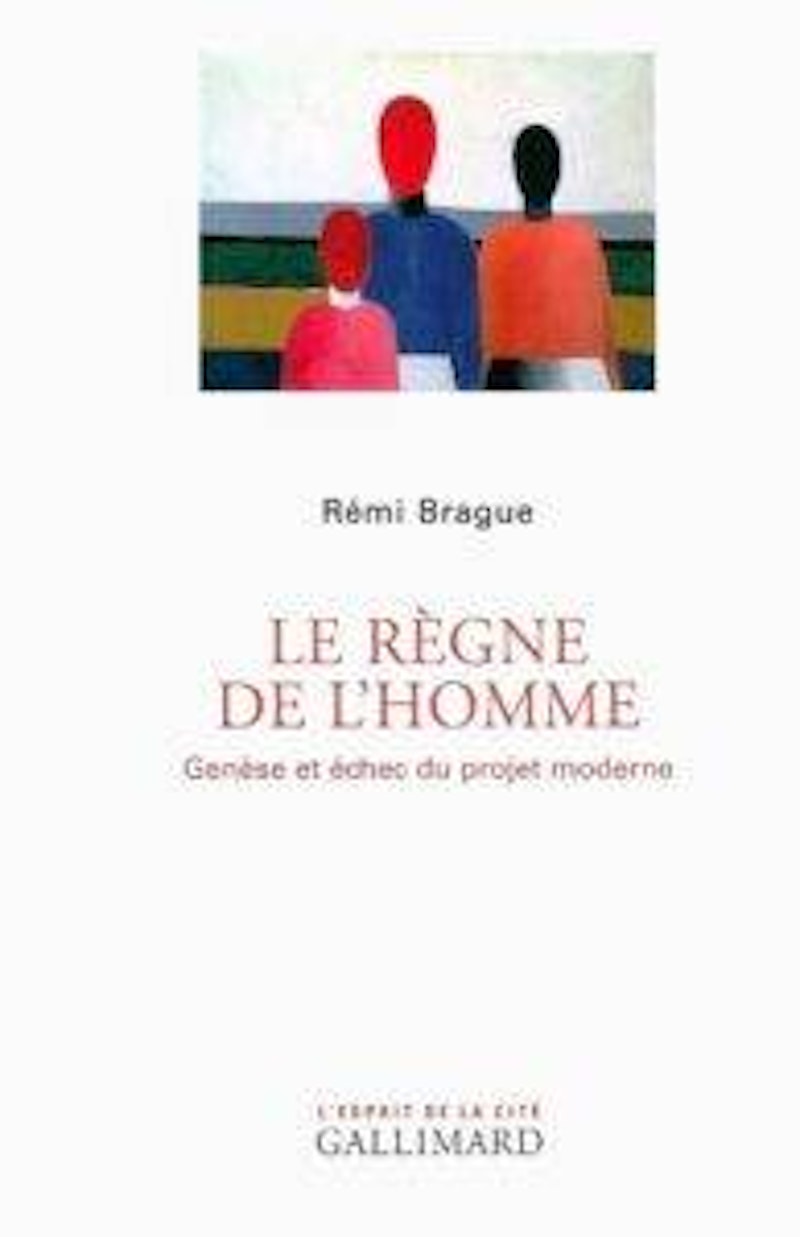
Mon livre ne se comprend pleinement que si on le lit comme la fin d’une trilogie commencée avec La sagesse du monde (1999) et poursuivie par La Loi de Dieu (2005). Par « règne de l’homme », j’entends la prétention de l’humanité, en tout cas de sa fine pointe occidentale, non seulement de dominer la nature, mais de récuser Dieu en se constituant comme la réalité la plus élevée. Auguste Comte n’a pas hésité à donner à l’humanité des noms traditionnellement réservés à Dieu, comme « Être suprême » ou « Grand Être ». On a appelé cette position « humanisme exclusif ». Il ne suffit pas, pour en montrer l’échec, de rappeler les massacres perpétrés par des régimes athées, voire sciemment anti-chrétiens comme le nazisme ou le léninisme. Ce pourquoi je n’en parle à peu près pas. Je préfère montrer comment cet humanisme s’est engagé dans une dialectique autodestructrice : s’il n’y a aucune instance supérieure, capable de se prononcer sur la valeur de l’existence humaine, nous ne pouvons pas savoir s’il est bon que l’espèce homo sapiens reste présente sur la surface de la Terre. Le projet transhumaniste est lui aussi un symptôme. Il témoigne d’une profonde insatisfaction. L’homme qui désespère de lui-même rêve de passer à autre chose, qui ne serait plus humain…
Est-il toujours possible de croire en un Dieu bon et tout-puissant après Verdun, Auschwitz et Hiroshima ?
Cette question est devenue lancinante. Elle recycle le célèbre dilemme d’Epicure. Mais elle doit elle-même être questionnée. Il serait bon de commencer par se demander pourquoi on accuse Dieu d’être responsable de ces horreurs. Elles n’ont pas commencé au XXe siècle : La Peste Noire (1346-1353) aurait emporté un tiers de la population européenne, et d’après les historiens, Tamerlan (m. 1405) aurait tué entre un et dix-sept millions de personnes. Il ne s’agit pas pour moi de relativiser les trois événements que vous avez cités, mais simplement de poser une question. La Peste Noire a entraîné un changement de mentalité ou de sensibilité. On s’est mis à peindre des danses macabres. Mais la foi en Dieu n’a pas été compromise. Comment se fait-il donc que ce soit seulement au XXe siècle que l’on se soit mis à poser votre question ?
Avec le projet moderne, l’homme se flatte d’être devenu le maître de son destin. On trouve la formule aussi bien en style noble que dans des bouffonneries parodiques. Ainsi chez Mikhaïl Boulgakov, selon un personnage de « poète prolétarien », « c’est l’homme lui-même qui gouverne » (Le Maître et Marguerite, 1). Seulement, les trois événements cités sont dus à une volonté humaine, plus ou moins individuelle, plus ou moins collective. Le fait que l’homme soit désormais à la barre ne garantit donc pas du naufrage. Il va alors falloir laisser l’homme au pouvoir, tout en trouvant une autre instance dont ce pourra être la faute. On peut et doit se demander s’il est honnête d’attribuer à l’homme tous les succès et de ne sortir Dieu de sa poche que quand c’est pour lui faire porter le chapeau de tout ce qui cloche.
Une question analogue a été posée par Adorno, toujours à propos d’Auschwitz : peut-on encore écrire de la poésie ? Pour moi, répondre par la négative serait le plus haut triomphe du nazisme.
Une question analogue a été posée par Adorno, toujours à propos d’Auschwitz : peut-on encore écrire de la poésie ? Pour moi, répondre par la négative serait le plus haut triomphe du nazisme. Ainsi, Paul Celan a continué d’écrire après Auschwitz. De même, saint Maximilien Kolbe a continué à croire en Dieu en dépit des maux qu’il a endurés.
Vous prétendez que le “dérivatif logique” de la compassion sans Dieu est la Terreur révolutionnaire. Pouvez-vous expliciter cette affirmation ?
Cette idée, je l’ai rencontrée chez deux romanciers américains récents, Flannery O’Connor (m. 1964) et Walker Percy (m. 1990), que je cite dans mon Après l’humanisme, ch. IV, §5. « Dérivatif logique » est la traduction, mauvaise, de logical outcome. Dans le même livre, je cite également le philosophe russe Nikolaï Berdiaev (m. 1948). Ivan Karamazov, qui refuse son billet d’entrée au paradis à cause de la souffrance des enfants, est selon lui le type du révolutionnaire qui, pour instaurer par la force le règne de la justice, n’hésite pas à causer la mort de milliers de gens, enfants compris. S’il n’y a pas d’autre issue que l’élimination des causes de la souffrance, on aboutira effectivement à la terreur. La foi en une autre scène n’a jamais été en concurrence avec le souci de consoler, de réparer, de soigner, etc. Je me mets en colère quand on répète que la religion est l’opium du peuple. Car qui, en Europe, s’est occupé de soigner les malades, de nourrir les affamés, de recueillir et d’élever les orphelins, etc., en un mot quelle institution se chargeait des « œuvres de miséricorde » ? Ce n’est que récemment que l’État a ajouté aux pouvoirs régaliens le rôle de la providence que l’Église assumait jusqu’alors.
Nous connaissons votre dilection pour l’étude des textes juifs et islamiques. En quoi vous ont-ils éclairé dans vos domaines de recherche ?
D’une part, à cause de leur intérêt intrinsèque, qui est considérable. Fréquenter de grands esprits est toujours enrichissant. D’autre part, en me fournissant un élément de comparaison par rapport auquel porter une appréciation de la culture dans laquelle j’ai baigné, à savoir la culture européenne, qui prolonge celle du Moyen Âge latin. Cette dernière a beaucoup de points en commun avec ses deux voisines : avec l’Islam, l’héritage grec ; avec le judaïsme, l’héritage biblique. C’est pour cette raison qu’une comparaison avec des cultures proches, celles-ci ou encore celle de l’Empire romain d’Orient, alias Byzance, oblige à mobiliser des instruments d’analyse plus fins que quand, par exemple, on compare l’Europe et la Chine, qui sont si différentes.
Le transhumanisme, l’intelligence artificielle ou encore le génie génétique semblent conquérir les esprits. Qu’est-ce que le catholicisme peut apporter comme réponse à ces enjeux contemporains ?
C’est d’abord à la philosophie de porter un regard critique sur ces réalités nouvelles. Elle le fait en respectant une stricte neutralité par rapport aux religions. C’est à elle, déjà, de départager le réel du rêve (ou du cauchemar), puis de mesurer les deux à l’aune de la morale commune. Je rappelle que le christianisme, catholique ou non, n’ajoute aucun nouveau commandement aux « grandes platitudes » de la morale commune. Sur ce point, il ne revendique donc aucune compétence particulière. En revanche, il élargit le champ d’application de la morale : « le prochain » qu’il s’agit d’aimer comme soi-même n’est plus simplement le membre de la même nation ou le coreligionnaire, mais tout homme, quel qu’il soit. Historiquement parlant, le christianisme a étendu le respect dû à l’humain aux nourrissons, et même aux fœtus encore dans le sein de leur mère, aux femmes, aux esclaves. Il voit de l’humain là où d’autres ne voient que du préhumain, du sous-humain, de l’ex-humain—à moins que ce ne soit que de la chair à canon, de la force de travail, du contribuable ou du consommateur.
Bibliographie sélective
- Europe, la voie romaine, Rémi Brague, Gallimard, 1999
- Modérément moderne, Rémi Brague, Flammarion, 2014
- Le propre de l’Homme – Sur une légitimité menacée, Rémi Brague, Flammarion, 2015
- Après l’humanisme, Rémi Brague, Salvator, 2022
- Sur l’islam, Rémi Brague, Gallimard, 2023
Crédit photo : Rémi Brague © Yrieix Denis