Patrice Jean est écrivain. Auteur de L’Homme surnuméraire (2017) et de Rééducation Nationale (2022), il raconte les misères de l’homme contemporain aux prises avec les excès idéologiques de son temps. Dans son dernier ouvrage, Kafka au Candy-shop (Editions Léo Scheer, 2024), l’auteur prend le parti du vécu individuel contre la lecture structurelle de la société propre aux sciences humaines. Un essai décapant.
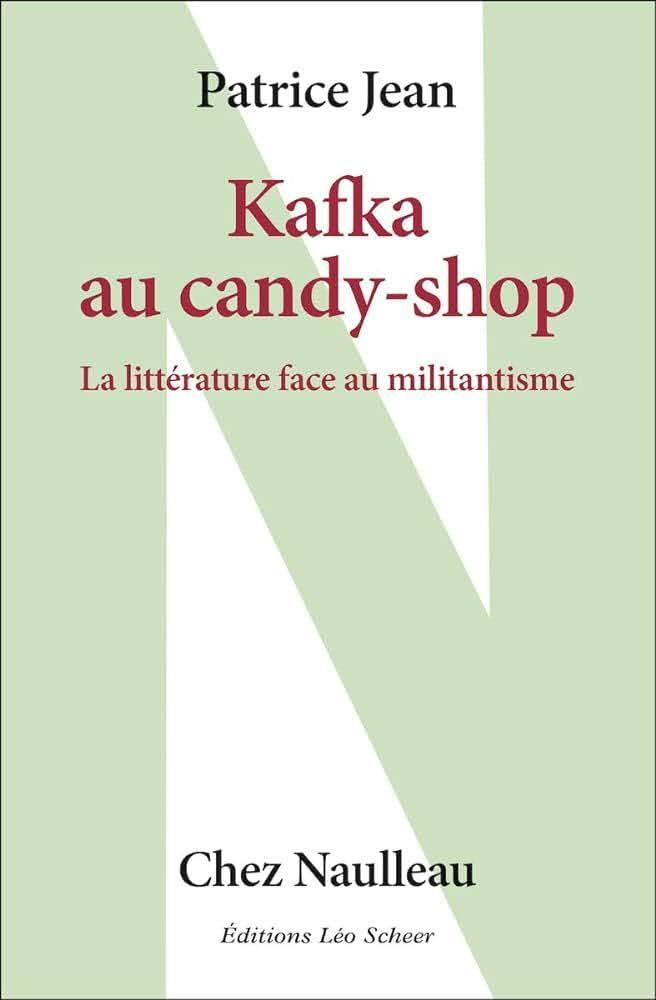
D’emblée, l’auteur évoque une situation assez banale. Lassé, un homme rentre d’une soirée et attend fébrilement de recevoir une réponse téléphonique de la femme qu’il convoite : Suzanne. Il s’allonge sur son canapé et plonge dans un état mélancolique. Le voilà seul avec lui-même, atrabilaire et pensif. Afin de décrire une telle situation, deux paradigmes inconciliables se battent en duel : d’un côté, le marxiste réfute une telle narration. Il est la résultante de rapports sociaux. Ancré dans une classe, héritier de divers capitaux, tributaire d’une langue, il jouit du confort d’un appartement qui a été bâti par des ouvriers, il porte des chaussures qui existent par le fait qu’elles sont la fine pointe d’une division du travail propre à un mode de production capitaliste : en somme, l’ego n’existe pas, il n’est que le résultat de structures qui le surplombent.
La solitude reste à jamais transhistorique et transéconomique.
A cette vision bornée, l’individualiste oppose l’irréductibilité de la chair, du vécu individuel : à ce moment-là de sa vie, l’homme épris de Suzanne est entièrement pris dans son rapport personnel à l’existence ; ici, plus de rapports sociaux et de lutte des classes. D’après Patrice Jean, les deux ont raison : s’il est naïf d’imaginer un individu exempt des tensions structurelles présentes dans la société où il habite, il est tout aussi barbare d’annihiler la dimension non-politique de l’existence. Pris dans la tragédie du commerce et des nations, l’individu est certes toujours en lien avec d’autres ; cependant, nous ne pouvons lui retirer ses éruptions de joie ou de colère, ses amours et ses tristesses, bref, sa vie immédiate. Comme l’indique l’auteur « on vit seul et on meurt seul » : le « tout est politique » n’explique jamais pourquoi l’on souffre, pourquoi nous sommes fatigués, et même pourquoi nous sommes heureux. La solitude reste à jamais transhistorique et transéconomique : « Les causes et les effets butent sur la vie, inexplicable ».
De plus, il s’agit pour l’écrivain de faire place à une vision littéraire du monde, sans pour autant balayer d’un revers de la main les explications scientifiques de ce dernier : le subjectif et l’objectif doivent se combiner afin de mieux épuiser ce qui nous entoure. En effet, les lois, les chiffres, la répétition nous aident à classer ce qui est, mais les romanciers prennent le parti de l’un, des hypothèses, de l’incompréhensible, de la singularité. S’amputer de l’une de ces dimensions revient à faire preuve d’hémiplégie intellectuelle. Afin d’exemplifier ses partis pris, l’auteur cite le roman Gilles de Drieu la Rochelle : dans ce dernier, nous suivons les tourments intérieurs d’un personnage qui finira par s’engager en faveur du franquisme. Si Patrice Jean condamne une telle option politique, il ne verse pas pour autant dans la moraline : les romans de Sartre et d’Aragon, écrivains communistes, mettent tout autant les problèmes existentiels au premier plan de leurs écrits. Ici, nous comprenons que, par-delà les clivages idéologiques les plus radicaux, la littérature met tout le monde d’accord lorsqu’il s’agit de dépeindre le monde sous le prisme de la singularité d’un être de chair et de sang.
Le règne des philistins
D’emblée, Patrice Jean voit dans la littérature une déclaration de guerre, une vengeance déguisée. Lorsque Marcel Proust, dilettante raté des mondanités, rédige la Recherche, il recompose ce monde de snobs et de pervers qu’il a connu, tandis que Dante envoie en enfer les différents pécheurs de son temps. A la différence du militant politique, le romancier ne veut pas agir tout de suite sur le monde : il se retire dans sa chambre, fait et défait le réel sans que cela soit forcément une description clinique de ce dernier. L’imagination, l’humour, l’équivoque font partie de la création littéraire.
Or, c’est ici que le bât blesse : le militant voit dans le roman de la simple littérature qui n’est rien face à la révolution devant mener à une société sans classes. Les détails, la subtilité de la vie concrète échappent à celui qui découpe le monde selon certaines options politiques parfois manichéennes : non sans provocation, Patrice Jean souligne le fait que les deux catégories de philistins qui se vantaient devant lui de ne pas lire de romans, sous prétexte que cela était une affaire de « bonnes femmes », étaient des chefs d’entreprise et des militants politiques. Rappelons-le, le philistin désigne originellement un fat, un béotien indifférent aux choses de la culture : selon Schopenhauer, ce dernier réduit toute la vie à des bagatelles utilitaires contrairement au génie capable d’atteindre l’essence du monde par son imagination. Ainsi, l’auteur pointe le fait qu’il existe une alliance objective entre le libertaire et le libéral : réduisant tout à des questions économiques, ces derniers conspirent contre l’esprit de finesse qui caractérise la littérature.
De plus, les militants et les entrepreneurs ne sont pas les seuls à jeter les lettres dans les poubelles de l’Histoire : en effet, l’esprit du temps est au fun, aux activités qui « ne prennent pas la tête », et au développement personnel, il épouse parfaitement le projet d’Henri Matisse pour qui l’art devait s’apparenter à un bon fauteuil où nous nous délestons des grandes questions existentielles. Plonger dans les arcanes du Mal avec Sade et Bataille, réfléchir sur le libre-arbitre avec Dostoïevski, se lamenter sur la vanité des illusions avec Leopardi, tout cela ne pèse pas lourd face aux happyendings des séries américaines et à l’esprit de croissance (growth-mindset) encouragé par les chefs des bureaux du bonheur (chief happiness officer). Dans la même veine optimiste, façon militantisme marxiste, le gréviste survolté écarte la question du mal individuel au profit de la dénonciation du mal présent dans un système social particulier, en l’occurrence le mode de production capitaliste : le libertaire de Mai 68 souhaite « tout, tout de suite », tandis que le révolutionnaire appelle de ses vœux l’avènement d’une société égalitaire dont la réalisation effective est sempiternellement ajournée. Insensibles au tragique de l’existence, voyant dans celle-ci un problème à résoudre, ces derniers versent aussi dans le feel good contemporain : or, Patrice Jean le rappelle, Marx ou pas Marx, consommation ou pas consommation, le Temps abolit tout et seul l’individu existe. Si la littérature rend compte de cette dimension, les options économiques libérales et marxistes l’occultent en privilégiant toujours un système à solutions.
En outre, la vision littéraire du monde accorde une dignité aux hommes que nous sommes tous, dans leur misère et leur grandeur : si nous sommes le fruit de structures, d’habitus, nous possédons quelque chose d’irréductible que le roman met au jour. L’angoisse, la peur, les tourments intérieurs, les pouvoirs de l’imagination ne peuvent être complètement passés au tamis des sciences humaines, la vie dont parlait Michel Henry, celle qui ne peut nous être arrachée, a toute sa place en littérature : Non sans provocation, Patrice Jean fait de l’inégalité le sel de l’existence : les hommes sont grands par ce qui les distingue. Aristocratiques, les lettres sont ce médium par lequel les humains ne se transforment pas en souris de laboratoire, en automates asservis au culte de l’utilité de droite ou de gauche, mais en personnes singulières : comme l’écrivait le moraliste Gómez Dávila, « le niveau d’une civilisation se mesure en fonction du nombre de parasites qu’elle tolère » (Carnets d’un vaincu). En somme, il n’y a de science que du général et d’existence que du particulier : aucune science ne pourra jamais décrire la chair du monde, l’extase esthétique des chants d’oiseaux, la beauté voluptueuse d’un corps désiré enfin nu, ou encore l’ivresse ressentie durant un bain de minuit. Le nombre, la loi, les statistiques et la répétition ne sauront jamais atteindre une telle profondeur des choses.
Si nous sommes le fruit de structures, d’habitus, nous possédons quelque chose d’irréductible que le roman met au jour
Contre la morale du temps
Un écrivain parle toujours d’un pays, d’une situation concrète de laquelle il ne peut s’extraire : en effet, l’époque qu’il traverse a ses totems et ses tabous, un certain nombre de poncifs qu’il est de bon ton de ressasser à tort et à travers. D’après Patrice Jean, le progressisme est l’idéologie des nouveaux messieurs Prudhomme. Ceux qui s’aventurent hors du périmètre de respectabilité tracé par cette religion postmoderne risquent d’être bannis des cercles littéraires et universitaires. Or, la littérature est ailleurs, loin des sensitivity readers et des trigger warnings, nom donné aux avertissements écrits afin de prévenir une personne traumatisée qu’un passage d’un livre peut la choquer. Les lettres se sont toujours aventurées dans des zones de transgression. Les pétitions que certains affectionnent, la censure, l’exclusion d’écrivains du devant de la scène ne sont plus le fait d’une bourgeoisie puritaine mais d’un progressisme conservateur qui prend les atours du Bien. Or, il est de notoriété publique que le roman est lié au Mal. L’écrivain bouscule les attentes d’une époque, il reste intempestif et irrévérencieux. Prenons n’importe quel roman célèbre, il se mêle toujours de ce qu’il ne le regarde pas, et il appuie là où cela fait mal.
En lecteur de Cioran, l’écrivain fait la belle part à la divagation mélancolique et sans but.
De plus, Patrice Jean reproche au progressisme actuel de s’attacher – comme le capitaliste, à des intérêts purement matériels : si le premier souhaite une mise en commun des moyens de production et l’égalité des richesses visibles, le second tient à maintenir la propriété privée en l’état et se fait le défenseur du profit à tout crin. En dépit de ces divergences, les deux ramènent le réel à des questions pécuniaires : si jadis, les communistes, notamment par leur valorisation de l’éducation, amenaient les têtes blondes vers les grandes œuvres littéraires, ce temps est révolu. La bourgeoisie libérale et le militant progressiste ne remarquent pas l’enlaidissement des villes puisqu’ils se soucient de la beauté comme d’une guigne. La littérature a pour objet la vie dans toutes ses contradictions. Evidemment, la question sociale traverse les romans réalistes par exemple, mais ce n’est pas tout : l’amour, l’ambition, la haine, les bassesses et les grandeurs individuelles font partie de la grande trame de nos existences. Paul Valéry le disait : tout ramener à la politique évite aux individus de se tourner vers leur existence dérisoire.
Plus que cela, Patrice Jean refuse le tout-politique par iconoclasme : son utopie serait une société de poètes solitaires, de pêcheurs, de vagabonds esthètes indifférents au Salut de la société. En lecteur de Cioran, l’écrivain fait la belle part à la divagation mélancolique et sans but. Contre les « consciences creuses » happées par les structures du collectif, l’auteur valorise le singulier contre le pluriel progressiste.
Incisif et provocateur, Kafka au candy-shop fait droit à la vision littéraire du monde en plus de celle proposée par les sciences : proches de la chair et du sang, les lettres exaltent le singulier contre les systèmes totalisants et simplificateurs du réel. Au moment où le culte de l’utilité rapetisse l’Homme, lire cet ouvrage est salutaire.
- Patrice Jean, Kafka au Candy shop (La Littérature face au militantisme), Editions Léo Scheer, 10 janvier 2024.


















