La littérature peut-elle sauver les États-Unis ? À l’occasion de l’investiture de Trump, nous proposons un panorama de la littérature américaine contemporaine. Alors que le président est reconnu pour son mépris des minorités, les auteurs noirs-américains, amérindiens, d’origine asiatique, africaine ou latine occupent une grande place dans les lettres états-uniennes. De Lauren Groff à Stephen Markley, les écrivains américains leur donnent une voix et témoignent de la multiplicité de ce pays.
Jakob Guanzon, l’auteur d’Abondance paru en janvier 2023 à La Croisée dans une traduction de Charles Bonnot, a accordé un entretien à Zone Critique. Son premier roman, finaliste du National Book Award, met en scène un père et son fils sans abri qui, en vingt-quatre heures, dans une Amérique ultra-consumériste décrite dans un style saturé contrastant avec le dénuement des deux héros, voient leur vie basculer.
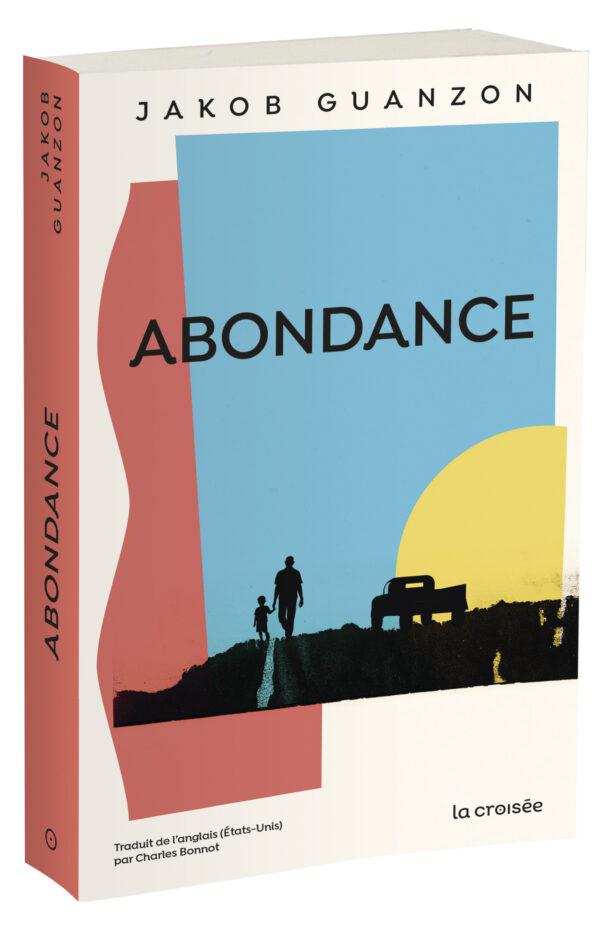
J’ai lu que c’est la structure du livre (ces titres de chapitres indiquant quelle quantité d’argent possède alors Henry) qui vous est venue en premier. A-t-il été facile d’élaborer une histoire en vous appuyant sur ce découpage ?
Le procédé m’a beaucoup intéressé parce que la plus grosse expérience pour moi en tant qu’écrivain était d’observer comment l’argent affecte le personnage. Au début, je choisissais les montants un peu au hasard.
J’aime planifier mes romans, je sais où l’histoire va : je savais avant de commencer à écrire quelle serait la dernière phrase d’Abondance. Mais est venu un moment dans le livre, à la moitié, peut-être un peu plus, où j’ai réalisé que Henry devait gagner un peu d’argent, trouver un travail quelconque, sans doute manuel. Ça a perturbé mon plan initial. Ça m’a montré à quel point le poids d’un budget très réduit force une personne à faire des choses qu’elle ne veut pas faire, n’a pas prévu de faire.
Est-ce que vous pensez que la chance et la malchance jouent un rôle dans la vie de Henry ? Dans la vie des gens en général ?
Absolument, et ce dès notre naissance. Le fait de naître, bien sûr, mais aussi dans quelle famille nous naissons, la classe à laquelle elle appartient, notre race, notre genre, tout est une affaire de chance, de hasard, de coïncidences.
Ça dépend aussi de la manière dont nous réagissons dans une situation donnée. Nous avons notre libre arbitre, mais il dépend beaucoup des circonstances de notre naissance.
Henry veut éviter de répéter les erreurs de son père, en particulier dans la manière dont il élève son propre fils. Pourtant, il marche dans ses pas, notamment dans le mélange de dignité, d’amour et d’abnégation dont il fait preuve. Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs de nos parents, au moins dans la façon dont nous élevons nos enfants ?
Bonne question. Je ne pense pas qu’on soit « condamnés » à reproduire ces erreurs, mais je pense que c’est très dur de ne pas le faire. On internalise l’exemple donné par nos parents : tant de ce que nous connaissons du monde nous vient d’eux ou de notre enfance. S’ils ne nous montrent pas le bon exemple, c’est l’un des obstacles les plus ardus à surmonter si nous voulons devenir meilleurs. Parce que cet héritage fait partie de notre nature finalement, et résister à sa propre nature, c’est difficile.
Vous pensez donc que ce que nous acquérons passivement pèse davantage sur la manière dont on vit et réagit que ce que nous acquérons consciemment ?
Je pense que ça dépend de qui nous sommes quand nous naissons, de ce que nous portons déjà en nous. Si nous naissons avec des qualités acceptées par la société, alors nous ne devrons pas vraiment lutter pour surmonter ce bagage. Mais si nous naissons avec certains instincts plus ou moins problématiques, ça devient difficile de résister à cette nature. Et ça demande alors une vraie force de caractère de prendre les bonnes décisions, de ne pas suivre cette nature, de se dire « je vais faire mieux. »
La manière dont Henry éduque son fils, ce mélange de dignité, de haine envers lui-même et d’amour pour Junior, est-ce ancré dans leurs origines philippines ?
Je pense qu’en Amérique, des familles blanches, noires ou latinos de la classe populaire sont similaires à ce que je dépeins, au moins en partie. Mais ces spécificités que vous décrivez – ce côté philippin traditionnel dont vous parlez très bien –, sont authentiques. De fait, j’ai vraiment pu me baser sur ma propre expérience pour enrichir le livre.
Les Philippins sont des gens drôles, la culture philippine est très joyeuse, mais en ce qui concerne la figure paternelle, c’est une figure dominante.
Ce qui m’a frappé dans Abondance, c’est l’abondance de détails au sujet de l’environnement de Henry, des textures, des couleurs, mais aussi au sujet de ses propres sensations. Est-ce la manière que vous avez trouvée pour traduire le décalage entre l’abondance promise par la société de consommation et l’extrême pauvreté qui sourd de la vie quotidienne de Henry ?
Tout à fait, c’est une observation très juste. Je voulais écrire dans un style quasi-maximaliste pour mettre en valeur la surcharge sensorielle vécue par Henry. C’est typique, en tout cas dans les livres américains, d’écrire de manière très simple et épurée quand on parle de la pauvreté – et c’est très beau. Lucia Brown Berlinou Raymond Carver capturent le dénuement dans leur style, ce qui est d’ailleurs logique narrativement parlant. Pourtant, parce que j’étais intéressé par le matérialisme de notre culture, je trouvais judicieux ici que la plume reflète cet aspect maximaliste de l’expérience.
C’est pour cela que le roman commence dans un McDonald’s et s’achève dans un Walmart ?
Oui pour le Walmart. Pour le McDonald’s, je n’ai pas vraiment pensé au symbole : j’y ai travaillé étant plus jeune, et c’est là qu’on va pour manger. C’est comme si je n’y avais pas pensé parce qu’il n’y a rien d’autre aux États-Unis. On n’a pas de restaurants ou de cafés, mais des McDo.
On l’a souligné pendant ma première interview aux États-Unis et j’ai acquiescé, « oui c’est brillant, mais c’est un hasard ! »
Dans quelle mesure votre livre fait-il écho à ce que vivent les gens aux États-Unis aujourd’hui ?
Ce qui très dur pour un auteur au début de sa carrière, c’est de déterminer qui sont ses lecteurs. J’écris depuis plusieurs années maintenant, mais j’ai toujours du mal parce qu’on suppose que nos lecteurs appartiennent au moins à la classe moyenne, sont diplômés, etc. Mais la réponse à ce livre qui m’a le plus touché vient de personnes qui travaillaient dur, avaient lu le livre, traversaient une période difficile de leur vie et qui m’ont écrit ces magnifiques messages, qui m’ont dit qu’ils s’identifiaient à Henry et retrouvaient leur propre expérience dans ce qu’il vivait. Et bien plus que n’importe quel prix ou que la gloire, c’est ce genre de messages qui donne sens à mon travail d’écrivain.
Votre roman reflète donc réellement ce que vivent ces gens, en particulier en ce moment avec l’inflation et les problèmes économiques ?
Ici, il est question d’extrême pauvreté, et ça existe aux États-Unis, bien sûr. Mais je pense que même des personnes qui ont un travail stable, voire deux ou trois, qui ont une maison, se sentent écrasés par le poids constant de l’argent.
Une infirmière m’a écrit après la parution du livre. Elle avait donc un bon travail, mais elle était mal payée. Elle m’a confié qu’elle avait deux enfants, qu’elle avait vécu dans sa voiture pendant une semaine et qu’elle n’aurait jamais pensé voir cette expérience racontée dans un livre. Je pense à sa lettre très souvent.
Vous avez écrit ce roman pendant la présidence de Donald Trump et il se déroule à la fin de l’ère Obama. L’auriez-vous écrit différemment si vous l’aviez écrit aujourd’hui ? Auriez-vous modifié le moment auquel se déroule le livre ? Le message politique serait-il le même ?
Je ne pense pas que j’aurais changé quoi que ce soit parce que je ne suis pas sûr que la réalité américaine ait beaucoup changé en dix ans. La situation est toujours la même pour les employés et pour les pauvres aux États-Unis.
La date est un détail très ténu à la fin du livre, comme une pensée postérieure à l’écriture. Parce que quand mon livre est paru, en 2021, pendant la présidence de Trump, beaucoup de romans présentaient Trump comme le problème. Sauf que non.
Bien sûr ceux qui sont à la tête du pays contrôlent beaucoup de choses et ça pose question. Mais ce qu’on peut faire à notre niveau, c’est aider les autres au sein de sa propre communauté.
Pour moi, le lien entre Abondance et La Route de Cormac McCarthy était évident, malgré les différences entre les deux livres. Je pense à la relation père/fils, au fait qu’ils soient seuls face au monde et sans abri. Était-ce délibéré de votre part ?
Pas du tout. Bien sûr, je l’avais lu, peut-être dix ans plus tôt, mais je n’y avais pas pensé. C’est l’un des auteurs qui a écrit une phrase d’accroche pour Abondance, Mark Doten, qui m’a fait voir les similitudes. Il a écrit « Jakob Guanzon nous offre La route du capitalisme américain ». Ça m’a réjoui mais je n’avais pas vu le parallèle avant.
Quelles sont vos influences alors ?
J’en ai tellement. Je vais en oublier, mais je mentionne toujours James Baldwin pour ce roman en particulier parce que j’aime la manière dont il est à la fois poétique et politique : pour moi, il a trouvé l’équilibre parfait.
J’aime Nabokov, je lis Kafka. Ce sont les trois auxquels je me rapporte toujours, ainsi que Toni Morrison que j’adore.
Il y a tellement d’auteurs contemporains que je vais oublier… je vais me cantonner aux classiques.
Mais je suis très attiré par les « stylistes », ce qui me vaut d’être critiqué puisqu’on considère mon travail excessif, too much, trop stylisé en fait. Alors que ça me semble juste naturel.
Je pense pourtant que vous avez réussi à trouver un équilibre parce que votre style reflète le message de votre livre.
D’ailleurs, la traduction française est particulièrement juste et fluide : avez-vous beaucoup échangé avec Charles Bonnot ?
Charles est mon héros. Quand on a vendu le livre aux États-Unis à Greywolf, une petite maison indépendante, les droits n’avaient pas été achetés à l’international. Quand le livre a été nommé pour le National Book Award, Douglas Stuart, l’auteur de Shuggie Bain, a écrit un tweet, et ça a eu un effet boule de neige. Charles m’a �écrit un mail, me disant qu’il avait découvert le livre et que l’histoire l’avait beaucoup touché, étant père lui-même. Il m’a demandé s’il pouvait le traduire et bien sûr, j’ai accepté. On a continué à échanger des mails amicaux et puis on s’est rencontrés ...

















