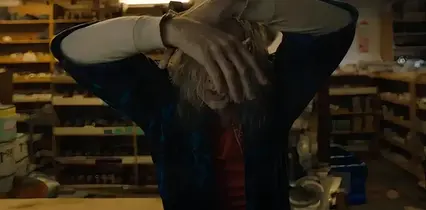A l’occasion de la sortie de son dernier film, Cent mille milliards, Virgil Vernier nous parle de son rapport au corps des comédiens, des images que l’on regarde pour se faire du bien, mais aussi du miracle. Rencontre.
Dans vos films, on retrouve une espèce d’anachronisme très pertinent. Vous mélangez souvent des aspects mythologiques voire magiques avec des environnements contemporains. Comme s’il fallait convoquer des figures anciennes pour supporter la violence du monde actuel.
C’est une interprétation intéressante. Je ne peux qu’approuver ce que vous dites. Il y a une vision dominante, laïciste, qui se méfie de tout ce qui est religieux, qui ricane face à toutes les superstitions. Mais, au fond, j’ai l’impression qu’il n’y a jamais eu autant de goût pour l’ésotérisme, les conspirations, la lithothérapie, plein de choses que j’ai mises dans mon dernier film. La bourgeoisie, avec son bon goût, s’en moque pour montrer à quel point elle est supérieure aux classes populaires.
Les classes populaires auraient un goût pour ces choses-là ?
Elles l’ont toujours eu. C’est une constante dans l’histoire ce besoin d’explication par l’irrationnel, par des zones de mystère. C’est juste que c’est mal vu par le cinéma et par les intellectuels.
J’ai l’impression que d’autres cinéastes français font entrer une dimension imaginaire dans des films plutôt réalistes. Récemment dans Eat the night, Caroline Poggi et Jonathan Vinel ont exploré l’univers du jeu vidéo. Est-ce qu’il n’y aurait pas de plus en plus ce mélange étonnant et nécessaire ?
Une génération encore plus jeune a sûrement besoin de fuir un réel violent dans lequel on se sent impuissant. Face aux injustices du monde, nous avons toujours besoin de nous échapper, que ce soit par des drogues ou des jeux vidéo. Le cinéma a eu besoin de ça. Dans le néoréalisme italien déjà il y a avait besoin de sortir des impasses du réel par la convocation d’un Dieu ou d’un miracle.
D’ailleurs parfois vous faites des montages avec des images trouvées sur internet. On a l’impression que ce seraient des sortes de nouvelles icônes. Les gens vont croire �à ces images-là, ultra-contemporaines.
J’adore le mot icône que sans doute je ne comprends qu’à moitié, je pense que c’est vraiment ça que je cherche : quels sont les nouveaux totems ? Les nouvelles images qui, aussi superficielles soient-elles, captivent l’attention des gens et leur font du bien, les fascinent, et dans lesquelles ils projettent plein de peurs et de fantasmes ? J’ai essayé de les évoquer dans mes films d’une manière plus ou moins frontale. Je tourne autour de cette question tout le temps, c’est sûr.
Et comment choisissez-vous ces images ? Comment ces idées vous viennent-elles ?
Sur Cent mille milliards, par exemple, cette idée des heures miroirs, cette idée que parce qu’il est 21h21 ou 22h22, il y aurait un miracle, une connexion cosmique entre des individus, m’intéressait. De la même manière que la période de Noël évoque une période suspendue, les heures ne sont plus les mêmes, le temps passé ensemble n’est plus le même. On s’ennuie, on regarde tout le temps son téléphone, on commence à voir des choses qu’à d’autres moments on ne verrait pas. Voilà, la question c’est : « Que se passe-t-il entre le 24 décembre et le 31 décembre ? » J’ai voulu travailler à partir de ce moment. Il y a plein de natures mortes dans le film qui rappellent ça. Le film joue beaucoup avec la numérologie.
Votre cinéma reste néanmoins réaliste.. Mais est-ce que vous seriez ouvert à des effets visuels ? Ou restez-vous fidèle à la réalité ?
Le réalisme est un mot qui a une longue histoire. Je me suis toujours fixé la limite de ne pas filmer avec quelque chose qui serait fabriqué par le film. J’ai envie que la magie provienne de la simple observation du réel. De révéler ce qu’il y aurait de magie. Dans une certaine tradition européenne du cinéma, on ne veut pas aller vers le grotesque. Pire que ça, je me suis toujours interdit de filmer quelque chose qui ne pouvait pas arriver si la caméra n’était pas là. Si je me force à provoquer des situations qui seraient fabriquées par le film, c’est un peu une forme d’interdit et je me dis : « c’est encore plus beau d’aller révéler ce qui a déjà lieu dans notre monde ».
Donc vous prenez des acteurs qui ne sont pas professionnels. Ce choix a du sens. Comment les choisissez-vous ? Les dialogues sont-ils écrits ou y a-t-il une part d’improvisation ? Puisque vous voulez faire advenir quelque chose qui serait déjà dans le réel, est-ce que vous leur permettez de construire leur personnage ?
Pour moi les dialogues c’est personnel, presque comme son propre corps. Je serais mal à l’aise de demander à quelqu’un de dire mes mots comme si c’étaient les siens. Les mots qu’on utilise sont très intimes. Je choisis des gens que j’aime profondément et j’épouse tout chez eux. Les accidents de langage, c’est ce qui vient d’eux et que je ne peux ni inventer ni diriger. Je leur confie le personnage. On en discute ensemble. Je leur demande : « Est-ce que t’es le genre de personnage à faire comme-ci comme-ça ? Est-ce que tu penses que le personnage pourrait faire ça ? » Et ensemble on travaille les limites et la caractérisation des personnages pour qu’ils soient totalement à l’aise pour les jouer. Qu’ils soient suffisamment à l’aise parce que ce n’est plus eux et qu’ils peuvent se livrer un peu plus qu’ils ne le feraient par pudeur face à une caméra. Au cours des mois avant le tournage, nous cherchons les contours que nous dessinons ensemble. Je ne peux pas forcer les choses, je choisis des gens qui ressemblent à ce que j’avais déjà imaginé pour le film mais je fais toujours le ...