
Premier recueil d’Etienne Ruhaud publié chez Unicité en 2020 et récemment traduit en roumain, Animaux est un monstre de poésie qui en défrisera plus d’un. Tenant de la zoologie imaginaire, de la science-fiction gore, mais aussi d’un parti pris à la Francis Ponge, ce bestiaire horrifique constitue autant un paysage mental des plus secrets qu’une méditation singulière sur le vivant grouillant et sanguinolent qui pourrait surgir derrière le placard ou sous votre lit.
J’aime l’araignée et j’aime l’ortie
Parce qu’on les hait
Victor Hugo.
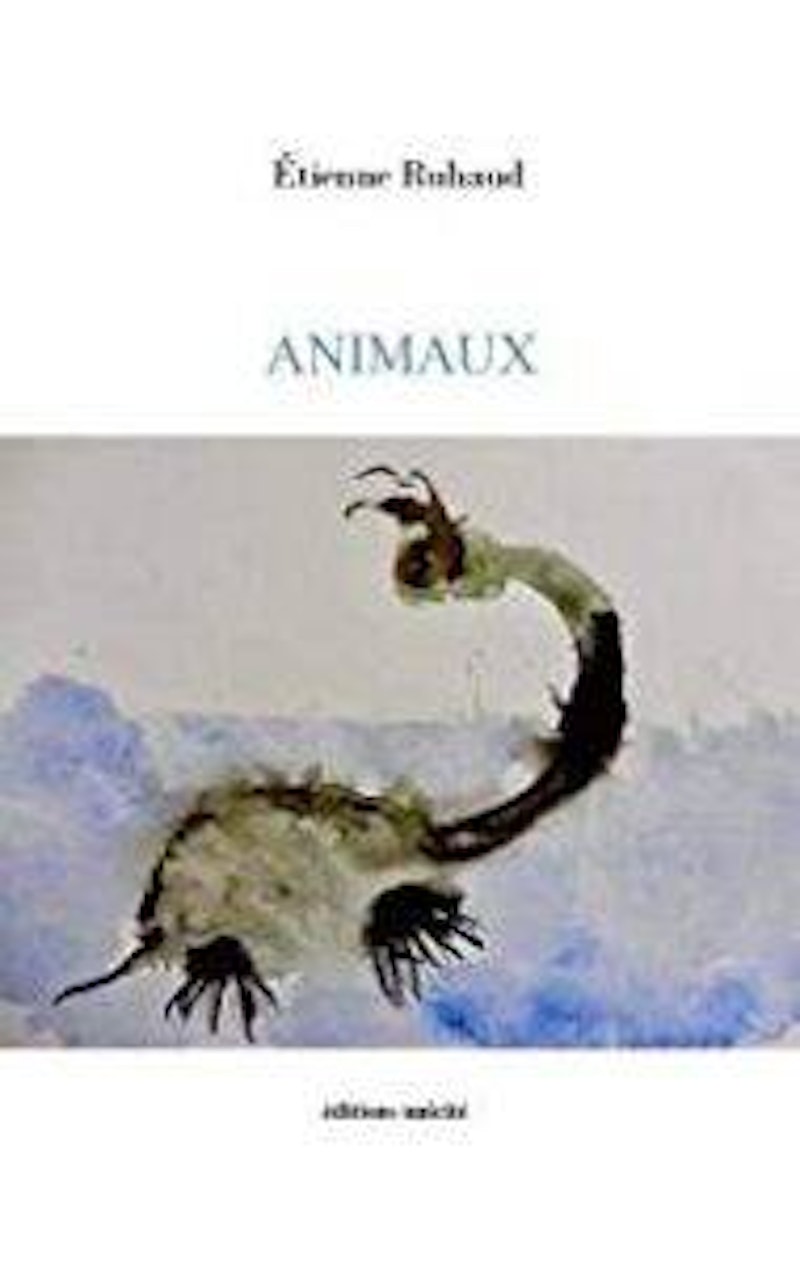
Un précis de mastication
Comme une machine de Sade, le cycle de la nature s’est mis en branle tandis que l’écriture terriblement tellurique de Ruhaud s’est mise au service de cette broyeuse – créant une étrange horreur objective
Au début, on a du mal à voir à quoi ressemblent ces bestioles (veut-on les voir en fait ?). Et puis, d’un coup, on les voit trop – et non pas tant par leur forme générale qu’il sera toujours difficile d’identifier que par les dégâts, sinon les massacres qu’elles provoquent autour d’elles. Par exemple ces « baignoires » du fond des abysses qui ouvrent le recueil. Décrites comme des « bassins circulaires dont les bords sont constitués d’écailles mauves, grandes comme la main, dures comme le roc », on peine à les distinguer même si on pressent d’emblée quelque chose de menaçant. La suite le confirme : attirés par une odeur ferrugineuse que cette baignoire dégage, poissons, coquillages et crustacés y sont attirés avant d’être « électrocutés, puis aspirés vers la bouche, trou noir et rond, au centre » où ils seront broyés, digérés, puis expulsés comme excréments, eux-mêmes « consommés par des crabes microscopiques ». Le bassin était une bouche, la baignoire, un estomac – et quoiqu’immobile, son territoire s’étend à chaque ingestion, « lente et silencieuse conqu�ête ». Comme une machine de Sade, le cycle de la nature s’est mis en branle tandis que l’écriture terriblement tellurique de Ruhaud s’est mise au service de cette broyeuse – créant une étrange horreur objective (nous allions dire « olfactive »). Tout ne sera plus alors que dévoration, manducation, mastication, sécrétion, déglutition et pour finir transformation générale des matières en d’autres matières, engrais tout usage, excroissance sans fin des freaks. Ainsi de ces « kraps », « bizarres batraciens sans queue ni pattes », au « corps marron et pustuleux », à « l’odeur de soufre et de merde » et qui se désagrègent « dans une explosion de sang, de tripes et de vermine (…) dont les restes très fertiles [nourriront] la terre » et engendreront de nouveaux kraps. Ou de ces « bôlces », « gigantesques citrouilles roses, plissées, couvertes de traits rouges semblables à des veines », et dont on pourra faire « des décoctions censées vaincre la stérilité ». Sans oublier le sang des « kabutos », sortes de giga-araignées « ornées d’yeux articulées et mobiles », que l’on vend sur le dark net pour la surprenante raison que leur liquide « qui évoque le mercure, durcit à la cuisson pour former un métal bleu roi très apprécié en joaillerie, et dont la valeur dépasse celle de l’or ». Ici, le précis de décomposition se fait loi du marché ; l’organique, contrat social. L’écosystème est un capitalisme comme un autre. Même si gare aux « rostres », sorte de rochers marins carnivores qui engloutissent tout ce qui passe. « Plusieurs pécheurs ou plongeurs impudents y ont laissé la vie, avalés par le rostre centenaire ».
Un art de la monstration
Hors Antonin Artaud ou Lautréamont, peu d’auteurs se seront aventurés dans l’origine intestinale du Logos.
À chaque page, son carnage. À chaque description, les mots qui font mal. « Visqueux », « nervuré », « acide », « surface qui ronge la peau jusqu’au muscle », « grattoir en os » pour les seuls « béguons » – dont le suc sert quand même de colle pour assembler les huttes. C’est que la nature, tel le vouloir-vivre aveugle cher à Schopenhauer, est la suprême industrie qui fait dans la destruction féconde, le recyclage éternel, la boucherie sans fin. À ces monstres, il fallait un art de la monstration – celui d’Etienne Ruhaud dont l’écriture belle et bizarre (pléonasme baudelairien) épouse à merveille la matérialité horrifiante de ceux-ci. Aucune « explication » scientifique ou philosophique dans ce texte à la splendeur brute et déplaisante qui ne se contente que d’établir, et c’est le tour de force de l’auteur, des présences pures, hors de tout sens, bouleversements fixes, réel sans cause. La poésie n’est là que pour montrer les choses, les nommer, les fixer et selon cette méthode tout pongienne de la « description-définition », voire du « proême ». D’où d’ailleurs la difficulté de la citer en extrait tant c’est par bloc entier qu’elle fonctionne et donne ce sentiment d’irréalité à force d’être trop réelle (ou le contraire). La preuve avec ces « braïns », joyau du recueil, et que nous citerons entièrement :
Des poissons dans la tête.
Ça vous entre par la bouche, le nez, les oreilles, pendant le bain dans la rivière. Des œufs microscopiques qui éclosent entre les méninges en grouillement millimétrique d’alevins rouges, nourris du liquide céphalo-rachidien qui les baigne.
Pas de migraine, mais une perte de la mémoire avec parfois de bizarres changements d’humeur, de thymie. Les braïns piquettent la pie-mère de multiples scléroses vertes, petites souillures, varicelle du cerveau.
Tout cela ne va pas sans un humour des plus subtils que l’on aurait tort de ne pas goûter. Par le « vous » de « ça vous entre par la bouche », l’auteur nous insère sans crier gare dans son texte (quand nous disions que c’étaient nous les proies de ces créatures !), comme il va bientôt confondre une certaine histoire de l’humanité à celle de son bestiaire finalement pas si inapprivoisable que ça. Ainsi de ces scorpions géants que « l’Etat utilise pour éliminer les gêneurs » et grâce auxquels « opposants marginaux et délinquants ont (…) disparu de la cité, réduits en charpie, enterrés en fosse commune, loin des regards » (en voilà une police efficace !). Ou de ces bourdons géants que les enfants peuvent monter pour des promenades aériennes (comme Harry Potter montait un « hippogriffe » à Poudlard). Ou encore de ces crabes énormes, « cyclopes crustacés » dont « le pas fait trembler la Terre » mais « qui acceptent toutes les contraintes à condition d’être convenablement traités ». Les monstres domesticables ! Les horribles bestioles bisounours ! Les lunules Luna Park ! Tant pis pour les petits enfants qui auront été dévorés par des vers de terre carnivores à la forme de pénis géant, il ne fallait pas les laisser sans surveillance, voilà tout (Les « limaces »).
Humour et horreur viennent de la seule autorité de l’écriture qui, comme le dit dans sa préface Jean Renaud, ancien professeur de l’auteur, tout en « feignant de suivre le réel (…), le précède » sinon « l’invente ». C’est en effet le mot qui fait la chose, la phrase ou le vers qui créent l’univers – et avec une immanence qui ne s’en laisse pas conter. Le poète dit les choses comme si elles allaient de soi. De l’arbitraire, il fait du nécessaire. De l’informe, une fort inquiétante information. La matière, c’est-à-dire l’écriture, naît de sa propre évidence. Le langage de son propre dégorgement. Un peu comme ces « truffes » qui poussent au fond de l’œsophage et qui, « recrachées peu avant la mort, sont gravées de barbouillis semblables à des runes ». Le langage comme reflux gastro-oesophagien. Le poème comme rune des gargouillis. Hors Antonin Artaud ou Lautréamont, peu d’auteurs se seront aventurés dans l’origine intestinale du Logos. Etienne Ruhaud les rejoint à son niveau. Ses Animaux auraient pu s’appeler Animots.
- Étienne Ruhaud, Animaux, Unicité, 2020.
Illustration : In the tower of sleep, André Masson, 1938.

















