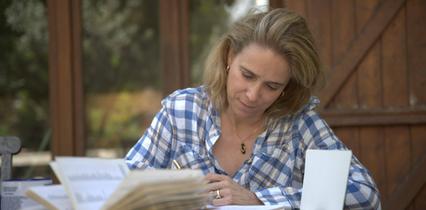Du 2 au 19 juillet, le centre d’art contemporain La Supérette de Malakoff accueille l’exposition La terre retombe au soleil, réunissant treize artistes issus de lʼÉcole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et de lʼÉcole des Arts Décoratifs-PSL. Sélectionnés et accompagnés par clome, collectif de jeunes commissaires d’exposition et étudiants du Master 2 « L’art contemporain et son exposition » à Sorbonne Université, ces derniers proposent une réflexion sur l’omniprésence des discours collapsologiques et les effets de leur rhétorique sur notre manière d’habiter le monde.
La collapsologie, symptôme d’un imaginaire saturé par la peur du futur
En expansion constante depuis les années 1920, la science-fiction façonne les imaginaires collectifs et piège l’individu entre deux résolutions paradoxales : devoir échapper à la fois à un passé traumatique et à un avenir catastrophique. Basé sur des conjectures scientifiques, ce genre narratif propose des univers utopiques ou dystopiques, alternatives à notre réalité ou conséquences de nos agissements passés et actuels. Assiégé par une mémoire qui ne présage que le pire et les craintes qu’elle suscite pour l’avenir, le présent devient lui-même un espace-temps auquel il faudrait se soustraire. Comme un bruit de fond de plus en plus sonore de notre quotidien, la collapsologie naît de cette peur de voir les denrées élémentaires (eau, nourriture, habillement…) disparaître ou devenir financièrement inaccessible. Mais craindre sans cesse un effondrement à venir et sa relative imminence ne revient-il pas à occulter la déliquescence qui s’opère aujourd’hui ? Et si les théories effondristes étaient le lieu de fuite ultime de notre système politique et sociétal ? Toujours est-il que ces discours affolent, et génèrent ce que clome désigne comme « un besoin collectif de fuite en avant ».
L’inertie comme résistance à l’affolement
Structurée en trois épisodes de quatre jours chacun, « Ailleurs si j’y suis », « J’aimerais mieux ne pas » et « Je te revois avant », l’exposition La Terre retombe au soleil vient interroger notre rapport au monde et au temps, modifié par l’omniprésence des systèmes de pensées propageant le catastrophisme. « J’aimerais mieux ne pas », l’épisode en cours le jour de notre visite, est une invitation à l’inertie comme une résistance à cet affolement. En réponse à la double injonction de produire et de consommer, ce deuxième temps du cycle incite à y désobéir par le repos, la flânerie et le loisir de prendre le temps.
Entre les murs blancs immaculés de cette supérette de quartier qui n’en n’est plus une, les visiteurs déambulent, lents et attentifs, premier pari réussi pour ce deuxième mouvement de l’exposition. À l’entrée, l’artiste Apolline Régent ouvre le parcours en investissant l’encadrement de la porte. Dans une suite de petits tableaux disparates, certains où elle écrit, d’autres où elle dessine, elle atteste d’un sens aiguisé du détail, à la fois spontané et réfléchi. Sans liens apparents, les œuvres tendent, par leur ensemble, à nous faire nous poser la même question : « À quoi suis-je sensible, et qu’ai-je envie de garder en ce monde ? » Cette proposition, judicieusement placée à l’entrée, introduit habilement le propos.
Transformer la matière, recomposer les récits
Une fois passé le seuil, le regard cherche où se poser en premier. Là encore, il s’agit de prendre le temps et on le prend volontiers en se déplaçant d’abord entre les œuvres, comme pour ne pas céder à la tentation d’y voir un ordre établi, ou peut-être pour y chercher le sien. Entre les créations, il y a de l’espace, de la place pour en faire le tour, comme des temps de pause offerts à soi-même. La possibilité d’une trêve offerte par cet épisode réside dans son invitation à s’arrêter, s’approcher, se pencher, s’accroupir parfois, pour saisir le message et le sens.
Que ce soit en taillant le bois ou en gravant le papier, Maëlle Lucas-Le Garrec puise son inspiration dans les récits populaires, notamment issus de la culture bretonne. Comme si les objets qui s’y rattachent avaient traversé le temps pour reprendre forme sous nos yeux, ils rappellent un monde ancien dont elle révèle des fragments en creusant des reliefs délicats, des plis, des fêlures. Dispersés dans l’espace, les objets en bois ponctuent notre itinéraire, comme une scansion poétique au croisement de l’archive et de la nouveauté.
Fragments sensibles d’un monde qui brûle
Entre le mur et la longue baie vitrée, l’espace se traverse comme une pérégrination erratique ; on ne manquera probablement pas l’installation modulaire de Paola Bazelaire-Ferré trônant au milieu de la pièce, destinée à accueillir une performance proposant une relecture féministe du mythe d’Orphée et d’Eurydice, ni les vêtements peints par Alice Coquelle, inspirés de la cosmologie. Pour ce qui est des fragments de poèmes de Céline Groman, glissés presque secrètement dans les interstices de de la pièce, les microcosmes de Lizelor Perez peuplés de pantins et encore d’autres fractions d’univers, il faudra consentir à ralentir, opérer peut-être un mouvement du corps alternatif pour se livrer à la contemplation.
De la photographie au bois, en passant par le texte, le dessin ou encore le textile et le plâtre, les matériaux et les géométries variables forment un ensemble riche et foisonnant sans être excessivement prolifique, ce qui engage une errance agréable. Dans ce deuxième mouvement de La terre retombe au soleil, le collectif clome parvient à suggérer une hypothèse sécurisante : face à l’urgence d’un monde qui brûle, peut-être nous reste-t-il l’ultime pouvoir d’en protéger les détails, en particulier ceux que l’on juge essentiels à la préservation de notre mémoire et au prolongement du présent qui continue, malgré tout de s‘écrire.
- Exposition La terre retombe au soleil, du 2 au 19 juillet, La Supérette de Malakoff, collectif clome.
- Crédit Photo : ©Rémi Procureur.