
L’écume des jours, 1947
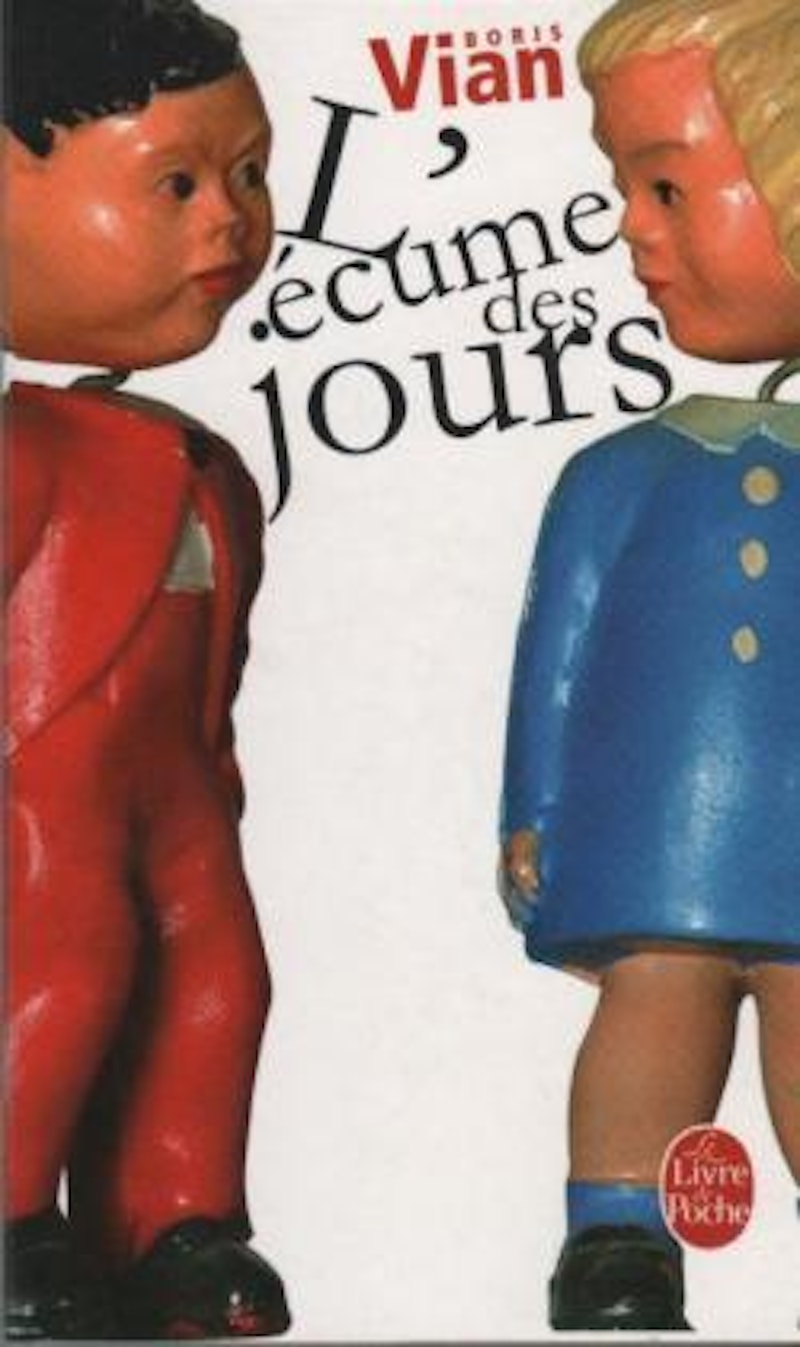
D’autres se faisaient parachuter par avion spécial (et l’on se battait aussi au Bourget pour monter en avion). Une équipe de pompiers prenaient ceux-là pour cible et, au moyen de lances d’incendie, les déviaient vers la scène où ils se noyaient misérablement.
D’autres, enfin, tentaient d’arriver par les égouts. On les repoussait à grands coups de souliers ferrés sur les jointures au moment où ils s’agrippaient au rebord pour se rétablir et sortir, et les rats se chargeaient du reste. Mais rien ne décourageait ces passionnés. Ce n’étaient pas les mêmes, il faut l’avouer, qui se noyaient et qui persévéraient dans leurs tentatives, et la rumeur montait vers le zénith, se répercutant sur les nuages en un roulement caverneux.
Seuls les purs, les au courant, les intimes, avaient de vraies cartes, très facilement reconnaissables des fausses, et, pour cette raison, passaient sans encombre par une allée étroite, ménagée au ras des maisons et gardée, tous les cinquante centimètres, par un agent secret, déguisé en servo-frein. Ils étaient, néanmoins, en fort grand nombre, et la salle, déjà pleine, continuait d’accueillir, de seconde en minute, de nouveaux arrivants.
– Extrait choisi par Pierre Poligone –
L’Automne à Pékin, 1947

C’est pour cela qu’il préférait passer par la ruelle. Ça lui rappelait le temps de son service militaire avec les Amerlauds, quand on bouffait du pineute beutteure dans des boîtes en fer-blanc, comme celles de l’oiseau mais plus grandes. Les ordures tombaient en faisant des nuages de poussière ; il aimait ça parce que cela rendait le soleil visible. D’après l’ombre de la lanterne rouge du grand six, où vivaient des agents de police camouflés (c’était en réalité un commissariat ; et, pour dérouter les soupçons, le bordel voisin portait une lanterne bleue), il s’approchait, environ, de huit heures vingt-neuf. Il lui restait une minute pour atteindre l’arrêt ; ça représentait exactement soixante pas d’une seconde, mais Amadis en faisait cinq toutes les quatre secondes et le calcul trop compliqué se dissolvait dans sa tête ; il fut, normalement, par la suite, expulsé par ses urines, en faisant toc sur la porcelaine. Mais longtemps après.
Devant l’arrêt du 975, il y avait déjà cinq personnes et elles montèrent toutes dans le premier 975 qui vint à passer, mais le contrôleur refusa l’entrée à Dudu. Bien que celui-ci lui tendît un bout de papier dont la simple considération prouvait qu’il était bien le sixième, l’autobus ne pouvait disposer que de cinq places et le lui fit voir en pétant quatre fois pour démarrer. Il fila doucement et son arrière traînait par terre, allumant des gerbes d’étincelles aux bosses rondes des pavés ; certains conducteurs y collaient des pierres à briquet pour que ce soit plus joli (c’étaient toujours les conducteurs de l’autobus qui venait derrière).
Un second 975 s’arrêta sous le nez d’Amadis. Il était très chargé et soufflait vert. Il en descendit une grosse femme et une pioche à gâteau portée par un petit monsieur presque mort. Amadis Dudu s’agrippa à la barre verticale et tendit son ticket, mais le receveur lui tapa sur les doigts avec sa pince à cartes.
– Lâchez ça ! dit-il.
– Mais il est descendu trois personnes ! protesta Amadis.
– Ils étaient en surcharge, dit l’employé d’un ton confidentiel, et il cligna de l’œil avec une mimique dégoûtante.
– Ce n’est pas vrai ! protesta Amadis.
– Si, dit l’employé, et il sauta très haut pour atteindre le cordon, auquel il se tint pour faire un demi-rétablissement et montrer son derrière à Amadis. Le conducteur démarra car il avait senti la traction de la ficelle rose attachée à son oreille.
Amadis regarda sa montre et fit « Bouh ! » pour que l’aiguille recule, mais seule l’aiguille des secondes se mit à tourner à l’envers ; les autres continuèrent dans le même sens et cela ne changeait rien. Il était debout au milieu de la rue et regardait disparaître le 975, lorsqu’un troisième arriva, et son pare-chocs l’atteignit juste sur les fesses. Il tomba et le conducteur avança pour se mettre juste au-dessus de lui et ouvrit le robinet d’eau chaude qui se mit à arroser le cou d’Amadis. Pendant ce temps-là, les deux personnes qui tenaient les numéros suivants montèrent, et lorsqu’il se releva, le 975 filait devant lui. Il avait le cou tout rouge et se sentait très en colère ; il serait sûrement en retard. Il arriva, pendant ce temps, quatre autres personnes qui prirent des numéros en appuyant sur le levier. La cinquième, un gros jeune homme, reçut, en plus, le petit jet de parfum que la compagnie offrait en prime toutes les cent personnes ; il s’en fut droit devant lui en hurlant, car c’était de l’alcool presque pur, et, dans l’œil, cela fait très mal. Un 975 qui passait dans l’autre sens l’écrasa complaisamment pour mettre fin à ses souffrances, et l’on vit qu’il venait de manger des fraises.
– Extrait choisi par Guillaume Narguet –
L’herbe rouge, 1950
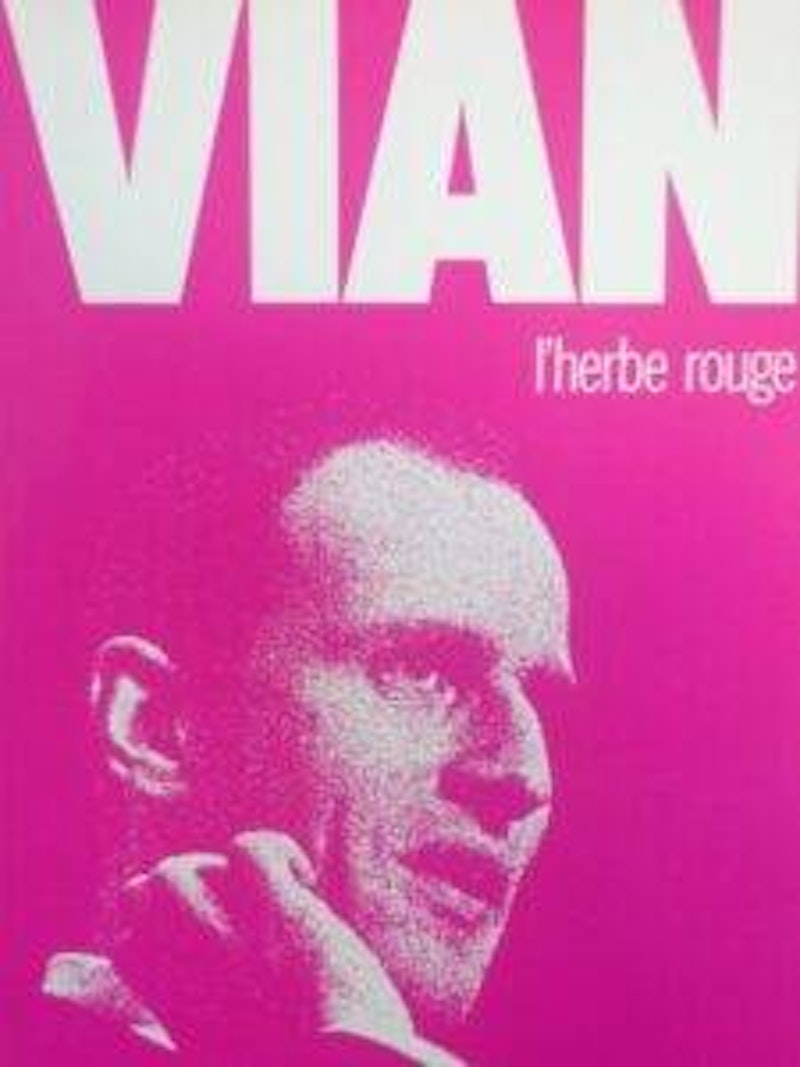
Maintenant, elle roulait jusqu’à la cheville un bas aux mailles impalpables, qui se densifia en petit flocon gris. Un second flocon le suivit et tous deux rejoignirent les souliers.
Les oncles des pieds de Folavril étaient laqués de nacre bleue.
Elle portait une robe de soie boutonnée sur le côté de l’épaule au mollet. Elle commença par l’épaule et dégagea deux boutons. Puis elle revint à l’autre extrémité, libérant trois attaches – une en haut, une en bas, deux de chaque côté. Il en restait une seule, à la ceinture. Les pans de la robe retombaient des deux côtés de ses genoux polis, et à l’endroit de ses jambes où tombait le soleil, on voyait trembler un duvet doré.
Un double triangle de dentelle noire s’accrocha à la lampe de chevet, et il n’y avait plus que le dernier bouton à défaire car le léger vêtement mousseux que Folavril portait encore au terme de son ventre plat faisait partie intégrante de sa personne.
Le sourire de Folavril attira soudain tout le soleil de la chambre. Fasciné, Lazuli s’approcha, les bras ballants, incertain. A ce moment, Folavril se dégagea complètement de sa robe et, comme épuisée, resta immobile les bras en croix. Pendant le temps que Lazuli mit à se déshabiller, elle ne fit pas un mouvement, mais ses seins durs, épanouis par leur position de repos, érigeaient inexorablement leur pointe rose.
– Extrait choisi par Alexandre Salcède –
L’arrache-coeur, 1953
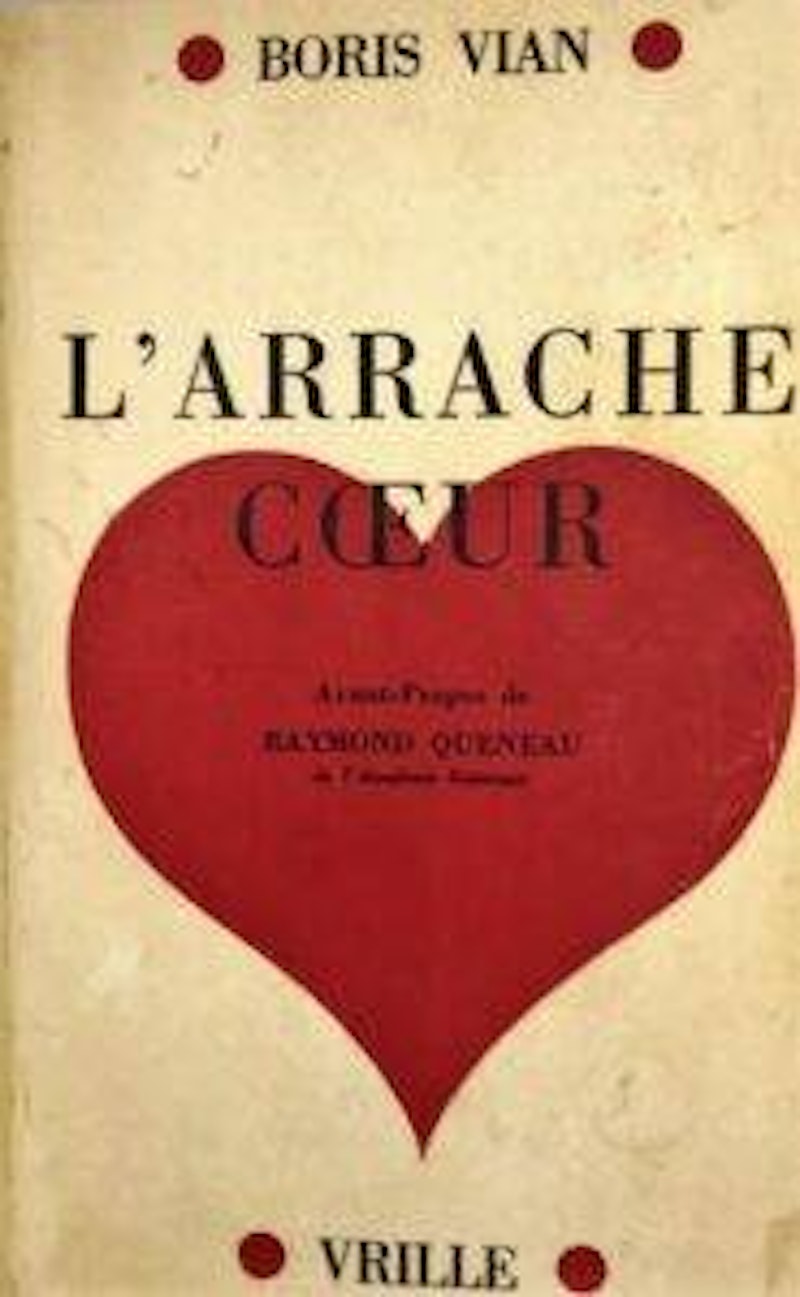
– Extrait choisi par Ariane Issartel –
Cent sonnets, 1997 (écrit entre 1940 et 1944)

Les mercantis, les villains traffiquans
Les fabricans de gasteaux à la terre
Voleurs, pillards, tous effrontez croquans,
J’aymerais voir au col de lourds carcans
Craignez qu’un jour le peuple vous punisse
Allez, feignez des regrets convaincans !
Et, priant Dieu que la guerre finisse,
Priez Satan que dure cent cinq ans
Grasse truande aux tres-laydes manières
Qui remplacez par des bijoux clinquans
Le bel esprict des dames de naguère,
Vous connaistrez des piques les piquans
Recouvrez-les, ces corps lourds et choquans
De laine fine et de doulce pelisse
Impregnez-les de parfums suffocans
Mais priant Dieu que la guerre finisse
Priez Satan que dure cent cinq ans.
Mourez de faim, nos enfans et nos meres
Roulez sur l’or taverniers fabriquans
De tord-boyaux à cinq louis le verre
Tombez, blessez, infirmes claudicans
Tombez, toujours, nul emploi n’est vacant
Pour l’innocent que dégouste le vice
Et vous, volez, volez en vous moquant
Mais, priant Dieu que la guerre finisse
Priez Satan que dure cent cinq ans.
– Extrait choisi par Hélène Pierson –

















