Dans son troisième roman, Lettres à Abel, paru aux Editions La Cheminante, Maï-Do Hamisultane s’essaye à un exercice de correspondance sans réponse qui interroge l’amour maternel et ses ramifications. Un livre qui explore avec sensibilité le domaine incertain du souvenir, à la fois éphémère et persistant, mais aussi la façon dont la littérature peut le cristalliser.
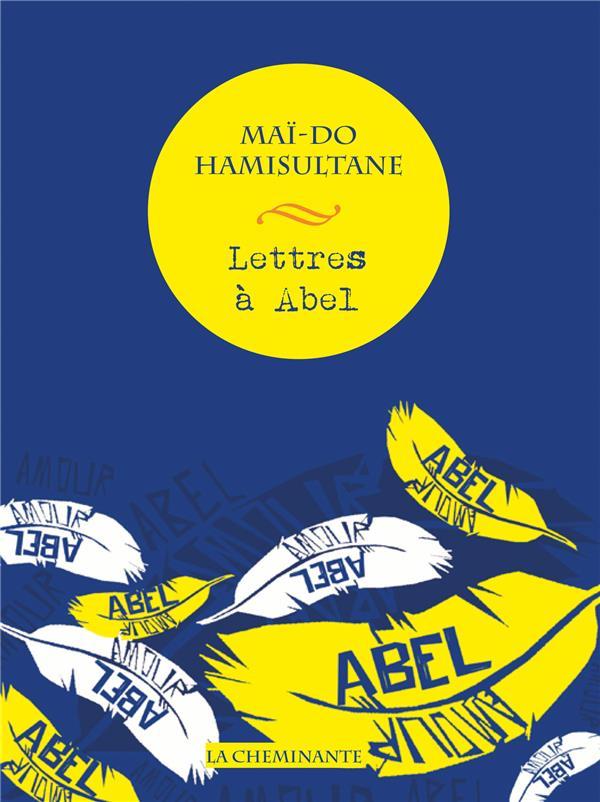
Dans ses Fragments d’un discours amoureux, Roland Barthes écrit au chapitre de « La lettre d’amour » que « celui qui accepterait les ‘injustices’ de la communication, celui qui continuerait de parler légèrement, tendrement, sans qu’on lui réponde, celui-là acquerrait une grande maîtrise : celle de la Mère ». La lettre d’amour maternelle a la capacité de s’opposer au silence, de continuer à tisser le lien amoureux par-delà la blessure de la séparation. En somme, une parole maternelle qui se suffit à elle-même. Dans son troisième roman, Lettres à Abel, paru aux Editions La Cheminante, Maï-Do Hamisultane interroge précisément cette « grande maîtrise » maternelle en la confrontant au récit en fragments d’une rupture amoureuse reconstruite à coups de visions obsessives, de séquences de vie, de bribes de conversations et de souvenirs exhumés au fil du récit. En s’adressant à son « tout-petit » Abel, la narratrice oppose le lien filial à la déchirure de l’histoire personnelle. L’amour maternel se veut l’incarnation de cet acte d’aimer, acte « absolu » qui « nous sépare du vide », pour reprendre l’épigraphe empruntée à Babouillec, jeune poétesse autiste dont la mère accompagne l’acte d’écriture. Des lettres en carton qu’utilise Babouillec pour écrire ses textes, aux lettres de la mère-narratrice à Abel, il y a cette même tentative de maîtriser le vide, d’écrire par-delà le silence.
Dans cet exercice de correspondance sans réponse, c’est bien le poids insoutenable du passé qui revient sans cesse hanter l’écriture.
Dès la première lettre, ce dilemme de l’écriture : « Il n’y a pas plus vivant qu’un souvenir qu’on prie d’oublier ». Dans cet exercice de correspondance sans réponse, c’est bien le poids insoutenable du passé qui revient sans cesse hanter l’écriture. Comme pour circonscrire sa blessure, l’auteure enferme son livre dans une structure en quatre parties qui correspondent aux quatre saisons de l’année : « Automne », « Hiver », « Printemps » et « Eté ». Structure circulaire qui interroge l’hypothèse d’un éternel recommencement : sort-on jamais de ses anciennes blessures ? Renaît-on jamais dans le regard de son enfant ? Dans chacune des quatre parties, dix lettres brèves, sauf dans la dernière partie où une onzième lettre semble porter à elle seule la promesse d’une cinquième saison : celle de l’écriture hors du temps, hors de l’espace, entre les paroles d’Abel suspendues au ciel d’un avion survolant Gibraltar, et le regard de la mère suspendu aux yeux de son fils. Rencontre d’un rêve d’enfance (« Ma Maman. Abel veut voler ») et d’une renaissance maternelle (« je pleure comme une femme enfermée dans une pièce sans lumière qui voit enfin le matin »). Entre la mère et son fils, un récit chargé de mots et de blessures : la rupture avec le père, les rêves interrompus, les décisions de justice, les allers-retours, les séparations, le goût de l’absence renouvelée et des retrouvailles éphémères.
Une écriture du ressassement
Au fil des lettres, Maï-Do Hamisultane donne forme à une écriture du ressassement. Chaque épisode de l’histoire personnelle est revisité maintes fois, comme si l’amertume du réel n’était approchable que par la reprise et la répétition. Ce ressassement trouve un écho dans le traitement de l’espace parisien. Arpenter Paris est une façon de fuir la mort, de résister à la double séparation en enchaînant les rencontres et les escapades. Au détour des pages, cette question : « Ça veut dire quoi une mère lambda ? ». Une mère qui sacrifie, qui se sacrifie ? Dans la vie du jeune couple, l’arrivée de l’enfant correspond à l’inattendu. « On s’était retrouvés tous les deux enfants de la parentalité », écrit la narratrice. Inversion du rapport filial : Abel incarne l’enfance des parents, leur éveil à la vie, leur initiation aux soubresauts de la destinée. En tant que destinataire symbolique des lettres, Abel est celui qui justifie l’acte d’écriture, la faisabilité de l’introspection, la tentative de dompter les territoires de douleur et de désillusion. En revenant sans cesse à Tanger, ville de son mariage avorté, la narratrice accepte de « se confronter aux souvenirs et les conjuguer au passé ». Face à Paris, capitale des déchirures intimes et de « l’ingérence judiciaire », Tanger est la ville de l’intermédiaire fragile mais nécessaire : entre Atlantique et Méditerranée, entre opacité du deuil et puissance de l’imaginaire, entre bonheur d’une rencontre amoureuse et douleur d’une rupture subite. Dans Lettres à Abel, la narratrice se tient en permanence dans un entre-deux : son univers est tantôt menacé de s’écrouler sur de nouvelles ruines, tantôt porté par l’espoir de rebâtir son « nid d’amour » ou son château maternel. Ce n’est probablement pas un hasard si l’hôtel de la fête qui n’aura pas lieu s’appelle Le Mirage : une vision séduisante mais trompeuse, une fiction qui n’existe que dans le domaine incertain du souvenir.
La blessure des bonheurs fugaces
Le roman de Maï-Do Hamisultane est un livre sur la blessure de ces bonheurs fugaces qui s’éteignent au moment même où ils s’apprêtent à éclore. Comme ce Père Noël au restaurant : « Quand tu as voulu l’approcher », écrit la mère à son fils, « il avait déjà disparu ». Peu importe : Abel doit continuer à croire au Père Noël comme la narratrice doit continuer à traquer ce bonheur-mirage qui s’enfuit. D’où la dynamique du récit : revoir l’origine de la rupture, revisiter les scènes fondatrices, explorer les alternatives, interroger le rapport à la langue, à la religion, à la différence, s’égarer dans le tourbillon des mots blessants qui reviennent. La narration fragmentée finit toujours par inverser le paysage : les souvenirs se substituent aux blessures. Derrière la rupture, il y a l’univers du père, poétique mais furtif, « fait de livres, de saisons et de fleurs ». Dans la bibliothèque du père, Abel devient Ali Bébél, accompagnant sa mère dans la caverne conjuguée de la littérature et de la séduction. Entre Homère et Bowles, il y a déjà La Blanche, premier roman de l’auteure, et bientôt Le Marin de Gibraltar de Duras : une façon de redire la quête de l’amour absolu mais toujours incertain, toujours fuyant et insaisissable.
La tentation d’une parole consolatrice
Derrière le projet de la narratrice, il y a la mise en abyme de sa propre histoire déplacée dans un ailleurs géographique et culturel
Et si l’écriture était la seule terre d’amour qui résiste au « temps voleur de beauté » ? Et si la littérature était l’unique voie qui fait oublier le drame, opposant à « la clochardisation psychique » la compagnie des auteurs et l’ivresse des rencontres ? Ou est-ce là le prolongement d’un autre mirage par les mots ? Dans le royaume des Lettres, la narratrice, double de l’auteure, oscille entre deux activités. D’un côté, elle trouve dans les rencontres littéraires l’occasion de maintenir « un semblant de vie sociale » : lire les histoires des autres (Ivan Jablonka, Sylvain Tesson, Mahi Binebine) pour s’oublier et entretenir l’illusion de vivre. D’un autre côté, elle considère le projet de prendre le train d’Istanbul à Ispahan pour y commencer l’écriture de l’histoire de Leila Pahlavi, fille du Shah d’Iran : « une biographie dans une autobiographie », un voyage dans la neige et l’oubli. Comme elle, Leïla Pahlavi est une femme de l’entre-deux : entre l’être et l’oubli, entre l’Orient de la généalogie et l’Occident de l’errance, entre le drame d’un bonheur interrompu et la douleur d’une mère qui lui survit. Derrière le projet de la narratrice, il y a la mise en abyme de sa propre histoire déplacée dans un ailleurs géographique et culturel : « Donner de la couleur à un ciel qui n’était pas le mien » est plus qu’un défi. Dans l’univers du roman à venir, Abel devient Pachabel : promesse d’un autre bonheur inscrit à même les mots.
Ce roman à venir qui s’appellera Leïla et qui reprendra l’épigraphe de Chanson douce, roman d’une autre Leïla, sera dédicacé à Abel, comme l’autre livre était dédicacé à Emile, le fils de l’auteure. Références intertextuelles dans le vaste champ de l’amour maternel ou coïncidences de l’écriture autour du thème de l’errance (« Car il faut que tout homme puisse aller quelque part ») ? Autre lecture, autre écho : dans Le Fou du roi, dernier roman de Mahi Binebine, Abel est le prénom que porte le fils aîné du narrateur, le revenant des geôles du pouvoir et l’objet d’un autre amour maternel, par-delà le poids de la séparation et des années. Ecrit-on toujours dans le sillage des autres ? Peut-être mais « on n’écrit jamais que sur soi-même », insiste la narratrice de Maï-Do Hamisultane. On a beau affronter son histoire, échapper vers les territoires confondus de l’autobiographie et de l’(auto)fiction, les mêmes visions obscures reviennent hanter l’auteure et son texte, à l’image de cet oisillon mort, tombé de son nid car « trop jeune pour savoir voler ».
Voici donc le refrain du livre : repartir sans cesse à la quête de ces mots, fragments à la fois fragiles et surpuissants, éphémères et persistants, qui s’obstinent à (re)dire l’amour maternel, sans attendre de réponse.
C’est dire si Lettres à Abel est aussi un livre sur l’apprentissage : apprendre à survoler les terres de l’échec et de la désillusion, à relire les pages de son histoire à la lumière de l’écrit, à retrouver sa propre enfance dans le regard de son enfant, à promener sa plume dans la vie des autres, enfin s’initier à l’art de la tempérance et de la « grande maîtrise » maternelle dont parlait Barthes. Mais comment est-ce possible face à la douleur qui revient ? «� J’étoufferai ma blessure dans ma poitrine / Sans pitié pour mes flots de larmes » : les mots empruntés à Zaki Konsol, poète syrien ayant vécu en Argentine, suggèrent une lutte et un exil intérieurs au-delà du texte. « Tout est irréversible, sauf l’écriture », nous dit la narratrice : seule l’écriture autorise les va-et-vient, les déambulations et les échappées dans la « petite géobiographie » de l’être. Voici donc le refrain du livre : repartir sans cesse à la quête de ces mots, fragments à la fois fragiles et surpuissants, éphémères et persistants, qui s’obstinent à (re)dire l’amour maternel, sans attendre de réponse.
- Lettres à Abel, Maï-Do Hamisultane, Editions La Cheminante, 2017

















