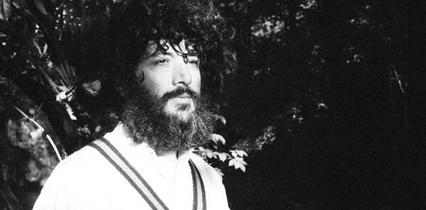Après ses démêlés avec la justice quand l’historienne de gauche radicale Ludivine Bantigny l’a accusé de diffamation, après son essai Comme une mule (éditions Stock, 2024) abordant cette affaire mais se donnant surtout pour tâche d’explorer, dans un registre léger (Bégaudeau a la joie têtue, option énervante pour certains) de possibles angles morts de la pensée militante, des angles morts de la pensée commune, des angles pas morts (vivants, donc) de l’art comme il l’aime, l’écrivain revient avec un essai qui se serait (peut-être) appelé Psychosociologies si ce titre ne drainait l’image en l’occurrence inadéquate d’un essai de sciences humaines. Psychologies n’est pas un essai de sciences humaines. C’est un assemblage de récits où la fantaisie de l’auteur s’adosse à une stricte observation du réel.
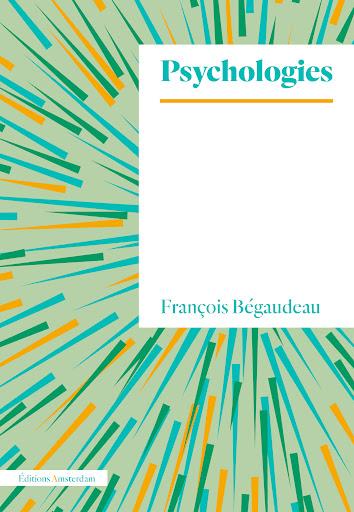
Parfois l’être humain est traversé par des sentiments magnifiques. Ainsi ma gratitude envers C. qui, sans même que j’ai eu besoin de le lui demander, véhicule chaque mercredi mon fils avec ses propres enfants au club de volley. Un poids en moins sur mes épaules, une vague d’amour (ou presque) dans mon cœur. Apercevant C., mon visage s’éclaire, je m’avance, son visage s’éclaire, je dis merci, c’est sincère, c’est profond, comme un puits. Et parfois l’être humain est traversé par des sentiments moins magnifiques. Ma jalousie (envers C. par exemple, ça tombe bien), des angoisses, nos angoisses, nos détestations, les petits calculs de nos mesquineries, j’en passe et des meilleurs, ce que justement Bégaudeau, ici, ne fait pas : il n’en passe pas, il n’en zappe pas, et il ne fait pas que passer, il s’arrête, il plonge son regard, il saisit, il dépiaute.
Le voici dans un train. Sur les « sièges duo » juste devant, une mère a lancé sur une tablette un dessin animé pour sa fille. Cela fait du bruit. Un bruit qui dérange François. Et l’empêche de lire. Lire est une activité magnifique. À lire, l’on s’instruit, l’on s’ouvre l’esprit, les neurologues disent que l’on se calme, les profs disent que (oh tellement de choses et cent pour cent positives), les citoyens disent que lire c’est bien, bref : lire c’est bien et par conséquent la situation est claire. L’on a d’un côté le citoyen Bégaudeau problématiquement gêné dans sa lecture, et de l’autre une mère problématiquement adepte du plaquage de l’enfant devant l’écran afin d’avoir la paix. « Mon impeccable civisme me donne la permission de la juger inculte, irresponsable, mauvaise mère ».
La situation est claire mais finalement non, pas tellement. « Je m’en donne à cœur joie. Je me racontais que je vivais un sale moment – ma session de lecture perturbée – , je vis un très chouette moment. Ce n’est pas que cette situation m’empêche de lire, c’est que le plaisir que j’y prends a supplanté l’appétit de lire ». Et Bégaudeau de scruter son plaisir à critiquer. « Le jugement négatif porté sur cette femme contient en creux un éloge de moi. Tout jugement négatif est éloge en creux de celui qui le profère. […] Cette providentielle mère me fait éprouver et mesurer par la négative combien je suis du bon côté ».
Cela fait longtemps que Bégaudeau fait profession de s’auto-analyser. Dans Deux singes ou ma vie politique, paru en 2013, il nous projetait dans son esprit d’enfant, puis d’ado, puis d’adulte en construction, nous baladait dans ce chantier, en un geste littéraire non pas solipsiste (non pas nombriliste) mais simplement réflexif : Bégaudeau se plaçait devant le miroir, qui réfléchit ; quitte à observer l’humain il choisissait l’humain à disposition, l’humain le plus proche, celui qui aurait du mal à se dérober, celui qui serait forcé de se laisser ouvrir pour regarder dedans : soi.
Les passages « autocentrés » de Psychologies fonctionnent sur le même principe : l’auteur y allie le courage d’essayer de se regarder en face (prétentieux quand prétentieux, avili quand avili) au plaisir exploratoire d’aller dans l’humain, cette mixtures d’affects, de pensées, d’impensés.
“L’auteur allie le courage d’essayer de se regarder en face au plaisir exploratoire d’aller dans l’humain, cette mixtures d’affects, de pensées, d’impensés.”
Dans le train, le voyageur Bégaudeau se demande s’il faut adresser à l’embêtante une remarque. Lui demander, courtoisement (on n’est pas des chiens), de baisser un peu le son. Non. « Intervenir perturberait mon cap de gauche qui inclut la discrimination positive à l’endroit des prolos. Ces gens-là sont nos égaux mais tendance inférieurs ». (Coluche pas loin). « Il est tacitement recommandé de leur pardonner ce qu’on ne pardonne pas aux mieux lotis ; de leur passer leurs petites bêtises. Ruisselant de mansuétude je passe sa petite bêtise à cette mère adolescente ».
« Ruisselant de mansuétude ». Le travail de Bégaudeau ne se comprend pas – ou se comprend peu – en-dehors de sa dimension humoristique. Remplace « ruisselant de » par « plein de » et le livre n’existe plus. C’est dans « ruisselant » que se tient le livre. Et dans d’autres mots choisis non pas strictement pour-faire-rire (l’on ne sait jamais d’avance avec certitude ce qui fera rire) mais choisis en riant (on le suppose en tout cas), choisis par le rire lui-même à l’in...