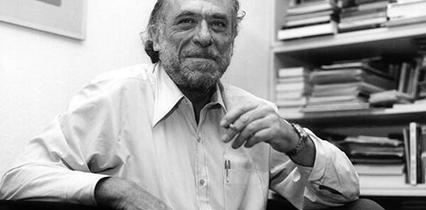ENTRETIEN AVEC EMMANUEL ROUX
Agrégé de philosophie et auteur, entre autres, de George Orwell. La politique et l’écrivain, Machiavel, la vie libre et de Michéa l’Inactuel, Emmanuel Roux consacre son dernier ouvrage, Guy Debord. Abolir le spectacle, à la figure de Guy Debord (1931-1994). Écrivain ombrageux, théoricien radical, cinéaste d’avant-garde, chef de file de l’Internationale situationniste et figure centrale de mai 68, Guy Debord ne cesse de susciter l’intérêt depuis sa disparition en novembre 1994. À l’occasion de la parution de son essai, nous en profitons donc pour interroger Emmanuel Roux sur la pensée, la vie et l’œuvre de celui qui écrivait : « Je trouverais aussi vulgaire de devenir une autorité dans la contestation de la société que dans cette société même. »
Ma première question ne s’adresse pas au spécialiste de l’œuvre de Guy Debord, mais au lecteur. Quand et comment avez-vous découvert l’auteur de La Société du spectacle et qu’est-ce qui vous a frappé au point de vous décider à lui consacrer un livre ?
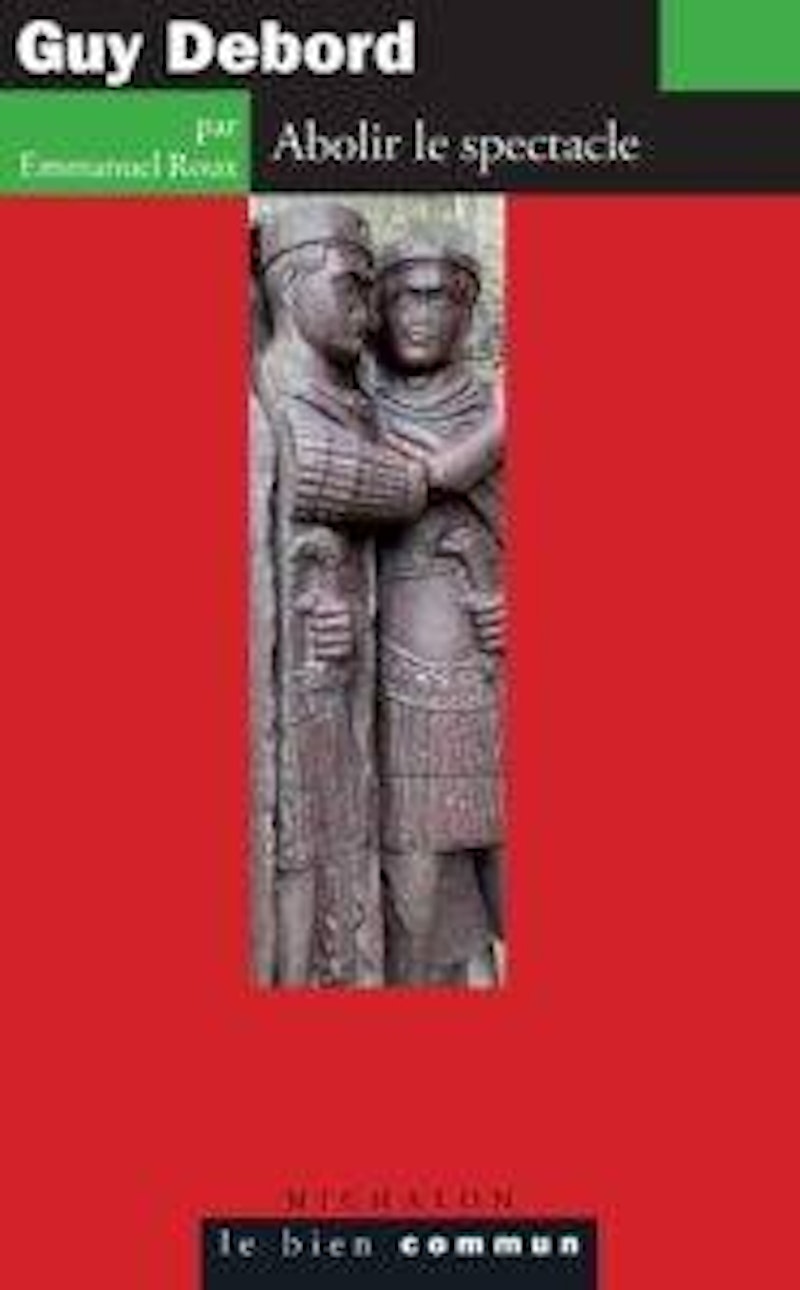
Pour illustrer la manière dont Debord était lu à cette époque, je prendrai l’exemple de deux livres parus à un an d’intervalle. L’essai d’Anselm Jappe sur Debord publié en 1995 montre toute la profondeur intellectuelle de son œuvre, alors que l’image de Debord à l’époque, diffusée notamment par Sollers, celle d’un grand styliste, d’un homme « de grand fond » pour parler comme Balthasar Gracian, mais qu’il faut absolument débarrasser d’un jargon marxisant daté. À contre-courant, l’apport de Jappe fut justement de montrer comment Debord s’était inscrit dans la théorie de la valeur. Aussi, le livre de Jappe n’a pas du tout eu le même écho médiatique (c’est peu de le dire) que le Pour Guy Debord de Cécile Guilbert paru en 1996 chez Gallimard qui avait fait l’objet d’une couverture médiatique abondante et élogieuse. L’esthétisation de Debord, avec la dépolitisation qui en était la conséquence (et le dandysme qui l’accompagnait), était à cette époque déjà bien enclenchée. Avec le recul, il me semble d’ailleurs que cette situation s’explique par les controverses sur l’interprétation et l’héritage de mai 68.
Il est impossible de vraiment prendre la mesure de ce qui se passe en France et dans le monde depuis le début du siècle sans rencontrer la notion de spectacle.
Pour ma part, je n’ai véritablement pris conscience de l’importance et de la profondeur de Debord que lorsque j’ai relu, il y a quelques années, les Commentaires sur la société du spectacle publiés en 1988, vingt ans après La Société du spectacle. J’ai été soufflé par la puissance prophétique d’un texte qui décrivait avec acuité la société dans lequel je vivais, et l’expérience sensible quotidienne que l’on peut faire de l’extension de la domination spectaculaire, avec ses phénomènes visibles et moins visibles, ses effets sur la culture, sur la diffusion des idées, sur le vivant, sur les méthodes de gouvernement, et sa capacité inédite à disperser toute contestation.
Je ne connais pas d’exemple aussi puissant d’un texte qui devient plus actuel et pertinent à mesure qu’on s’éloigne du temps où il a été écrit. Debord a saisi la qualité des temps de la société capitaliste postmoderne. Je prends l’expression « qualité des temps » au sens que lui a donné Machiavel, c’est-à-dire ce qui fait la singularité d’une époque qui ne ressemble à rien de ce qui a existé avant elle, ou alors qui radicalise des tendances historiques et politiques qui étaient jusqu’alors contenues, mais non portées à leur plein développement. De ce point de vue, Orwell avec 1984 et Debord avec La Société du spectacle puis les Commentaires sur la société du spectacle me paraissent être les deux penseurs politiques les plus importants de la seconde partie du XXe siècle, ceux dont les intuitions ont été confirmées par la suite.
L’impression faite par la lecture des Commentaires m’a conduit alors à lire toute l’œuvre et à voir tous les films de Debord. Or, on voit que ses intuitions, nées dans sa jeunesse des années 1950, se sont extrêmement tôt centrées sur cette notion de « spectacle » à laquelle il va donner un contenu esthétique, politique, économique, philosophique, et dont il ira jusqu’à dire qu’il transforme l’art de gouverner lui-même. Il est aujourd’hui impossible de vraiment prendre la mesure de ce qui se passe en France et dans le monde depuis le début du siècle – et même avant – sans rencontrer la notion de spectacle. J’ai alors conçu mon travail comme une invitation à le lire à partir de cette notion centrale. Mon but a été de permettre une appropriation de Debord pour pouvoir déchiffrer la séquence historique et politique dans laquelle nous vivons, celle d’une société qui intensifie la séparation en son sein, y compris à l’intérieur de chacun de nous, entre une part spectaculaire et une part anti-spectaculaire, comme si c’était désormais sur le plan existentiel que se jouait aussi le combat entre la valeur d’échange et la valeur d’usage.
Comment définiriez-vous, justement, le spectacle ? La Société du spectacle, l’essai majeur de Debord publié en 1967, s’ouvre sur une phrase qui détourne l’incipit du Capital de Marx : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles ». Cette notion de « spectacle » est sûrement l’un des concepts les moins bien compris de la pensée de Debord, qui l’a pourtant défini à maintes reprises, en précisant notamment qu’il ne s’agissait « pas [d’] un ensemble d’images, mais [d’] un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images ». Est-ce de cette filiation avec Marx qu’il faut partir pour comprendre cette notion ?

Avant d’entrer plus avant dans le détail du concept, pour la clarté du propos il faut préciser que lorsqu’on parle du « spectacle » on parle du capitalisme. Dans les Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici parues en 1984, Debord affirme : « il y aura bientôt vingt ans, j’ai qualifié toute une phase très importante du capitalisme, un siècle entier, du nom qui lui restera ». Si on laisse de côté la question de l’historicité du spectacle, il est clair que Debord était convaincu que la notion de spectacle permet de qualifier le ressort profond du capitalisme tout en étant capable de cerner ses transformations et leur signification politique, c’est dire les effets de ses transformations sur la cité.
L’idée que le spectacle est un « rapport social » est capitale pour comprendre qu’il n’est pas d’abord une façon de décrire la passivité de l’individu devant les représentations médiatiques d’un monde sur lequel il n’a plus de prise. L’origine brechtienne de l’idée de spectacle, et donc la métaphore d’un monde théâtral de la séparation entre acteurs et spectateurs, a pu laisser penser que le monde décrit par Debord était celui de la conscience déchirée et dépossédée d’un monde qui n’est plus le sien et qu’elle ne peut plus que contempler. À partir de cette approche, le risque est de réduire le spectacle à l’« excès du médiatique » pour parler comme Debord. Or le « médiatique » est un effet, un phénomène du spectacle, qui n’est bien évidemment pas neutre eu égard à l’emprise spectaculaire, mais qui n’est pas « le » spectacle. Car, comme vous l’avez justement rappelé, le spectacle étant d’abord un rapport social, il faut remonter à quelque chose de plus originaire.
Dire que le spectacle est un rapport social, c’est comprendre en quoi un rapport social donné produit le monde comme spectacle c’est-à-dire comme dépossession et contemplation. Or ce qui produit un tel monde, c’est le processus par lequel l’homme, en tant que travailleur, est dépossédé de son travail dans la production de la marchandise. Car ce qui caractérise la marchandise c’est l’inversion de la téléologie vitale à laquelle se livre le capitalisme, et dont Marx, à la suite d’Aristote, entreprend de dévoiler les mécanismes au cœur de la révolution industrielle. Le premier d’entre eux, qui aboutit à la théorie du « fétichisme de la marchandise », est la transformation de la valeur d’usage en valeur d’échange, du travail « vivant » en travail « abstrait », de la force de travail en marchandise. Dans une formule géniale, Debord écrit que « La valeur d’échange est le condottiere de la valeur d’usage qui finit par mener la guerre pour son propre compte ». La valeur d’échange s’autonomise, elle devient la finalité de la production. On peut parler d’inversion de la téléologie vitale dès lors qu’on ne produit plus un bien pour une utilité pratique, mais en vue d’un profit monétaire, ce qui ouvre la voie au processus illimité de l’accumulation et conduit à la réification de l’homme, ce dernier devenant une quantité dans le processus de production. L’originalité de Debord est d’établir une continuité directe entre la marchandise et le spectacle dans la mesure où l’intensification du « devenir-marchandise » des choses produit un monde dans lequel l’homme devient spectateur du monde, de la société et de lui-même. Passer de l’ « accumulation de marchandises » à l’ « accumulation de spectacles », c’est passer de la dépossession du travailleur qui contemple la marchandise qu’il créé à la dépossession de l’homme qui contemple le monde en tant que monde de la marchandise.
Or, l’idéologie qui accompagne ce phénomène, et qui constitue aussi le spectacle, a pour effet de dissimuler cette matrice fondamentale marchandise/spectacle, de l’invisibiliser, de la soustraire à toute contre-emprise, de neutraliser toute force sociale et politique qui tenterait de la renverser, c’est-à-dire de remettre le monde à l’endroit, de restaurer la valeur d’usage au détriment de la valeur d’échange, le travail « vivant » au détriment du travail « abstrait », ou, comme le dit Debord avec son laconisme si efficace, de « s’émanciper des bases matérielles de la vérité inversée », que Debord définissait comme « l’auto-émancipation de notre époque ».
Pourtant, s’il est indispensable de rappeler d’où part Debord et dans quelle tradition critique il s’inscrit, il semble que la notion de spectacle ait largement débordé sa dimension marxiste initiale. Comment Debord l’a-t-il fait évoluer dans son œuvre ?
Bien sûr, cette dimension économique du spectacle n’épuise pas ce concept, sinon on pourrait considérer que la notion de « spectacle » qualifie une plus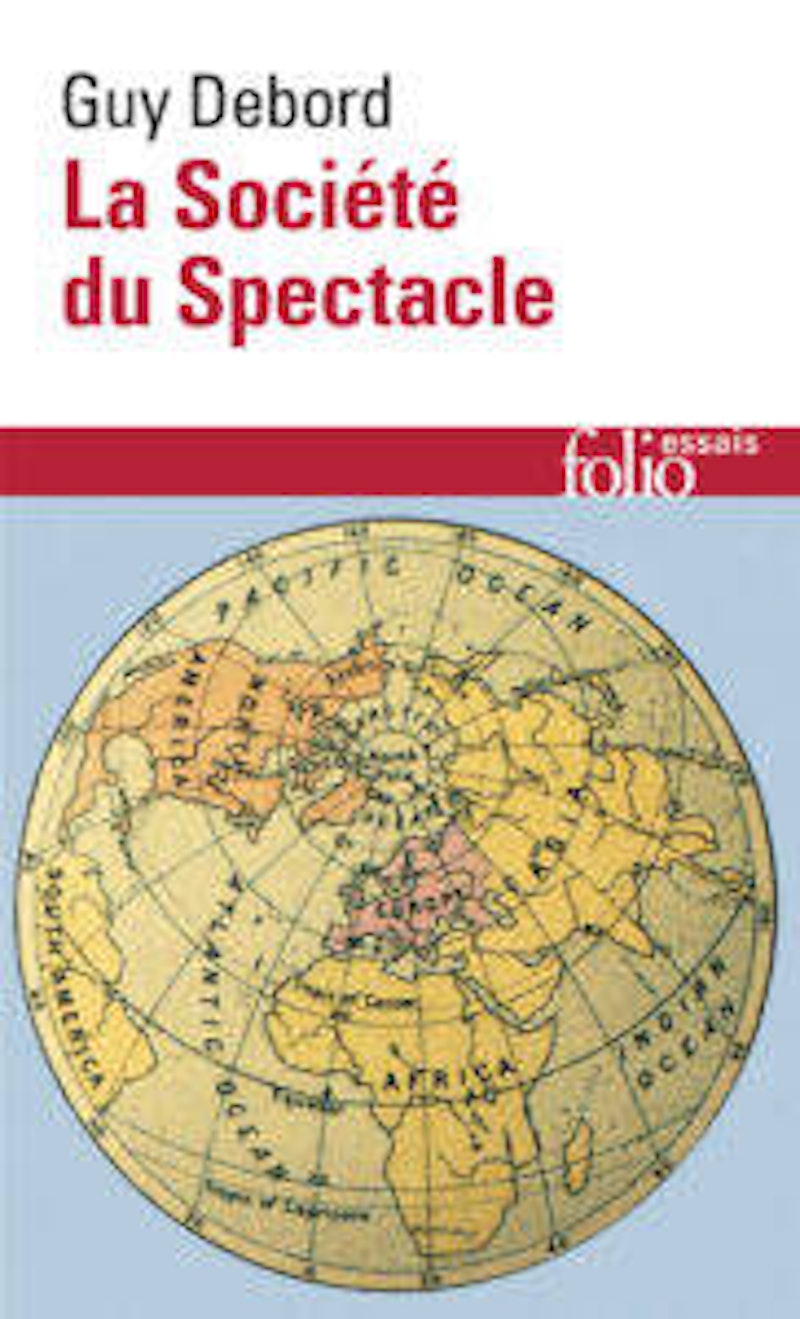
L’idée de « gouvernabilité » permet d’insister sur la question de savoir comment les sociétés se gouvernent, au-delà du rôle des institutions publiques ou parapubliques ; comment elles produisent de l’ « ordre » et du « désordre », du « réglage » et du « dérèglement », toujours au bénéfice du renforcement du spectacle en tant que rapport social. Les Commentaires sont en très grande partie consacrés à cette question. Or, Debord y fait évoluer la notion de « spectacle » de deux manières. D’une part, le terme est progressivement remplacé par des formulations plus politiques telles que « le gouvernement du spectacle », « l’autorité générale du spectacle » ou « la domination spectaculaire » ; d’autre part, il développe le concept de « spectaculaire intégré » (par opposition au « spectaculaire diffus » avant les années 1970 et 1980) qui se caractérise par le fait que le spectacle s’est « intégré dans la réalité même à mesure qu’il en parlait », comme dit Debord. Schématiquement, le spectacle a connu deux phases depuis l’après-guerre : dans un premier temps les représentations du réel qu’il produisait partaient d’un réel non spectaculaire ; dans un second temps c’est le réel qui devient conforme à ce qu’en attend le spectacle, le réel devenant lui-même spectaculaire, n’étant rien au fond s’il ne peut pas être transformé en spectacle. Dire que le spectacle s’est intégré dans la réalité, c’est dire que l’accès au réel devient de plus en plus « médiatisé » par le rapport social du spectacle. Nous en avons tous les jours des dizaines d’exemple dans notre vie quotidienne.
L’intensification du « devenir-marchandise » des choses produit un monde dans lequel l’homme devient spectateur.
Ce règne du « spectaculaire intégré » présente selon Debord cinq traits : le « renouvellement technologique incessant », la « fusion économico-étatique », le « secret généralisé », le « faux sans réplique » et le « présent perpétuel ». Chacun de ces traits mériterait un développement. Je voudrais simplement insister sur l’idée que Debord pose là les piliers d’un nouveau régime de vérité fondé sur l’adhésion passive à la transformation du monde et aux flux et contenus de représentations qui accompagnent cette transformation afin d’en rendre irréversibles ses effets de servitude. Car, par cette emprise hégémonique, le « spectaculaire intégré » a deux conséquences concrètes dont la description est au cœur des Commentaires : d’une part l’évanescence de la vie non spectaculaire et du régime de vérité qui était le sien (fondé sur l’existence d’une communauté civique, de « corps intermédiaires », de la possibilité d’une agora politique et intellectuelle, d’une raison collective, de lieux soustraits à la domination et au marché, etc.) ; d’autre part la dispersion de toute réelle contestation de l’autorité spectaculaire, contestation qui devient inaudible, invisible, falsifiée, criminalisée, ou bien « critique spectaculaire du spectacle », fausse contestation, leurre, ce que Debord appelait la « critique sociale d’élevage ».
L’évanescence de la vie non spectaculaire et la dispersion de la contestation renforcent le gouvernement du spectacle qui, persévérant dans son être, s’adonne à une sorte de propagande permanente de lui-même et de ses « bienfaits », au point de devenir toujours plus intolérant à mesure qu’il règne sans partage. « La servitude veut désormais être aimée pour elle-même », écrit Debord à ce sujet. Cette propagande est fondée sur une tautologie circulaire : le spectacle est bon parce qu’il n’y a rien d’autre que le spectacle, il n’y a rien d’autre que le spectacle parce qu’il est bon. Il me semble que notre époque est entrée depuis quelques années dans cette phase de propagande spectaculaire, de cette propagande incessante du spectacle par lui-même, lui qui détient « la production économique présente, et la puissance de communication dont elle [cette « production économique »] s’est armée » (Panégyrique) !
D’où l’importance des réseaux d’influence, car cette phase est marquée par les liens, apparaissant désormais au grand jour, entre la communication, les outils de la fabrication de l’opinion, le pouvoir économique et la décision politique. Cette phase de propagande, qui ne tolère plus une dissidence pourtant de plus en plus fondée à contester un ordre social et économique aux effets destructeurs sur le vivant, marque une radicalisation du spectacle dont on voit bien se dessiner la tendance autoritaire. Cette radicalisation, Debord l’avait pressentie dès 1978 dans son film In girum imus nocte et consumimur igni lorsqu’il évoque « ce paysage dévasté par la guerre qu’une société se livre contre elle-même ». Le recours au vocabulaire de la guerre est d’ailleurs devenu la norme, comme Debord en eut l’intuition à la fin des Commentaires lorsqu’il annonce une « relève » dans la « caste cooptée qui gère la domination » qu’on reconnaîtra au fait qu’elle agit telle la foudre3.
Debord écrivait dans La Véritable Scission dans l’Internationale : « il n’y a pas de“situationnisme” comme doctrine ». Néanmoins, la notion de « situation », qui donne son nom au mouvement, est au cœur des théories de Debord, notamment au sujet de l’architecture. Pourriez-vous préciser ce que Debord et certains de ses comparses, commeAsger Jorn, entendent par le terme « situation » ?
C’est une question importante, car si la notion de « situation » est centrale dans la pensée de Debord et dans le rôle qu’il a eu au sein de l’I.S, elle n’a jamais revêtu une dimension conceptuelle aussi structurée que celle de « spectacle ». La notion de situation a un aspect pratique et existentiel extrêmement fort. C’est dans la « situation » que l’art en tant que représentation s’abolit et se réalise. « Les arts futurs seront des bouleversements de situations, ou rien » écrit Debord dès 1952. Le situationnisme est né de cette volonté de construire une science pratique des situations (l’expression « une science des situations » est très ancienne puisqu’elle apparaît dès le premier film de Debord Hurlements en faveur de Sade), d’où sont sorties la théorie de la « dérive » (« un jour on construira des villes pour dériver »), la « psychogéographie », l’ « urbanisme unitaire », le « jeu », etc.
Pour Debord et ses amis, la création de situations est la traduction de leur refus d’un monde séparé. La situation que l’on crée abolit toute distance entre l’individu et un monde déjà là en faisant surgir des « possibilités d’organisation de la vie quotidienne ». Mais, très vite, ces jeunes gens comprennent que la création de situations dépend justement de cette capacité collective d’extériorisation libre, d’autonomie, d’abolition de la spécialisation du monde, de remise en cause d’un réel déjà structuré, compartimenté, qui assigne à chacun sa place. La possibilité des situations vient buter sur la division, la non-participation, la séparation, c’est-à-dire le spectacle. Dans mon livre, j’ai voulu précisément insister sur l’importance de ces années pour Debord, avec la nécessité de passer d’une critique esthétique et existentielle de ce qu’il commence à appeler le « spectacle » à une critique culturelle, philosophique et politique, notamment dans le cadre de l’I.S à la fin des années 1950, mais aussi grâce à la rencontre avec le groupe « Socialisme ou Barbarie » de Claude Lefort et Cornelius Castoriadis, ainsi qu’avec Henri Lefebvre dont la Critique de la vie quotidienne a eu une influence importante.
Dans ce que je considère comme son premier grand texte, Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire, qu’il écrit avec Daniel Blanchard (membre de « Socialisme ou Barbarie »), on trouve cette phrase qui annonce tout ce qui va venir : « La création de situations et l’abolition de la séparation sont une seule et même chose ». Or, abolir la séparation revient à abolir ce qui va se révéler être, justement, le spectacle. Pour ce faire, le passage par Hegel, Marx et une certaine tradition marxiste (notamment Karl Korsch, Anton Pannekoek, Georg Lukács, Rosa Luxembourg, etc.) va être décisif. C’est pourquoi je dis souvent que pour comprendre Debord il faut comprendre pourquoi et comment il est passé d’André Breton à Marx, puis de Marx à Machiavel.
Si l’on trouve des continuateurs de Debord chez les participants de l’Encyclopédie des nuisances ou du côté de théoriciens de la nouvelle critique de la valeur comme Anselm Jappe, on peut également s’étonner de son influence chez plusieurs acteurs de l’industrie du divertissement et de la communication. Je pense ici à certains représentants du premier « esprit Canal + » comme Michel Hazanavicius et son « grand détournement » ou à des publicitaires, comme Jacques Pilhan qui fut le conseiller en communication de François Mitterrand et l’inventeur du marketing politique. Le nom même de « Société du spectacle » fut un temps utilisé par une société de production de télévision appartenant à la multinationale Endemol, spécialisée dans la téléréalité. Debord lui-même brocardait dans son ouvrage La Véritable Scission dans l’Internationale ces « pro-situs » « occupés par la consommation devenue révolutionnaire ». Comment expliquez-vous cette récupération paradoxale de Debord par les artisans d’un système qu’il a passé sa vie à dénoncer ?
Il y a vraiment beaucoup de choses dans votre question ! Mais elle permet d’abord de redire l’importance du moment 68 pour Debord, à la fois pour lui, pour le mouvement situationniste, mais aussi pour toute la suite de son œuvre littéraire et cinématographique, qui est liée à 68. Pour Debord, mai 68 a été le moment inouï d’une création de situations en passe de renverser le spectacle. Et cette occasion a émergée un an après la publication de La Société du spectacle ! Imaginez : vous faites la théorie du moment historique dans lequel se trouve le capitalisme et de la nécessité de le renverser, et un an plus tard la révolution démarre exactement comme vous avez expliqué qu’elle devait le faire ! J’irai même plus loin : elle se finit exactement comme vous avez anticipé qu’elle finirait, non pas du fait des conservateurs et des réactionnaires qui reprennent le contrôle de l’économie et de la société, mais par des bureaucraties politiques et syndicales censées porter les idéaux et les aspirations du prolétariat !
Mai 68, pour Debord, est un moment où la division originaire de la société du spectacle se manifeste de manière directe dans un moment politique et social donné, dans lequel cette division originaire devient événement brut. Cette division originaire n’est plus, comme chez Machiavel, celle entre les « grands » qui veulent dominer et le « peuple » qui ne veut pas être dominé. La nouvelle division dans la cité est celle qui oppose le « prolétariat » – c’est-à-dire « l’immense majorité des travailleurs qui ont perdu tout pouvoir sur l’emploi de leur vie, et qui, dès qu’ils le savent, se redéfinissent comme le prolétariat »– et les forces du spectacle, organisées autour de la bourgeoisie, comprise comme toutes les autorités séparées et spécialisées, lesquelles, du fait de cette séparation/spécialisation, sont les ennemies de l’émancipation du plus grand nombre.
Or, en 68, le renversement de cette division originaire est directement l’objet et le sujet de la révolution qui débute. La société sans classes n’est plus ce qui doit advenir à la suite de la mainmise d’une bureaucratie soviétisée, elle est réalisée ici et maintenant dans la grève générale et l’occupation de tous les lieux de la domination. Debord et ses amis (dont Raoul Vaneigem, Mustapha Khayati, René Riesel et René Viénet) en ont fait le récit saisissant dès juillet 1968 dans Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations qui est vraiment un texte à lire et relire (tout comme De la misère en milieu étudiant paru en 1966).
Debord est probablement le seul grand penseur politique moderne à avoir aussi profondément construit sa pensée à la confluence de Marx et de Machiavel.
Mai 68 et son échec sera le grand événement de la vie de Debord dans la mesure où, dès les années 1970, il va privilégier désormais la question de la théorie de l’action politique et stratégique dans un contexte polémique continu. La réécriture idéologique de 68 installe en effet une guerre intellectuelle permanente au cœur de l’intelligentsia française et Debord en sera au centre, car elle touche intimement au devenir même du spectacle à travers plusieurs phénomènes concomitants et articulés : le renfort sociologique du spectacle avec l’enrôlement de l’étudiant « pro-situ » (voir le film In girum imus nocte et consumimur igni qui fustige « ces petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces “services” dont le système productif a si impérieusement besoin : gestion, contrôle, entretien, recherche, propagande, amusement et pseudo-critique »), la récupération économique de l’imaginaire culturel festif de 68, le recyclage politique et entrepreneurial de tous les leaders et acteurs influents des événements de mai qui ne veulent plus désormais renverser le spectacle mais seulement le gouverner. Cette neutralisation, et même ce renversement, de la puissance contestataire de 68 vont jouer un rôle clé dans l’efficacité de l’offensive néo-libérale des années 1970 et 1980.
Le dilemme de Debord a été au fond celui de tout penseur qui entreprend de dévoiler les mécanismes de la domination. Pour qui écrit-il ? Pour ceux qui entendent secouer leur joug ou pour ceux qui sont le plus à même de tirer parti de ce dévoilement pour le renforcer ? C’est la question de Machiavel, à l’envers. Spinoza et Rousseau avaient en effet affirmé que Le Prince de Machiavel était le livre des « républicains », car l’ouvrage apprenait au peuple à voir derrière les apparences. Ici les choses se renversent : et si l’œuvre de Debord ne servait pas d’abord les forces du spectacle en leur permettant de perfectionner les techniques de domination et de gouvernement des choses, à commencer par l’extension du règne de la marchandise et la dispersion de toute capacité à le contester ? Debord était parfaitement conscient de cette question puisque, au début des Commentaires, il affirme que la moitié des lecteurs qui vont vraiment s’intéresser à son livre « est composée de gens qui s’emploient à maintenir le système de domination spectaculaire ». Dans la passionnante biographie que François Bazin a consacrée à Jacques Pilhan, le conseiller en communication de François Mitterrand puis de Jacques Chirac (tout un symbole, cette continuité), on voit bien que ce dernier lisait assidûment Debord.
Le jeu sur les images et les représentations, leur articulation avec l’émergence du storytelling, la mainmise de la communication institutionnelle sur les contenus politiques, la gestion des temps et des séquences : tout cet art de gouverner, cette politique des apparences est d’autant plus efficace qu’elle s’accompagne de l’invisibilisation ou de la répudiation de la contestation, du « négatif », afin d’installer le pouvoir dans une sorte d’évidente permanence, de « présent perpétuel », d’impossibilité de changement réel. J’ajoute un dernier point : plus on avance dans la lecture des Commentaires, plus se fait jour la question des mystères du pouvoir, ces arcana imperii dont parlait Gabriel Naudé au XVIIe siècle dans ses Considérations politiques sur les coups d’État. Le spectacle perfectionne et même radicalise la signification politique du monde comme théâtre dont ce qui est montré se prépare en coulisses. À cet égard, n’oublions jamais l’importance du baroque pour Debord !
Debord bénéficie paradoxalement d’une assez bonne réception à la droite de l’échiquier politique. Si le freudo-marxiste d’Herbert Marcuse, la pensée libertaire de Raoul Vaneigem ou le maoïsme de Guy Hocquengheim n’ont pas toujours eu bonne presse chez les intellectuels de droite, Debord paraît faire l’objet d’un traitement particulier au sein de cette famille politique. Renaud Matignon, dans un article élogieux du Figarolittéraire paru en novembre 1993 et consacré à « Cette mauvaise réputation… » allait jusqu’à comparer l’auteur de La Société du spectacle à Georges Bernanos. Alain de Benoist, fondateur de la Nouvelle Droite, fut également l’un des premiers à saluer les Commentaires sur la société du spectacle à leurs sorties en 1988. Comment expliquez-vous la réception relativement positive de Guy Debord par une bonne partie des intellectuels de droite ? Est-ce son dandysme, le classicisme de ses écrits littéraires, son positionnement anticonformiste à gauche ou s’agit-il simplement d’un grand malentendu ?
La question que vous posez était à l’origine du livre que j’ai écrit sur Jean-Claude Michéa en 2017 : pourquoi un penseur que tout classe à « gauche » est-il rejeté par la « gauche » et encensé par la « droite » ? Comment, en s’inspirant d’Orwell, de l’anarchisme, de Pasolini, de Marx ou de Castoriadis, on finit par être complètement incompris par la gauche ? Comment a-t-on pu classer Michéa parmi les « nouveaux réactionnaires », voire les « rouge-brun » ? Je ne vais pas répondre ici en détail, mais je vais me risquer à des hypothèses qui peuvent valoir aussi, en partie, pour Debord.

Pour Debord, il me semble que c’est un peu différent. D’abord, il ne faut pas oublier que pour une partie de l’extrême droite le rejet du « mondialisme » aboutit à une forme d’anti-capitalisme. Ensuite, quelqu’un comme Alain de Benoist a pu avancer masqué jusqu’à un certain point en mettant en avant son « différentialisme » et son rejet d’un « universalisme » assimilé à la domination occidentale sur les cultures et les peuples non occidentaux. La « Nouvelle droite » a contribué de ce fait à l’essor intellectuel du décolonialisme. Pour d’autres penseurs classés à droite, je pense que l’attirance pour Debord peut venir de l’esthétisation dont j’ai parlé plus haut et peut-être aussi d’une nostalgie des temps non spectaculaires. Les pages que Debord consacre au Paris des années 1950 dans Panégyrique, ou de la bohème de la rue du Four dans son film In girum sont littérairement magnifiques. Il y a une forme de nostalgie pour la jeunesse d’une époque où la marchandise n’avait pas à ce point colonisé la ville, « supprim[é] la rue » ou transformé l’alimentation. Il y a plus de proximité qu’on ne pense entre le Debord du café Moineau et le Blondin du Bar Bac, par exemple. Blondin aurait aimé les moments de dérive, les échappées urbaines et les détournements artistiques.
Il y a aussi, à droite, toute une tradition littéraire qui place la forme et le style au-dessus de tout. Il est possible et même probable que la puissance d’écriture de Debord, sa créativité artistique, ses références culturelles, ou même son élitisme intellectuel aient pu produire cette fascination. Une certaine droite (peut-être la moins antipathique) adore les écrivains anti-bourgeois, de Barbey d’Aurevilly à Houellebecq, en passant par Léon Bloy, Bernanos, Drieu La Rochelle, Montherlant et même François Nourrissier ou Denis Tillinac !
Dans son petit essai Contre Debord (2004), le philosophe Frédéric Schiffter dépeint l’auteur de La Société du spectacle en une sorte d’essentialiste nostalgique et moralisant. Le critique écrit ainsi : « Incapable de se résoudre au fait que l’essence de l’homme n’est absente que parce qu’elle n’a jamais existé, le situationniste, qui préfère la croire fossilisée dans la marchandise, se résout encore moins à se satisfaire de la présence de ce qu’il appelle, avec horreur, ce « fétiche ». […] Le mot ressassé de “spectacle” n’en dit pas davantage que ces métaphysiques et ces morales pré-hégéliennes qui dénonçaient déjà, en leur temps, la dégradation d’une nature originelle et, partant, la déchéance des hommes. » Que pensez-vous de ces affirmations ? Debord ne serait-il qu’une sorte de néo-platonicien refoulé ?
Il y a toujours, dans ce type de textes, un aspect exercice de style sur le thème « je vais déboulonner une icône ». Il y a quantité de bons arguments pour discuter les idées de Debord et ses engagements. Moi-même, je suis parfois assez circonspect sur son catastrophisme désespéré (voir la conclusion de mon livre « Que faire de Guy Debord ? »). Il y a indéniablement un côté religieux, janséniste, chez Debord : l’ici-bas est mauvais, mais l’absolu étant inatteignable, détruire les idoles trompeuses qui prétendent mener quelque part est déjà une façon de se sauver du spectacle (et peut-être la seule pour Debord à la fin de sa vie). Pourtant, sauver la vie de son emprise spectaculaire est un combat que l’on peut mener ici et maintenant. Il faut se déprendre d’une position désenchantée et d’un quiétisme contemplatif dandy toujours très tentant.
Néanmoins, je ne pense pas que le taxer de « néo-platonicien » soit une critique qui porte car Debord est un penseur fondamentalement dialectique avec une volonté de saisir les métamorphoses permanentes du spectacle. D’ailleurs, Debord lui-même se définissait comme le « négatif » du spectacle. Dans les Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici il va même jusqu’à écrire qu’« en grande partie, le travail du négatif en Europe, pendant toute une génération, a été mené par moi ». Or, le « négatif », le « travail du négatif », qui est une formule par nature hégélienne, est le moteur même de la dialectique. Nous sommes donc là au cœur d’un matérialisme dialectique qui s’est précisément opposé à toute forme de fixisme ou d’essentialisme. Quand j’essaie de formuler ce que devient le spectacle au début du XXIe siècle, par contraste avec ce qu’il était vingt ans plus tôt, je m’efforce de repérer son devenir car précisément la puissance du spectacle est dans sa capacité de transformation, au premier chef la transformation du processus de transformation lui-même. Mais peut-être est-il platonicien au sens où le spectacle est une sorte de caverne dont il serait quasiment impossible de sortir ? Le débat est ouvert, je l’ouvre en tout cas dans la conclusion de mon livre.
L’œuvre de Debord semble structurée en deux grands blocs. D’un côté, ses premières productions, essentiellement théoriques, comprenant des essais comme le Rapport sur la construction des situations, Le Déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande, La Société du spectacle ou encore La Véritable Scission dans l’Internationale, ainsi que de nombreux articles publiés dans les revues Potlatch (1954-1957) ou Internationale situationniste (1958-1969). De l’autre, dans une seconde partie de sa vie, on est face à une œuvre beaucoup plus personnelle et assez inclassable, avec des livres comme Panégyrique, In girum imus nocte et consumimur igni, « Cette mauvaise réputation… ». Les titres, eux-mêmes, semblent marquer une rupture nette entre deux périodes de la vie de Debord. Qu’est-ce que le caractère profondément bicéphale de son œuvre nous dit de Guy Debord et de sa pensée ?
Je ne souscris pas tout à fait à cette périodisation. S’il est indéniable que La Société du spectacle marque une rupture avec les années qui l’ont précédé, elle ouvre en même temps une séquence qui se termine, pour moi, au début des années 1980, plus précisément avec les Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici en 1984, et qui ouvre une période pendant laquelle, jusqu’à sa mort, Debord est au corps à corps avec le spectacle, à la fois pour en dénoncer les falsifications (la presse l’accuse d’être impliqué dans l’assassinat de Gérard Lebovici), pour le dévoiler jusqu’au bout (Commentaires) et, enfin, pour créer une représentation infalsifiable de lui-même (Panégyrique I et II, « Cette mauvaise réputation… »).
C’est dans la « situation » que l’art en tant que représentation s’abolit et se réalise.
Avant la séquence 1984-1994, j’ai tendance à dégager deux périodes principales, celle qui va de l’Internationale lettriste à la publication de La Société du spectacle (1952-1967), et celle qui va de 1968 à 1984, marquée par la dissolution de l’I.S, le regard sur sa jeunesse et l’échec de 68, mais aussi le repérage des mutations d’un spectacle qui passe à l’offensive, mutations que Debord repère à travers la décennie 1970 en Italie. En plus d’être une excellente introduction à la notion de spectacle, la Préface à la quatrième édition italienne de la Société du spectacle publiée en 1978 est de ce point de vue un texte clé, qui fait le lien entre La Société du spectacle de 1967 et les Commentaires de 1988.
C’est la périodisation avec laquelle je me sens le plus à l’aise pour penser l’œuvre de Debord : le repérage du spectacle, sa conceptualisation politique et philosophique, l’analyse de ses transformations, puis la lutte pour garder la maîtrise de sa « réputation » face à un spectacle qui le constitue en mythe pour mieux le neutraliser et le récupérer. À titre plus personnel, la séquence qui va de la fin de 1968 à 1984 est pour moi d’une très grande fécondité pour saisir l’émergence de ce que Pasolini appellera avant sa mort en 1975 le « nouveau pouvoir ».
On relève chez Debord de nombreux paradoxes : militant et poète, théoricien anti-spectaculaire et néanmoins récupéré par les agents actifs de la spectacularisation marchande, figure libertaire bien accueillie à droite, avant-gardiste anti-moderne, etc. Une autre contradiction semble être au centre de la vie de l’auteur : Debord est à la fois la figure, presque paroxystique, du poète maudit, suicidé et solitaire. Il est le veuf, l’inconsolé, celui qui a « mauvaise réputation ». Mais il est également un véritable chef de meute, un fondateur de mouvements intellectuels, un directeur de revues, bref une figure fédératrice. Or, si le « conseilliste » Debord prône dans ses écrits « l’abolition de la hiérarchie », « la démocratie directe et totale » et « l’autogestion », l’organisation interne des structures qu’il a fondées semble plus proche du modèle autoritaire appliqué par André Breton aux surréalistes. Exclusions permanentes, bannissements – parfois violents – de nombreux membres, disgrâces pour des motifs divers et variés : mis à part Debord lui-même, quasiment aucun de ses camarades n’a échappé, à un moment ou à un autre, à l’excommunication. Pourriez-vous dire un mot de ce paradoxe ?
La question des exclusions est très compliquée parce qu’on touche à la personnalité de Debord et à sa conduite. Tant de choses ont été écrites et dites, qui ressortent souvent à la dimension spectaculaire du personnage. Il y a aussi, j’imagine, de l’amertume, des déceptions, de la tristesse venant de personnes qui ont vécu ces années-là. J’aime beaucoup ce que Raoul Vaneigem a pu dire de sa relation à Debord dans le livre d’entretien qu’il a fait avec Gérard Berreby précisément parce qu’il n’y a aucun ressentiment (Rien n’est fini, tout commence, Allia). J’aime aussi citer ce passage d’une lettre de Debord à Asger Jorn en 1962 à propos des exclusions au sein de l’I.L et de l’I.S et qui me semble bien exprimer les choses : « la pratique de l’exclusion me paraît absolument contraire à l’utilisation des gens : c’est plutôt les obliger à être libres seuls – en le restant soi-même– si on ne peut s’employer dans une liberté commune ». De même, Debord a toujours évité de devenir une sorte de « vedette » du situationnisme et a constamment préféré l’ombre à la lumière. Comme il le disait lui-même, acquérir une notoriété anti-spectaculaire dans le spectacle est une chose très rare, voire unique, a fortiori quand on a toujours traité le spectacle en ennemi. Cette notoriété a, en effet, été acquise sans faire la moindre concession à personne. Cette liberté, cette intransigeante fidélité à soi-même, ce refus absolu de parvenir, ont quelque chose de fascinant dans un pays aussi balzacien que le nôtre où l’arrivisme est un sport national !
Dans le premier tome de ses mémoires, Panégyrique – sûrement l’un de ses plus beaux textes–, Debord écrit : « Je me suis beaucoup intéressé à la guerre, aux théoriciens de la stratégie mais aussi aux souvenirs des batailles. » Joueur aguerri de poker, grand lecteur de Clausewitz et du Cardinal de Retz, créateur du « Jeu de la guerre » : pourriez-vous nous parler de l’intérêt particulier que portait Guy Debord à la stratégie ?
Pour comprendre la place de la stratégie chez Debord il me semble qu’il faut en revenir à la question de la « théorie » et au statut qu’elle a dans son œuvre. Il y a un passage dans sa correspondance qui me paraît capital : « Le travail principal qui me paraît à envisager maintenant, c’est la théorie de l’action historique. C’est faire avancer, dans son moment qui est venu, la théorie stratégique. À ce stade, et pour parler ici schématiquement, les théoriciens de base ne sont plus tant Hegel, Marx et Lautréamont, que Thucydide – Machiavel – Clausewitz. » (Lettre à Eduardo Rothe, 21 février 1974).
Debord a toujours ironisé sur le fait qu’il serait un « théoricien », qu’il aurait « pris les choses par la théorie ». D’un côté, il est exact que pour Debord théorie et pratique sont indissociables et qu’aucune préséance ne peut être accordée à la théorie. Mais, d’un autre côté, il accorde à la théorie la capacité d’éclairer une pratique sur elle-même à condition qu’elle soit déjà en mouvement. Par là, il s’inscrit dans le dilemme classique bien résumé par Orwell dans 1984 à propos des prolétaires : « Ils ne se révolteront que lorsqu’ils auront ouvert les yeux, et ils n’ouvriront les yeux qu’après s’être révoltés ». Les relations entre la théorie et la pratique sont dialectiques, donc circulaires. Une théorie éclaire et renforce une pratique qui sait déjà ce qu’elle veut et où elle veut aller. Mais encore faut-il que cette pratique ait surgi et qu’elle se soit emparée de la théorie lui permettant d’introduire une forme politique dans une matière sociale.
J’emprunte les concepts de « forme » et de « matière » à Machiavel, car cette relation entre théorie et pratique est profondément machiavélienne. Le Prince
Depuis 2012, une dizaine de thèses universitaires ont été consacrées à l’œuvre de celui qui se flattait d’être « docteur en rien », et ce dans de nombreux domaines (littérature comparée, philosophie, sémiologie). On compte également de très nombreux livres consacrés à sa vie et à son œuvre. Pour n’en citer que quelques-uns, nous pouvons mentionner la réédition de l’essai majeur d’Anselm Jappe à la Découverte en 2020, la grande et controversée biographie de Jean-Marie Apostolidès chez Flammarion en 2015, le joli livre d’Anna Trespeuch-Berthelot Guy Debord ou l’ivresse mélancolique paru en 2017, mais aussi les essais plus personnels de Laurent Jullier (Pérégrines) et Frank Perrin (Louison édition) parus respectivement en 2021 et 2022 et, enfin, votre livre publié il y a quelques mois.Comment expliquez-vous cette activité éditoriale foisonnante autour d’un auteur qui, selon ses propres dires, n’a jamais fait « aucune concession au public […] ni aux idées dominantes de [s]on époque » ?
Les acteurs influents des événements de mai 68 ne veulent désormais plus renverser le spectacle mais le gouverner.
Les livres que vous citez ont des angles différents et témoignent de la fécondité d’une œuvre qui a de très nombreuses entrées et qui se révèle d’une grande profondeur. Mais, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, les ouvrages en question ont des intentions, des ambitions qui sont très différentes. Pour ma part, j’ai abordé Debord dans la continuité de ma réflexion sur la fabrication de la pensée politique moderne au cœur d’une dialectique entre tradition libérale et tradition civique (tradition civique que Debord assume clairement, me semble-t-il, comme George Orwell et Simone Weil, deux auteurs clés pour comprendre la dimension politique de l’œuvre de Debord), ainsi que sur les liens entre l’écriture et la politique. La dimension politique de l’œuvre de Debord est donc au cœur de mon approche. J’ai aussi voulu présenter une pensée complexe de la manière la plus claire possible. C’est pourquoi ma démarche a été double : d’une part montrer et expliquer comment la pensée de Debord s’est construite et a cheminé ; d’autre part la présenter de manière à ce que son appropriation permette au lecteur de l’appliquer à l’époque afin de penser celle-ci avec plus d’acuité. Il y a une phrase de Debord dans la Préface à la quatrième édition italienne de La Société du spectacle que je trouve extrêmement suggestive : « On sait la forte tendance des hommes à répéter inutilement des fragments simplifiés des théories révolutionnaires anciennes, dont l’usure leur est cachée par le simple fait qu’ils n’essaient pas de les appliquer à quelque lutte effective pour transformer les conditions dans lesquelles ils se trouvent vraiment ». La vie d’une théorie est matérielle, elle doit être appliquée à une lutte pour produire des effets au sein de cette lutte.
Rendre accessible une pensée pour essayer de l’appliquer à une conjoncture donnée est donc le seul moyen de vérifier sa pertinence. C’est l’objectif que j’ai poursuivi. Il me semble que la notion de spectacle, pourvu qu’on la comprenne dans sa profondeur et ses évolutions, « fonctionne » bien pour comprendre les temps présents. Mais, bien entendu, cette « application » de la théorie à la conjoncture poursuit des buts politiques. Au moment où le capitalisme spectaculaire produit désormais au grand jour sur la société, la nature, le vivant, ses effets de décomposition, de régression anthropologique et son projet de « survie augmentée »5, tout cela avec le confusionnisme intellectuel et politique qui l’accompagne et le renforce, l’œuvre de Debord est d’une grande utilité pour saisir au mieux la nature de la société postmoderne et tenter de lui faire prendre une autre direction. En lisant Debord, je pense à ce qu’Orwell nommait la « visée politique » de l’écriture : « le désir de faire avancer le monde dans une certaine direction, de modifier les idées que se font les autres du type de société pour lequel il vaut la peine de se battre » (Pourquoi j’écris, 1946). Au stade atteint par le spectacle, l’urgence est sans doute de refonder une contestation civique unifiée pour, sinon renverser le spectacle, au moins remettre le monde à l’endroit partout où il est possible de le faire, le but étant de pouvoir enfin « se livrer joyeusement aux véritables divisions et aux affrontements sans fin de la vie historique6 ».
Bibliographie indicative
- Roux, Emmanuel, Guy Debord. Abolir le spectacle, éd. Michalon, coll. « Le bien commun », 2022, 128 p., 12 €.
Pour aller plus loin :
- Collectif, Internationale situationniste, éd. Fayard, coll. « Sciences humaines », 1997, 708 p., 30 €
- Collectif, Potlatch (1954-1957), éd. Gallimard, coll. « Folio », 1996, 304 p., 9,20 €
- Debord, Guy, Rapport sur la construction des situations[1957], éd. Fayard, coll. « Mille et une nuits », 2000, 64 p., 3 €
- Debord, Guy, La Société du spectacle[1967], éd. Gallimard, coll. « Folio essais », 2018, 224 p., 7,50 €
- Debord, Guy, Commentaires sur la société du spectacle[1988], éd. Gallimard, coll. « Folio essais », 2018, 160 p., 5,50 €
- Debord, Guy, In girum imus nocte et consumimur igni[1990], éd. Gallimard, coll. « Blanche », 1999, 160 p., 16 €
- Debord, Guy, Œuvres, éd. Gallimard, coll. « Quarto », 2006, 1920 p., 33 €
- Jappe, Anselm, Guy Debord[1995], éd. La Découverte, 2020, 234 p., 12 €
- Marcolini, Patrick, Le Mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle, éd. L’Échappée, 2013, 344 p., 22 €
1« L’ambitieux ridicule [Regis Debray] a couru vers tout, s’est jeté sur tout, a tout manqué. Castro, Guevara, Allende, le règne de Mitterrand première variante. Maintenant, il voudrait créer une sorte de science de la médiatisation, il n’en est naturellement pas capable. Le pauvre se désole de n’avoir pas de chaire, de revue, de place dans l’institution académique. »
2 « La scission généralisée du spectacle est inséparable de l’État moderne, c’est-à-dire la forme générale de la scission dans la société, produit de la division du travail social et organe de la domination de classe. » (§24 de La société du spectacle).
3 « Il faut conclure qu’une relève est imminente et inéluctable dans la caste cooptée qui gère la domination, et notamment dirige la protection de cette domination. En une telle manière, la nouveauté, bien sûr, ne sera jamais exposée sur la scène du spectacle. Elle apparaît seulement comme la foudre, qu’on ne reconnaît qu’à ses coups. » (Commentaires sur La Société du spectacle).
4 Il « n’est pas douteux, pour qui examine froidement la question, que ceux qui veulent ébranler réellement une société établie doivent formuler réellement une théorie qui explique fondamentalement cette société ; ou du moins qui ait l’air d’en donner une explication satisfaisante. Dès que cette théorie est un peu divulguée, à condition qu’elle le soit dans des conditions qui perturbent le repos public, et avant même qu’elle en vienne à être exactement comprise, le mécontentement partout en suspens sera aggravé, et aigri par la seule connaissance vague de l’existence d’une condamnation théorique de l’ordre des choses. Et après, c’est en commençant à mener avec colère la guerre de la liberté, que tous les prolétaires peuvent devenir stratèges » (Préface à la quatrième édition italienne de La Société du spectacle).
5« L’abondance des marchandises c’est-à-dire du rapport marchand, ne peut plus être que la survie augmentée » (La Société du spectacle, § 40, souligné par Debord).
6 « Préface à la quatrième édition italienne de la Société du spectacle ».