
Romancier et essayiste, Jean-Michel Delacomptée a travaillé de nombreuses années dans le secteur de la diplomatie culturelle avant d’enseigner la littérature française à l’université Bordeaux-Montaigne à Bordeaux, puis, de 2001 à 2012, à l’université Paris-VIII. Directeur de la collection « Nos Vies » chez Gallimard, il a consacré de nombreux ouvrages à des personnalités historiques ou du monde littéraire, de la Renaissance au Grand Siècle.
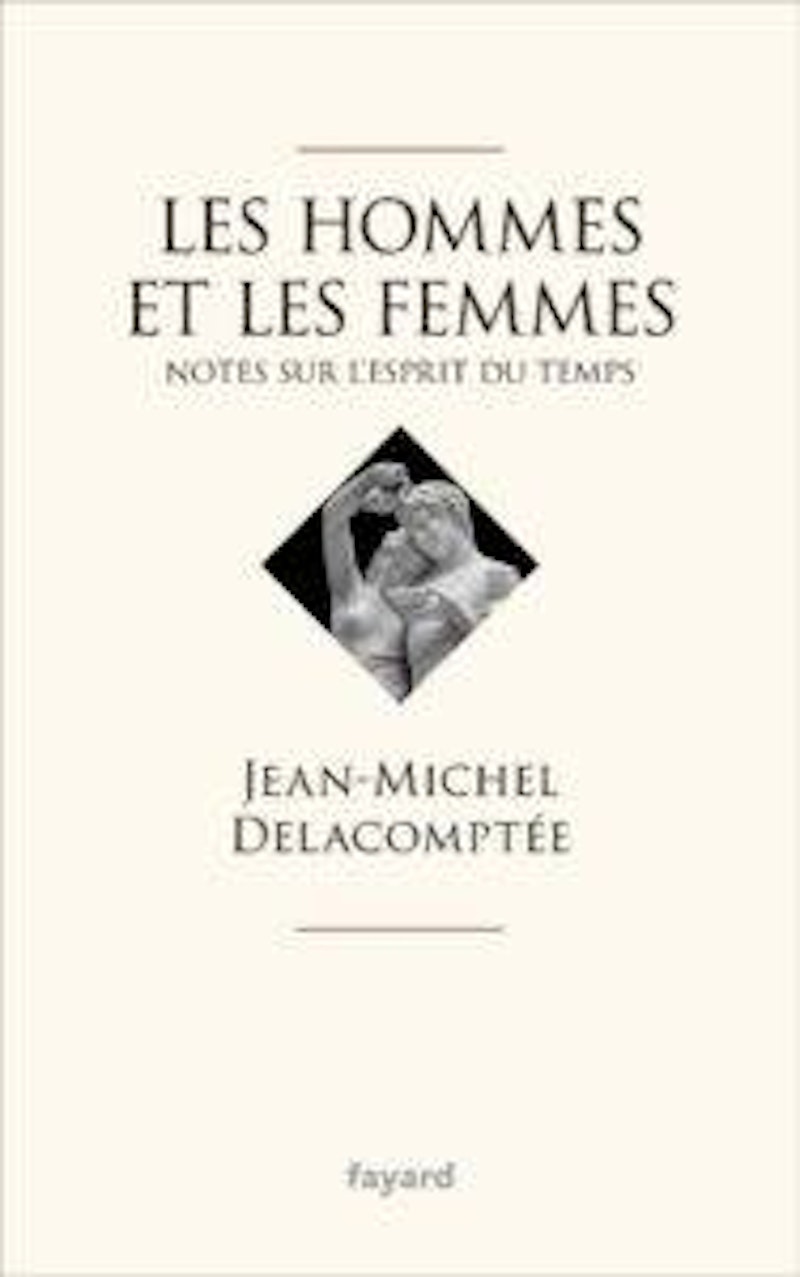
Fervent amoureux de la langue française, qu’il a défendue dans l’un de ses derniers essais, Notre Langue française, Fayard, 2018, Jean-Michel Delacomptée a été conduit, à partir de cette réflexion, à considérer les rapports entre les hommes et les femmes à l’aune du combat néo-féministe militant et de la nouvelle conception des relations entre les sexes que les activistes défendent. Dans son dernier essai, les Hommes et les Femmes (Fayard, 2021), il s’attarde notamment, et en profondeur, sur les concepts de néo-féminisme et d’hyperhumanisme qui visent à repenser les bases morales de la civilisation occidentale et met en garde contre les conséquences délétères qu’ils portent en eux et qu’ils pourraient infuser (irrémédiablement ?) dans notre société qui tendrait à oublier les fondements de sa culture.
Le sous-titre de votre ouvrage est : « Notes sur l’esprit du temps ». Plus qu’un essai, peut-on dire qu’il s’agit d’une œuvre de moraliste ?
J’ai conçu en effet cet ouvrage dans l’esprit des moralistes du XVIIème siècle en mettant en avant une prise de position personnelle et une volonté, certes illusoire, de peser sur le cours des choses. J’y évoque une représentation du monde qui obéit à certains principes considérés comme essentiels, m’inscrivant, idéalement, dans la lignée de Plutarque.
J’ai conçu en effet cet ouvrage dans l’esprit des moralistes du XVIIème siècle en mettant en avant une prise de position personnelle et une volonté, certes illusoire, de peser sur le cours des choses. J’y évoque une représentation du monde qui obéit à certains principes considérés comme essentiels, m’inscrivant, idéalement, dans la lignée de Plutarque que j’invoque dès le premier chapitre. Les moralistes du Grand Siècle me sont chers. Ainsi ai-je notamment consacré un livre à La Bruyère(1). En ce temps-là, les écrivains, étant privés de rôle politique, ont pu s’exercer à penser le monde d’une manière relativement libre, tout en prenant toutes les précautions avec le pouvoir. Ils adoptaient une certaine conception du temps à partir d’une vision très large des choses. L’actualité en tant que telle ne les intéressait qu’au regard d’une universalité et d’une intemporalité qui conféraient à leurs propos une valeur située au-delà du hic et nunc, « ici et maintenant ». Cela leur permettait de considérer plus aisément le présent auquel ils se confrontaient, qualité aujourd’hui en voie de disparition compte tenu des flux d’informations incessants.
Vous écrivez en préambule : « L’égalité encore imparfaite entre les hommes et les femmes ne sera réalisée que par l’accomplissement d’une rupture totale dans la marche du monde, par la création d’une société entièrement nouvelle. Et l’égalité hommes-femmes sert de matrice à cette révolution dont l’accomplissement nécessite d’abord la destruction du patriarcat ». Si la société change indiscutablement, la révolution sera-t-elle avant tout sexuelle ?
Cette phrase n’est évidemment pas le vœu que je formule, je me mets à la place de ceux qui prônent cette révolution, dont je conteste la pertinence. C’est une révolution des mœurs dont on ne pèse pas suffisamment l’ampleur et la gravité. Elle commence par la question sexuelle et s’étend à celle du genre et du mode de vie. Il n’est pas très étonnant que la révolution sexuelle soit au cœur de ce mouvement ; le XXe siècle se caractérise en effet par la révolution opérée dans ce domaine. La psychanalyse, qui constitue un des courants de pensée majeurs de ce siècle, a mis en évidence, par Freud et surtout Wilhelm Reich, le lien entre révolution et sexe.
La seconde étape de ce mouvement porte sur l’égalité entre les hommes et les femmes, qui se trouve au cœur des préoccupations de chacun, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, des ravages du nazisme et du déclin de la religion chrétienne. On assiste actuellement, dans ce prolongement, à l’émergence d’une volonté de changer l’Homme. C’est l’aspect le plus monstrueux de cette révolution morale sur laquelle je m’interroge, au regard d’une certaine conception de l’Homme dont les moralistes ont contribué à construire l’image et l’idée. C’est-à-dire que nous sommes en train de sortir de cinq à six siècles de considération de l’être humain pour en remodeler une nouvelle vision, dans la suite de ce qu’ont tenté de mettre en œuvre le bolchevisme, le fascisme et le nazisme. Je ne dis pas que la révolution morale en cours est bolchevique, nazie ou fasciste, mais qu’elle participe de la même volonté de transformer radicalement l’Homme pour créer un type nouveau.
Une des thèses principales de votre ouvrage est la transformation récente de la lutte pour l’égalité en une course à l’égalitarisme et à l’indifférenciation. Il s’agit donc selon vous d’une évolution qui remonte au XXe siècle. Dans les Démons du Bien(2), l’essayiste Alain de Benoist pense au contraire que cela est le résultat d’une très lente macération depuis deux millénaires, à partir du monothéisme qui affirme l’existence d’un Dieu unique et implique l’unité de la famille humaine, à la réduction de l’égalité à la Mêmeté, à l’égalisation des conditions sous l’injonction de l’échange marchand, jusqu’au sans-frontiérisme et au libre échangisme, pour terminer par l’ultime déconstruction qui est celle du sexe par l’idéologie du genre. Ces deux visions sont-elles absolument contradictoires ?
La question de l’égalité entre l’homme et la femme remonte très loin, aux Grecs eux-mêmes. On le voit dans le théâtre d’Aristophane par exemple. Cependant, la question semblait relativement tranchée jusqu’à très récemment : l’homme était l’homme et la femme était la femme, ce qui est un truisme. En profondeur, je ne crois pas que cette distinction des deux sexes ait été remise en cause selon une temporalité aussi lointaine. Et si elle devait remonter aussi loin, elle n’aurait pu être que marginale (avant le XXème siècle, seuls les libertins, de facto hostiles au discours chrétien, auraient pu remettre en question cette distinction) et limitée à l’Occident. Le mythe d’Adam et Eve a été prédominant dans les civilisations monothéistes. Adam et Eve sont les socles d’une civilisation à laquelle nous appartenons toujours, même si elle est de plus en plus écornée par cette révolution morale ; tant que ces deux piliers fondamentaux résistent, la distinction reste clairement affirmée. Cette dernière obéit aussi aux contraintes du réel : même si cela est bien sûr à nuancer, l’homme a toujours occupé la fonction de père de famille chargé de satisfaire les besoins économiques de la cellule familiale, tandis que la femme, gardienne du foyer, en assurait la reproduction par l’engendrement des héritiers. Le partage des rôles a profondément changé. Mais pour remettre en cause la distinction naturelle entre les sexes, il faut remettre en cause le réel lui-même. L’idéologie seule ne suffit pas. Elle s’est appuyée sur les progrès scientifiques, où la femme a globalement acquis le contrôle de la reproduction, de son corps, de ses désirs, progrès médical constitutif des éléments moteurs de cette révolution sexuelle. Pensons par exemple à la gestation pour autrui. Mais ce ne sont pas tant les progrès scientifiques qui sont inquiétants, que l’absence de réflexion autour des conséquences des divers aspects de ladite révolution. La modernité en la matière représente un facteur maximal de craintes et de risques.
Selon vous, l’homme est en trop pour les néo-féministes militantes, il est surnuméraire pour reprendre le titre du livre de Patrice Jean, voire contingent. La tendance actuelle semble être de vouloir l’effacer (cf. la suppression de l’expression « en bon père de famille » dans la loi). Après la lutte des classes et la guerre des races, pensez-vous que nous sommes dorénavant dans une guerre des sexes, voire des genres ?
Oui, et cette guerre des sexes ou des genres n’est pas marginale mais au contraire très évidente. Elle est en quelque sorte validée par les lois sociétales. Ainsi, depuis peu, nous pouvons choisir d’inscrire le « genre neutre ou X » sur les passeports américains(3). Nous nous situons dorénavant dans un nouveau monde. La révolution des genres est remarquable dans le sens où un petit noyau de déconstructeurs, d’activistes et de théoriciens a pu irradier, en Occident du moins, à peu près toutes les sphères de la société et ce, sans que les populations en aient clairement conscience. Il faut dire que l’Occident libéral ne prend pas suffisamment au sérieux le péril introduit par ces lois sociétales, à l’inverse de sociétés autoritaires comme la Russie et la Chine, dont je ne valorise nullement le régime politique, mais dont je note simplement l’importance lucide qu’elles attachent à ces questions. Lors de la campagne présidentielle où nous sommes, quel candidat aborde ces questions ? Ces changements relatifs aux relations entre les genres et à la remise en cause de l’idée traditionnelle de l’individu pénètrent peu à peu les mœurs sans opposition réfléchie, construite, sérieuse.
Cet activisme militant dévoie-t-il le combat féministe originel et légitime visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes ? Certaines féministes se désolidarisent voire s’insurgent contre ces nouveaux discours, que l’on pense à Élisabeth Badinter ou Danièle Manesse, professeur de sciences du langage, qui a récemment dit qu’il fallait bien différencier grammaire et genre sexué(4). N’est-ce pas accorder trop d’importance aux néo-féministes ?

La théorie du genre et le féminisme ont aussi pour ambition de remodeler la langue. Vous avez écrit Notre Langue française(5), essai dans lequel vous déplorez entre autres que la langue soit dénaturée par le langage inclusif. Votre ouvrage, Les Hommes et les Femmes, se place-t-il dans sa continuité ?
Oui, c’est une suite logique car c’est un combat contre l’affadissement et la déculturation de la langue, laquelle doit être le lot commun, en premier lieu pour les écrivains. Je suis frappé par le fait que la question du style en littérature n’a plus d’importance. On note ainsi un incroyable effacement de la poésie dans l’espace public, caractéristique d’une langue dont on ne se soucie plus.
Vous abordez cette dépoétisation de la littérature en critiquant, de manière assez virulente, Annie Ernaux qui ferait de la littérature de centre commercial et qui voit de la laideur dans chaque chose, en dépeignant un monde gris de ressentiment et de colère. Quel est justement votre point de vue de romancier sur cette dépoétisation ?
C’est un exemple d’autant plus marquant qu’elle revendique cette laideur. Refusant l’esthétique en matière littéraire, elle fait délibérément « de la sous-littérature », je la cite, pour être plus proche du peuple, alors justement que son premier ouvrage, Les Armoires vides, manifestait le goût d’une écriture consistante. Le résultat me paraît non seulement contestable, mais condamnable. On ne gagne rien à dessécher, à enlaidir, et je ne pense pas que la sous-littérature soit de la littérature. C’est autre chose, de la sociologie militante, de l’activisme féministe, du populisme complaisant. Mais ce n’est pas tant Annie Ernaux qui me gêne que le succès de cette littérature volontairement pauvre, fade, ras du sol. Appauvrir la langue ne sera jamais un progrès. Quant à dire que notre société est dépoétisée dans le cadre d’un effondrement de tout ce qui relève du spirituel, c’est une évidence.
Vous évoquez l’hyperhumanisme. Il s’agit d’un concept issu d’une bonne intention (l’humanisme en réaction aux horreurs nazies) mais qui a dérivé. En quoi cela consiste-t-il exactement et à partir de quand vouloir faire le bien devient une dérive ?
Il n’y a plus de bases extrinsèques à l’humanité, qu’il s’agisse de religion ou de considérations morales. Cette abolition des limites, si elle a la capacité de satisfaire les désirs les plus étrangers à la nature humaine, ne pose pas la question des conséquences.
J’ai été frappé de voir que ce terme, employé par Jean-Louis Touraine, rapporteur de la loi bioéthique en 2019 lors du débat sur la PMA pour toutes(6), servait à justifier le vote par l’Assemblée nationale de cette loi d’égalité qui, en réalité, outrepasse ce qui relève des possibilités thérapeutiques au profit d’une médecine de confort. L’argument mis en avant consistait à « agir par hyperhumanisme ». Personne n’a relevé le terme, ce qui me surprend. J’en étais resté au concept d’humanisme défini par la Déclaration des Droits de l’Homme, qui a une longue histoire depuis les Lumières, et même depuis la Renaissance. L’hyperhumanisme est un concept différent : il s’agit d’assurer par tous les moyens, y compris par la transgression de la nature physiologique et de la morale commune, le bien de l’Autre, qui est supérieur à toute espèce de considération, le bien de l’Autre étant la recherche incessante de la satisfaction de ses désirs. Avec l’hyperhumanisme, nous assistons à une déification du désir individuel auquel on ne peut légalement et théoriquement rien opposer. Cela permet donc toutes les transformations de l’individu, y compris physiologiques, sans limites, jusqu’au triomphe de toutes les prothèses pensables. Il n’y a plus de bases extrinsèques à l’humanité, qu’il s’agisse de religion ou de considérations morales. Cette abolition des limites, si elle a la capacité de satisfaire les désirs les plus étrangers à la nature humaine, ne pose pas la question des conséquences. Si le rapport parlementaire fait bien référence à une limite qui serait la dignité de l’Homme, on se demande où celle-ci peut s’arrêter puisque tous les moyens sont recevables dès lors qu’ils sont conformes à la réalisation immédiate du Désir (je veux dire : du désir en soi, comme principe et moteur). Il y a là une abdication de la dimension temporelle, de l’avenir, de l’attente, de la patience, de l’examen. L’hyperhumanisme est le présentisme incarné, l’irruption de l’immédiat.
C’est ce que décrivait déjà Christopher Lasch, dans La Culture du narcissisme, lorsqu’il écrivait que « Vivre dans l’instant est la passion dominante » et que dans cette culture du présent, sans passé ni avenir, la satisfaction des besoins immédiats matériels ou affectifs, la recherche d’un bien-être ou d’une impression de bien-être sont la priorité.
Tout à fait, et il est aisé de trouver une preuve de cela aujourd’hui. Regardons par exemple l’endettement vertigineux de la France qui ne cesse de croître pour satisfaire des besoins ponctuels : cette dette abolit le temps à venir en tant que ce temps est d’ores et déjà dévoré par la dette. Il faut immédiatement satisfaire les demandes au prix d’une future et drastique réduction des dépenses, donc des marges de liberté. Le « quoi qu’il en coûte » est emblématique de l’hyperhumanisme : il ne faut souffrir de rien, d’aucun manque, quitte à sacrifier les facultés d’investissement futur. Mais vivre pour jouir de l’instant, ce n’est pas vivre, c’est consommer du temps.
Vous indiquez que nous évoluons dans une société bercée par des valeurs maternelles, d’où l’obsession de l’altruisme, du « care », de la bonté et la sollicitude maternelle, d’une régression vers le langage infantile (papa, maman…). La société patriarcale fait-elle place à une société matriarcale ?
On se dirigeait vers cela jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine qui a remis certaines choses à leur place : on s’est de nouveau rendu compte que les hommes conduisaient les chars et que les femmes empruntaient avec leurs enfants les couloirs humanitaires. La distinction entre les sexes a eu de nouveau cours. Mais ce n’est certainement qu’une pause dans la course au matriarcat, qui n’est pas bouleversée dans ses fondements.
La confrontation entre société patriarcale et société matriarcale pose la question de la violence et de l’identité de chacun au sein du corps social. Il devient difficile pour chacun de fixer son identité, et s’il est évident que la violence infligée aux femmes est une abjection qu’il est nécessaire de combattre, il faut pouvoir analyser plus profondément la violence qu’exercent les hommes mais aussi dont ils souffrent, et plus spécialement les jeunes hommes : la désindustrialisation, la société de services, l’addiction aux drogues ou aux jeux, les fonctions traditionnelles masculines qui ont subi des ruptures avec la condamnation de l’autorité paternelle, l’exode rural, la fin du service militaire, etc. Toutes ces raisons font qu’il y a une difficulté à se repérer dans un monde aux frontières devenues floues, fluides, spongieuses. L’historien Pierre Vermeren a consacré un article il y a quelques mois à ce sujet dans Le Figaro, intitulé : « Les jeunes hommes sont-ils en trop dans la société française (7) ? ». Les femmes sont meilleures à l’école et parfaitement adaptées à la société de services ; le goût exubérant du risque et de la transgression ne leur est pas consubstantiel, en ce qu’elles enfantent et, spontanément, viscéralement, protègent le fruit de leurs entrailles. On m’accusera sans doute de machisme mais c’est la normalité qui leur est nécessaire. Elles ont moins le goût de la violence, qui est l’apanage des hommes, ce qui n’est d’ailleurs pas à leur honneur. Les valeurs maternelles et féminines prennent le pas sur les valeurs masculines, et l’hyperhumanisme traduit ce mouvement.
D’aucuns pourraient vous accuser de masculinisme, comme cela a été le cas par exemple avec Eric Zemmour quand il a publié Le Premier Sexe. Vous semblez être plutôt en accord avec ses conclusions.

Le livre de Zemmour a le mérite de relayer un cri d’alarme mais il a attiré sur lui toutes les critiques, même les plus injustes, alors qu’un Michel Schneider, auteur de Big Mother, qui développe sensiblement les mêmes thèses, n’a jamais été qualifié de misogyne : on dira simplement de sa thèse qu’elle décrit la maternisation de la société avec une grande pertinence. Cette maternisation trouve justement sa traduction conceptuelle dans l’hyperhumanisme : il faut prendre un soin absolu de tout le monde, comme une mère de famille le fait vis-à-vis de ses enfants.
La lutte pour l’égalité s’accompagne d’une course, que vous qualifiez d’interminable, à la victimisation. Philippe Muray parlait de « cage aux phobes ». Depuis, de nouvelles phobies ont fait leur apparition : transphobie, grossophobie… Que dit cette « reductio ad timorem » de notre société ?
Cela traduit une excroissance du narcissisme et un affaiblissement de la responsabilité personnelle. On ne se sent pas capable de « résister à ». Je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut procéder à un réarmement moral. Je me veux disciple de Montaigne : il faut être capable, dans toute la mesure du possible, de résister par ses propres défenses et sa propre volonté aux aléas négatifs, aux risques de mort et à la mort elle-même. On a bien vu comment les gens se retrouvaient désarmés face à la crise du Covid. Cette société est habitée, traversée, submergée par la phobie. Ce terme a pris une nouvelle signification : ce n’est plus « avoir peur de » mais « être hostile à ». Or la phobie est et reste la peur, c’est le sentiment d’une faiblesse interne qui empêche d’affronter seul un danger. Cette nouvelle acceptation du terme mène à l’indifférenciation, à la perte d’altérité, comme si l’altérité était en soi un danger : tout le monde se doit de respecter et de ne pas « stigmatiser » (autre terme à la mode) la personne qui aura choisi de changer de sexe ou d’assumer ses rondeurs sous peine d’être accusé de transphobie et de grossophobie et, par conséquent, d’être exclu de la communauté des gens bienveillants, solidaires, pour être relégué dans celle des « fachos ». L’amour de l’Autre, ici dénaturé et hypertrophié, vise à effacer la différence entre l’Autre et soi. La phobie de l’Autre se transforme en hyperamour et l’Autre cesse d’être un autre.
Vous montrez justement dans votre ouvrage que l’amour, auquel vous consacrez de nombreuses pages, n’est pas épargné par le désir de gémellité ; on peut penser ainsi aux applications de rencontre où il s’agit de rechercher son alter ego (les critères de recherche paramétrés étant fondés sur les points ou centres d’intérêt communs entre deux personnes). On part davantage à la découverte de soi ou d’un autre soi-même que de l’Autre, comme vous venez de l’affirmer.
Cela va en effet dans le sens de ce qu’on vient de dire. On va vers l’Autre et on est heureux de s’apercevoir qu’il est finalement comme soi. Il est à noter qu’il s’agit d’une réaction profondément infantile : les enfants sont dans le fusionnel et dans le mimétisme. On assiste donc à une régression marquante dans le domaine amoureux.
Selon vous, l’amour a dorénavant force de loi et c’est en son nom qu’on vote des lois (la loi sur le mariage homosexuel, sur la PMA etc.). Pensez-vous qu’invoquer l’amour dans ce cas présent est une ingérence du public dans la sphère privée ?
Tout à fait. Quand je parle d’hyperhumanisme, c’est l’Amour, le Bien. Évidemment, la réalité sociale n’est pas celle-là. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et plus elle est violente, plus on se réfère à une aspiration à l’amour, à une société d’amour. Je m’insurge contre cette sur-présence, qui est une dépravation de l’amour du prochain. On a désincarné l’Amour pour n’en garder que la surface. La PMA pour toutes est en cela significative : on s’est référé à l’amour pour voter cette loi. Or, la caractéristique de l’amour est de ne pas avoir de loi. L’amour sert ici de socle à la loi, situation paradoxale en ce que rien n’est plus variable et fragile que l’amour. On en fait très naïvement un principe de base.
Sandrine Rousseau a récemment fait polémique en proclamant que le privé est politique ; elle faisait référence à la nécessité de réguler les tâches ménagères de manière strictement paritaire. D’aucuns pourraient penser qu’il s’agit d’une définition stricte du totalitarisme. Se dirige-t-on, à votre avis, vers ce genre de société ?
On a évoqué les premières révolutions bolchevique, nazie et fasciste qui voulaient changer l’Homme. Nous sommes maintenant à la révolution écolo-féministe qui veut aussi le changer. Il y a un côté effectivement totalitaire qui consiste à vouloir se régler sur le mode de vie des femmes, pour autant qu’on puisse le généraliser et le définir. Le fait de dire que l’intime est politique, qu’il n’y a plus de distance entre le privé et le public, est porteur de ravages inévitables.
Vous évoquez différentes conceptions de l’amour, de Destutt de Tracy, pour qui il s’agissait du « résultat du besoin de reproduction joint à celui de la sympathie » à Stendhal qui voit l’amour comme une cristallisation, une maladie en tant que pur produit de l’imagination. On pourrait ajouter une troisième citation, celle d’Abel Bonnard qui écrit, dans Supplément à De l’amour de Stendhal : « L’amour est la plus belle occasion que nous ayons de dépenser notre âme en oubliant notre moi. En même temps qu’il nous délivre de notre égoïsme, il nous enivre de notre puissance. » L’Autre est donc toujours nécessaire à la réalisation de l’amour et du bonheur. Est-ce la différence fondamentale avec l’amour moderne qui se définit par son individualisme et sa recherche de la satisfaction immédiate d’un désir égoïste ?
De fait, l’égalité fortifie la famille et constitue un acte républicain. Elle est en cela une entité dynamique au nom de la recherche du bonheur, idéal extrêmement positif, contrairement à la vision négative de Sandrine Rousseau ou à celle de la journaliste Mona Chollet, dans son ouvrage Réinventer l’amour (titre présomptueux) pour qui le centre de ses préoccupations est le couple et non la famille.
On s’enferme en effet dans l’égoïsme. Au passage, Tracy, injustement oublié de nos jours, est un exemple intéressant : c’était un républicain en avance sur son temps qui a consacré un livre à l’amour, dont s’est inspiré Stendhal, qui l’admirait. Tracy considérait que la cellule de base de la société étant la famille il faut assurer l’égalité entre l’homme et la femme pour atteindre une bienheureuse pérennité du couple et, avec le couple, de la cellule familiale. Il prônait la possibilité pour la femme d’avoir des expériences sexuelles avant le mariage, il se prononçait contre la répudiation, et pour lui, le couple réussi résulte d’une bonne combinaison entre sexualité et amitié. De fait, l’égalité fortifie la famille et constitue un acte républicain. Elle est en cela une entité dynamique au nom de la recherche du bonheur, idéal extrêmement positif, contrairement à la vision négative de Sandrine Rousseau ou à celle de la journaliste Mona Chollet, dans son ouvrage Réinventer l’amour (titre présomptueux) pour qui le centre de ses préoccupations est le couple et non la famille. Il y a chez cette dernière une contradiction insurmontable : elle met en avant son non-désir d’enfants, ce qui est son droit, mais elle ambitionne de parler au nom de toutes les femmes, prétention dès lors impossible.
La citation de Bonnard est tout à fait juste, et nous nous construisons dorénavant contre cette conception de l’amour. Nous l’avons mentionné plus haut : nous recherchons désormais le Moi en l’Autre, dans une sorte de fusion narcissique.
Vous émettez l’hypothèse que ces théories se trouvent favorisées par le nouveau modèle de société proposé ou imposé par les Gafam(8), qui démultiplient l’audience des progressistes militants, inversement proportionnelle à leur réalité numérique. Les néo-féministes sont-elles les idiotes utiles des Gafam ?
En effet, et Sabine Prokhoris, dans son ouvrage Le Mirage #MeToo(9) dont je ne saurais trop recommander la lecture, montre bien que les réseaux sociaux, qui dépendent des Gafam, alimentent le mouvement Me Too. Les Gafam sont des vecteurs d’idéologie monopolistique dans les domaines financiers et culturels, et des entreprises de démolition de notre civilisation dont on ne peut que s’effarer.
Un moine représenté sur la basilique de Vézelay montrant sa poitrine a permis à France Culture de conclure que la transidentité n’est pas un phénomène nouveau et qu’elle est sculptée dans la pierre depuis le XIIème(10) siècle. « La transphobie est vieille comme le monde. Pour s’être travestie en homme, la vierge Eugénie subit le martyre en 257 ». Pour vous, les médias sont-ils des vecteurs primordiaux de cette idéologie ?
Entre les médias (radio, presse écrite et télévision) et les réseaux sociaux, il existe une alliance de fait. On peut partager les idées des néo-féministes, mais pourquoi n’y a-t-il aucune réflexion sur ce que cette pensée engendre ? Là encore, l’hyperhumanisme joue un rôle, et son influence est terrible lorsqu’elle est livrée à elle-même.
France Culture aurait pu aussi citer l’abbé de Choisy, qui se travestissait en femme, ce qui ne gênait personne. Dans l’Ancien Régime, il n’y avait pas de transphobie, mais une souplesse, une acceptabilité plus grandes qu’on ne le dit. On peut penser aussi au chevalier d’Eon ou à Philippe d’Orléans, le frère de Louis XIV. Des excentricités étaient alors acceptées, qu’on aurait du mal à imaginer aujourd’hui.
Nous sommes dans une société d’opinions de masse. Pourtant, les opinions contraires (qu’on qualifierait de conservatrices ou réactionnaires) acquièrent elles aussi une puissance de parole et sont très actives. On a même dit que l’élection de Donald Trump s’était faite sur et grâce aux réseaux sociaux. Les deux types de discours peuvent s’équilibrer.
Les réseaux sont ouverts mais c’est une façon de rester entre soi : des petits groupes parlent entre eux, il n’y a pas d’échange à proprement parler. Ce n’est pas un facteur de démocratie car il n’y a pas de communication, les cercles qui coexistent se confrontent, parfois de façon odieuse. C’est un éparpillement qui laisse la porte ouverte à toutes les opinions sans aucune hiérarchie. Quelle va être l’instance de raison ou de vérité ? Celle qui sera unanimement reconnue comme pouvant être régulatrice de l’admissible ? L’Etat n’est même plus dispensateur de vérité, car son autorité est sans cesse remise en cause et il est accusé de complotisme.
Avec ces propos, vous serez automatiquement relégué par certains dans le camp des réactionnaires, du mâle blanc cisgenre qui refuse de voir l’évolution de la société et de vivre avec son temps. Est-ce un travers de notre époque de cataloguer les gens selon leurs opinions sur tel sujet touchant aux questions de féminisme, d’homosexualité, de langage inclusif… ? Pensez-vous qu’il est impossible, à l’heure actuelle, de débattre sereinement de ce genre de questions très clivantes ?

références bibliographiques
Le Roi miniature, Gallimard, 2000
Langue morte, Bossuet, Gallimard, 2009
La Grandeur Saint-Simon, Gallimard, 2011
Adieu Montaigne, Fayard, 2015
notes
(1) Jean-Michel Delacomptée : La Bruyère, portrait de nous-mêmes, Robert Laffont, 2019
(2) Alain de Benoist : Les Démons du Bien, Pierre-Guillaume de Roux, 2013
(3)https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/12/etats-unis-le-genre-neutre-desormais-disponible-sur-les-passeports_6121863_3210.html
(4)https://leregardlibre.com/entretiens/daniele-manesse-linguiste-le-genre-grammatical-ce-nest-pas-le-sexe/
(5)Jean-Michel Delacomptée : Notre Langue française, Fayard, 2018
(6)« La bioéthique se trouve depuis toujours à la confluence des questions humaines et sociétales les plus complexes. L’enjeu est fondamental : il s’agit de choisir la société dans laquelle nous vivrons demain, de dessiner la condition humaine à laquelle nous consentons à nous soumettre et l’humanité que, tout à la fois, nous voulons transformer. À cet égard, le rapporteur est convaincu qu’il ne faut pas céder aux sirènes du transhumanisme mais, au contraire, chercher sans relâche notre ressourcement dans l’hyperhumanisme. »
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B1572.html
(7)https://www.lefigaro.fr/vox/societe/pierre-vermeren-les-jeunes-hommes-sont-ils-en-trop-dans-la-societe-francaise-20210914
(8)Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique.
(9)Sabine Prokhoris : Le Mirage #Me Too, Réflexions à partir du cas français, Cherche Midi, 2021
(10)https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-histoire/avez-vous-vu-le-moine-qui-montre-ses-seins-dans-la-basilique-de-vezelay

















