
Roman de la rentrée littéraire, paru dans la jolie maison Les Avrils, Le Coeur arrière, d’Arnaud Dudek, dresse le portrait du jeune Victor, dans un roman d’initiation délicieux. Pris de passion pour le saut, le jeune homme va alors fait l’épreuve du passage à l’âge adulte – amis, amour, emmerdes – au gré de ses expériences physiques et affectives.
Une fois n’est pas coutume, Arnaud Dudek nous régale de ses textes délicats et profondément réalistes, pleins d’espoir mais d’un espoir qui élude toute forme de pathos. Si Victor vit avec son père, qui l’élève seul, empêtré dans un désœuvrement très contemporain – quoique d’une vision du divertissement toute pascalienne – le jeune homme se prend de passion pour le sport. Si les romans qui font du sport une thématique littéraire, qui explorent cette matérialité même du corps comme expérience de soi – en dehors de la question érotique et sensible – sont d’une rareté confondante, celui d’Arnaud Dudek a en plus l’intelligence de nous faire rire et de peindre un milieu où la possibilité de la chute ne manque pas, ce qui n’est pas rien pour un jeune homme qui désire voler de ses propres ailes au triple saut.
Parce que l’expérience du sport ouvre précisément à cet apprentissage de la vie et des désillusions du jeune Victor. Dudek traduit cette découverte comme une véritable rencontre :
« Petit zapping : rien sur la Une, que dalle sur la Deux, Hercule Poirot sur la Trois. Assis en tailleur face au détective belge, Victor met des miettes de King Choco partout. Après que Poirot a expliqué aux habitants du manoir les tenants et aboutissants d’une affaire particulièrement complexe, avec cousinade et flacons de bromure, Victor change de chaîne.
Tiens, il y a du sport sur la Cinq. »
Tombée en amour, la découverte fascinée par le jeune homme de ce qu’il pourrait soudain lui-même explorer bouscule son rapport à son propre monde, et ses propres projections, l’auteur d’ailleurs s’amuse déjà au glissement vers la métaphore sinon érotique au moins d’une émotion bien singulière et jouissive :
« Il ne voit que cette silhouette rouge sans défaut qui semble aspirée par le ciel, puis se pose aussi délicatement qu’une plume dans le sable du sautoir, sous les yeux et les objectifs de millions d’individus qui n’ont presque jamais quitté la terre. Les mains de Victor se sont posées devant sa bouche. Ses yeux brûlent ; il les fronce comme s’il était placé en pleine lumière, ses grands cils vibrant continuellement. Sur ses rétines est encore imprimé le saut parfait de l’athlète cubain. »
Il s’éprend à n’en plus finir du goût du saut, du plaisir du corps en mouvement, d’un refus de l’inertie de l’enfance aussi, manière de faire le tri, de dépasser les gorges nouées.
S’ouvrent pour le jeune homme de nouvelles perspectives fougueuses, qui l’emportent, une ivresse qui ne le quittera pas, laquelle, comme toute forme d’ivresse, aura ses gueules de bois, qu’on n’évoquera pas ici pour laisser le goût de découvrir cet apprentissage du monde au cœur même du récit. Mais quand « Victor quitte le stade, la nuit tombe déjà. Tout son corps chauffe, tout son corps brûle. Mais il veut aller plus vite que les brûlures. Quand il arrive à la maison, il court, court encore. » Et puis les succès, car il est vite repéré, qu’il s’éprend à n’en plus finir du goût du saut, du plaisir du corps en mouvement, d’un refus de l’inertie de l’enfance aussi, manière de faire le tri, de dépasser les gorges nouées : « Il découvre ces minutes qui se figent ou se répètent tandis que le temps n’est plus, capturé par les envoûtements d’un effort douloureux qui ressemble à une extase. C’est merveilleux de courir, c’est merveilleux de sauter parce que c’est impensable. Et il le devine déjà, c’est ça et rien d’autre, ce sera toute sa vie. » Une sacrée histoire d’amour, faite de ses échecs et de ses orgueils, de ses retours de passion et de ses boomerangs. Et les amis, un certain Maël, avec qui Victor noue une relation très fraternelle, et les filles, une en particulier, les lèvres et les nuques, quand le « bonheur ressemble parfois à un frisson que l’on rapporte chez soi en soupirant. »
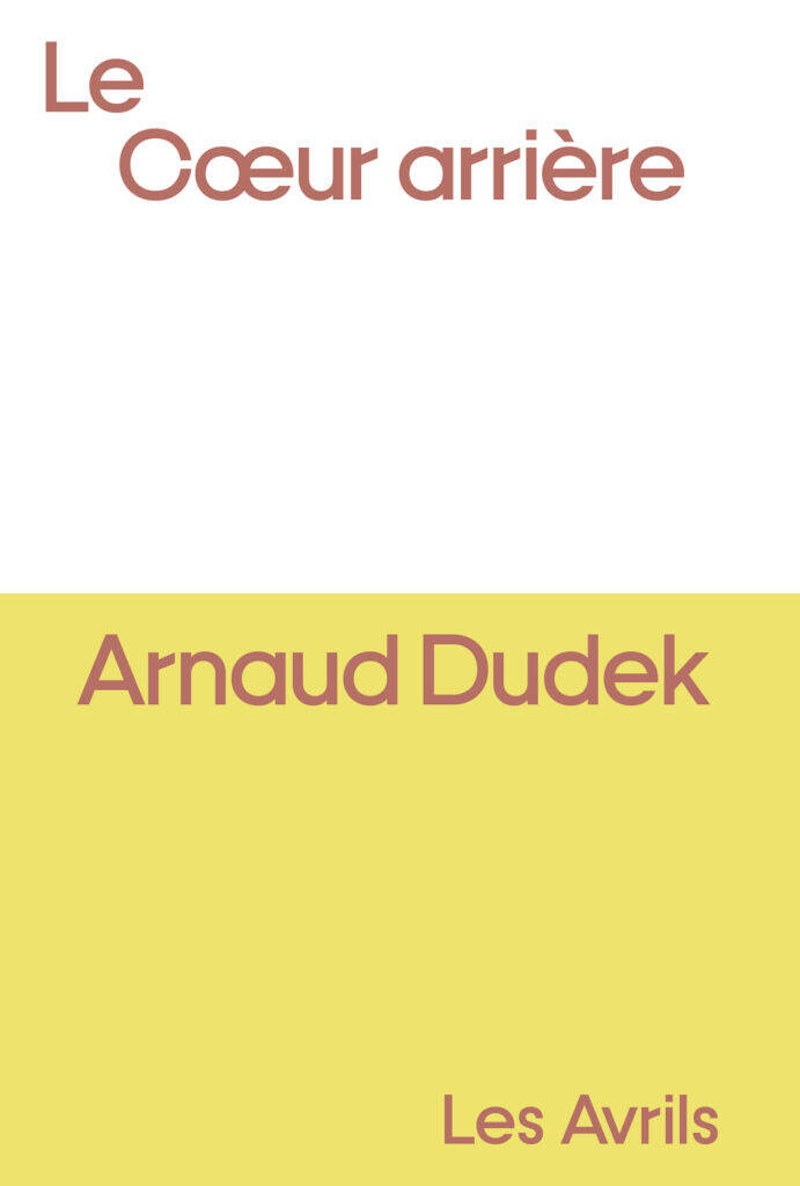
Dire alors combien ce Coeur arrière d’Arnaud Dudek ravi, pour ses portraits, pour l’humour si habituel dans la tendresse de l’auteur à l’égard de ses personnages ; un roman qui ravit aussi parce qu’il n’ignore rien de la brutalité du monde mais refuse les fatalités, un regard enfin où le père n’est pas toujours défaillant, où la pauvreté n’enferme pas toujours dans la misère, où on peut encore rêver ascenseur sociale, projections, où les fins heureuses n’ont rien d’un cliché de cinéma, si tant est qu’elle soit heureuse car elle ne saurait vraiment l’être, mais ce qu’elle insuffle a le « frisson » du bonheur à portée de vol, roman de la vie vraie, où l’apprentissage n’ignore aucune désillusion, face au rouleau compresseur du réel, mais n’occulte plus le plaisir de se rêver autrement.
Crédit photo : © Chloé Vollmer

















