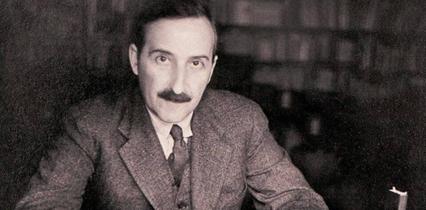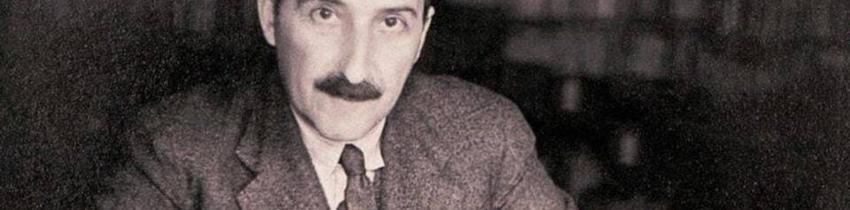Dans Vivre tout bas, Jeanne Benameur compose un roman sur la douleur, celle de l’absence qui se transforme en une lente et patiente reconquête de l’être. Porté par une écriture épurée, l’ouvrage explore le poids des liens invisibles, la puissance des gestes anodins et la capacité de l’écriture à transcender le silence. Ce texte sonde alors la signification de ce que procure le fait d’habiter le monde après la perte.
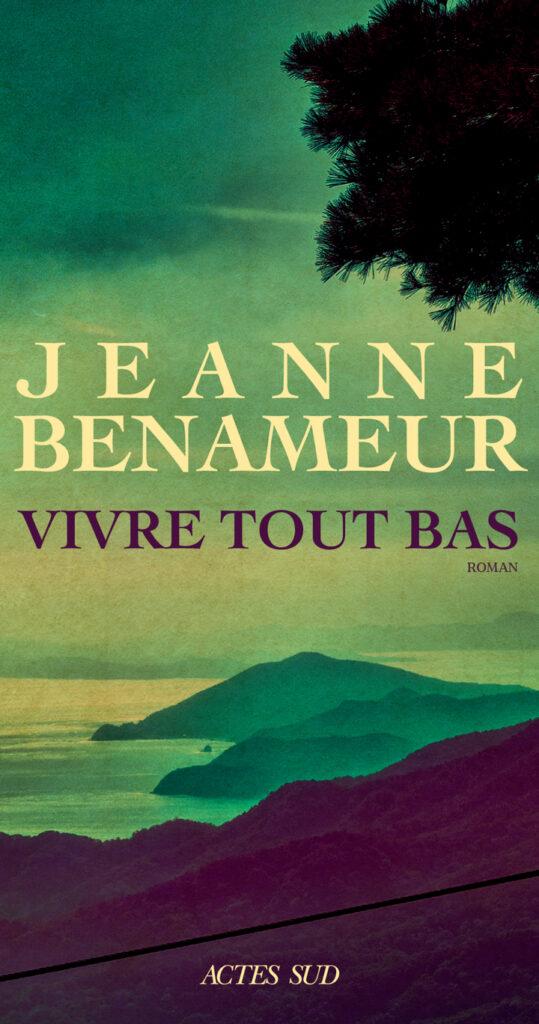
La protagoniste, dont le nom est à peine mentionné, s’isole dans une maison surplombant la mer. Elle y vit une retraite volontaire, dictée autant par la nécessité de se défaire du poids des regards que par un besoin de redéfinir son rapport à la vie. Cette femme, qui porte en elle la perte de son fils, observe chaque jour le paysage avec une attention qui traduit à la fois sa douleur et son émerveillement. Le cadre est donc presque une extension de son intériorité : « Sur terre, on ne peut pas se perdre. On ne fait que des traversées mesurées à l’empan de ses pas ». La marche, la contemplation des pierres, des falaises ou de la mer ne sont pas des distractions, mais des formes de réappropriation de son corps et de son espace mental. La solitude de cette femme n’est ni fuite ni refuge : elle est un état d’être, une manière de creuser, lentement, le silence laissé par la disparition de l’enfant.
Dans ce dialogue entre le corps et le paysage, l’eau joue un rôle central. La mer, vaste et mouvante, devient une métaphore de son désir de se dissoudre tout en continuant à exister. « Entrer dans l’eau. Sentir l’air. Sentir combien il est léger et dense à la fois quand il touche l’eau ». Ce passage traduit la tension entre la pesanteur de la mémoire et l’allègement fugitif du corps flottant.
La mémoire et ses empreintes
Le roman explore avec une subtilité remarquable la manière dont la mémoire façonne l’existence. L’enfant perdu n’est jamais nommé, mais il habite chaque geste, chaque pensée. « Depuis qu’il était sorti de son ventre, il ne la regardait pas comme un enfant regarde sa mère ». Cette relation, marquée par une distance étrange et irréductible, définit à la fois l’intensité de son deuil et la complexité de son attachement.
Le souvenir de l’enfant est ancré dans des objets et des rituels simples, comme lorsqu’elle dessine son visage sur sa tunique : « Dans le creux du tissu, la présence et l’absence dos à dos se confondent ». Ce geste, qui pourrait sembler anodin, est un acte de résistance contre l’effacement. Il montre que la mémoire est une manière de continuer à faire exister les absents.
Cette tension culmine dans une scène d’une intensité bouleversante, où la femme, face à la mort imminente de son fils, tente de lui insuffler la vie : « Elle poussait son souffle hors d’elle pour qu’il aille pénétrer la poitrine de son enfant et lui redonne la vie ». Cette tentative désespérée, qui échoue, symbolise l’impossible deuil d’une mère, son refus instinctif de se résigner à la perte.
La solitude de cette femme n’est ni fuite ni refuge : elle est un état d’être, une manière de creuser, lentement, le silence laissé par la disparition de l’enfant.
L’�écriture comme espace de renaissance
L’écriture, à la fois comme pratique et comme acte existentiel, est cent...