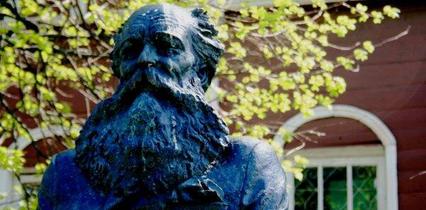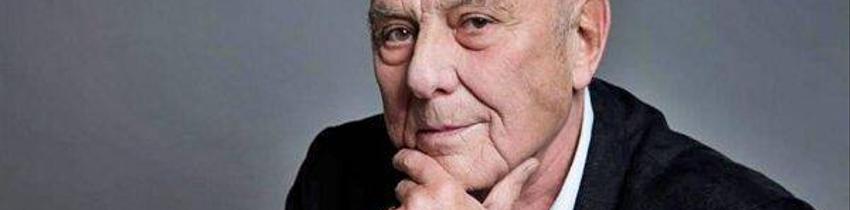Qui ne s’est jamais assis à la terrasse d’un café et, en posant distraitement puis plus attentivement le regard sur les individus qui l’entourent, n’a essayé d’imaginer quelles seraient leur existence, leur profession, leurs amours, leurs souffrances ? Christine Montalbetti se fait maîtresse de cet art dans La Terrasse. Notre narrateur, dont nous ne savons rien si ce n’est qu’il est écrivain, se trouve attablé à la terrasse d’un hôtel portugais pour le petit-déjeuner. Balayant l’espace du regard, il se met à fantasmer, bercé par le principe du flux de conscience, la vie de cette jeune fille assise en face de son professeur, ou encore celle de ce couple marié dont la femme lui apparaît d’une beauté renversante, de ce jeune homme qu’il imagine poète, et de bien d’autres comme autant de personnages de romans qu’il pourrait écrire. Cette terrasse devient comme une interface entre le livre offert au lecteur et l’imaginaire même de l’écrivain.
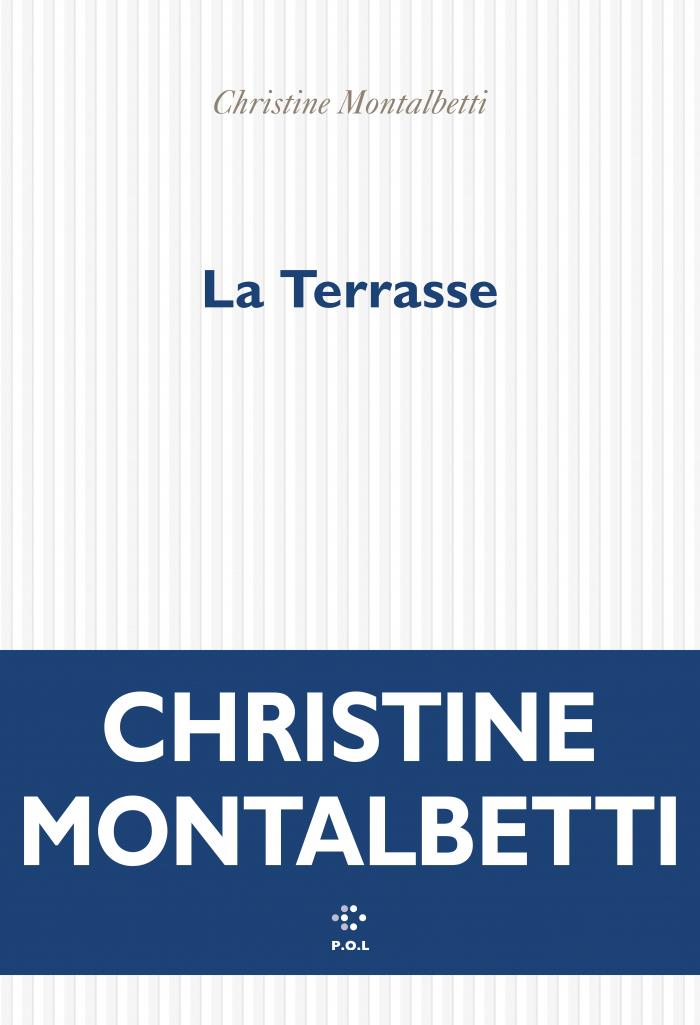
« Ce hors-champ, loin de mon regard, là-bas, chez eux. J’ai pensé au mot intimité. »
En imaginant ce que pourraient être ces inconnus au quotidien, le narrateur pénètre dans une forme d’intimité qui leur est propre, bien que cette dernière ne puisse être que fantasmée puisqu’il ne sait rien d’eux. Chaque personnage se retrouve enfermé dans une sorte de bulle l’isolant des autres, possédant une individualité et des potentialités qui lui sont propres. Alors qu’il extrapole, le narrateur réalise parfois qu’il se trompe et bifurque alors vers une tout autre histoire. C’est aux méninges de l’auteur, aux mécanismes de son imaginaire que donne accès Christine Montalbetti à travers la retranscription de ce processus de création prenant la forme d’un roman. Ces personnages fantasmés, ces êtres de papier que sont devenus ces individus de chair et d’os deviennent plus réels que leurs modèles pour le narrateur ; pourtant, l’écrivain est tenté d’interférer dans cet équilibre ainsi créé en s’éprenant de l’un de ses personnages, la femme mariée, Gloria.
Mais cette femme aux yeux azur n’est qu’un mirage, fruit de l’imagination de son créateur qui ne connaît de son modèle que le regard, le prénom saisi au vol et l’alliance à l’annulaire gauche. Il en est de même pour chacune des créatures romanesques dont l’intimité n’aura jamais aucune incidence sur celle de l’être qui leur a servi de calque. C’est ici un questionnement propre aux écrivains que soulève l’autrice : qu’advient-il de ces êtres créés de toutes pièces lorsque le point final est apposé, lorsque le roman est refermé par le lecteur, ou parfois même lorsqu’on n’écrit pas encore leur histoire ? Cette incursion dans l’imaginaire de l’auteur amène également à redéfinir le pacte de fiction scellé implicitement avec le lecteur au seuil de toute œuvre romanesque.