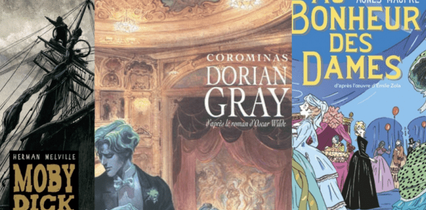Entre novembre 2015 et décembre 2017, l’écrivain Arno Bertina a été invité par l’ONG ASI, à animer à Brazzaville plusieurs ateliers d’écriture pour de jeunes mineures qui se prostituent. Une expérience qu’il restitue dans son dernier livre, L’âge de la première passe, fruit d’un questionnement littéraire sur l’éthique de l’écrivain confronté au réel -auquel il s’expose tout autant qu’il l’expose- dans ses ombres comme dans sa lumière.

L’écriture comme lieu-refuge
L’écriture s’impose d’emblée comme le lieu-refuge, le miroir réparateur de toutes les formes de reconnaissances possibles pour elles comme pour l’auteur. Seuil qui, par le truchement de l’atelier, invite symboliquement à l’accueil de l’autre et à la rencontre, reconstruit l’image de la personne qui écrit, la rétablit comme sujet de sa propre histoire. « C’est quoi, une mineure qui se prostitue ? C’est une personne à qui on n’a pas laissé le temps de se bricoler une vie. » Dans le laboratoire du journal de bord dans lequel Arno Bertina compile précieusement tous les éclats d’expériences vécues, c’est à ce même travail patient de réhabilitation qu’il se livre, à cette même démarche de réparation sensible de dignités bafouées à laquelle le relie l’esprit d’une famille intime d’auteurs -Volodine, Venaille, Malcom Lowry- pour lesquels « le spectacle de la vie humiliée est insupportable, il aura poussé à écrire ».
De la nuit dont ces filles tour à tour émergent ainsi, de chapitre en chapitre, fortes de leurs fragilités, éclatantes de vie et d’intense besoin d’amour, ricochent en boomerang des pans de vie bruts, ce qui transpire des violences que le pays exsude et de la sauvage solitude qui est la leur. Cet enjeu d’un propos qui bat au plus près de la pulsation du réel sous-tend, de fait, l’ensemble de l’œuvre littéraire d’un auteur pour lequel le langage est matériau politique au sens ontologique du terme, fondement poétique de la conscience du sujet et mémoire vive de l’âme collective. « Avec mon livre je ne rends pas justice à ces jeunes femmes, leur quotidien n’en sera pas changé, mais la justesse ce n’est pas rien. Elle creuse en nous une place pour elles, quand les grandes phrases ne font que mettre en scène notre émotion (…) sans créer le moindre espace pour une quelconque altérité. C’est rappeler que si la littérature enquête sur l’humain en même temps qu’elle documente le monde, matrice au cœur de laquelle s’équilibre ce va-et-vient systolique entre le dehors et le dedans , elle est sommée de répondre d’une démarche : « Parce que j’écris des livres, j’ai la chance d’échapper à mon milieu, au paysage natal) et c’est elle encore qui m’aide à répondre aux questions éthiques soulevées par elle (l’écriture). »
Par « souci de justesse », écrire revient donc à forer : sous chaque histoire individuelle déterrer la parole fragile jusqu’à buter contre la source, rappeler aussi, au plus près, au plus juste des faits, dans quel ancrage sociologique et dans quel paysage politique plus large s’origine la parole du sujet quand elle est empêchée, mutilée, dominée. Au foyer des filles vaillantes de l’ASI, il n’y a pas que le corps ou que l’âme de ces filles qui ont été violentées mais ce qui se tisse au cœur de la langue aussi, source d’un désir d’émancipation proche de ce que revendique l’écrivain lui-même pour se soustraire, dans l’écriture, des normes corsetées de la langue, et retrouver la liberté d’une parole authentique : « Ne pourrions-nous pas relever ce défi ensemble, elles et moi ? Ce qui nous sépare (le français me plaçant dans le camp des assassins en quelque sorte) n’est-il pas aussi ce qui nous rapproche un peu, dès lors que j’essaie, en écrivant, d’entendre ma colère, de rejoindre les victimes ?… »
Engagé dans cette quête, l’écrivain rend palpable ce corps-à-corps entre le français et les langues congolaises, tributaires d’imaginaires socio-culturels différents, en opposant à la langue maternelle, physique et charnelle -principalement le lari- cette « survivance folle de l’histoire coloniale » qu’incarne le français, langue de l’autorité « dans laquelle il faut plier, plier sans cesse»
Engagé dans cette quête, l’écrivain rend palpable ce corps-à-corps entre le français et les langues congolaises, tributaires d’imaginaires socio-culturels différents, en opposant à la langue maternelle, physique et charnelle -principalement le lari- cette « survivance folle de l’histoire coloniale » qu’incarne le français, langue de l’autorité « dans laquelle il faut plier, plier sans cesse». Confronté à leur désir de s’émanciper par le lien réparé à la parole et à l’écrit, il touche au vif tout ce qui bloque l’expression d’une véritable écriture de soi, s’attache à décrire la mécanique subtile qui relie le corps à la langue quand celle-ci ne parvient plus à renvoyer à une identité tangible. A savoir, quand le lari est « effacé par le français » qui l’abîme « de l’extérieur ». Quand les corps de ces jeunes filles prostituées, dissociées d’elles-mêmes, zonent en périphérie de la société. Quand l’exclusion sociale mine la possibilité de s’affirmer en tant que sujet. Cette question de la place du sujet établit clairement les bases de la grammaire humaine d’une vision du monde : celle à partir de laquelle Arno Bertina n’évoque avec grâce et pudeur les chaînes du passé douloureux qui les enferme que pour appeler au pouvoir libérateur de la fiction, seul chemin apte à leur ouvrir d’autres possibles.
L’atelier d’écriture implique cependant que se construise auparavant cette chambre à soi qu’est « l’intime ». De la cour du « Foyer des filles vaillantes » aux maraudes, de nuit, dans le grand théâtre d’ombre sordide des yayas de la rue, de la porosité constante entre le récit du vécu des corps et la mise en forme des circuits de la pensée, l’écrivain sonde à vif son lien à l’écriture. Le définissant comme l’éthique viscérale d’un rapport authentique et mobile au monde, où son Je multiplié, diffracté, tâche de faire résonner des points de vue pluriels, mû par le désir profond de « décrire sans cesse des métamorphoses et des personnages qui cherchent à retrouver un rapport mobile à leur propre identité » et de « sortir d’un regard unique » en mettant « ce regard en cris » . Mais en obligeant, aussi, au devoir éthique de l’écoute. L’espace d’écriture se transforme ainsi en vaste champ réflexif d’un dialogue intérieur qui remet en cause et déconstruit les réflexes d’un référentiel ethnocentré pour adhérer à la peau du réel, sensible, mouvante, polymorphe, et complexe : « Alors se taire, et seulement tendre l’oreille au maximum, la « grande oreille » d’Antonin Artaud. Décrire ce qu’on voit en s’absentant autant que faire se peut. »
L’espace d’écriture se transforme ainsi en vaste champ réflexif d’un dialogue intérieur qui remet en cause et déconstruit les réflexes d’un référentiel ethnocentré pour adhérer à la peau du réel, sensible, mouvante, polymorphe, et complexe : « Alors se taire, et seulement tendre l’oreille au maximum, la « grande oreille » d’Antonin Artaud. Décrire ce qu’on voit en s’absentant autant que faire se peut. »
Balayant sans relâche les ombres que lui renvoie la lumière du réel pour tenter d’en refléter toutes les nuances, l’écrivain s’en remet à Faulkner : « écrire, c’est comme craquer une allumette au cœur de la nuit en plein milieu d’un bois. Ce que vous comprenez alors, c’est combien il y a d’obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir. Elle sert seulement à mieux mesurer l’épaisseur de l’ombre. » Mais ce kaléïdoscope poétique strié des sourdes violences du pays s’illumine ici du courage et de la beauté de ces femmes qui révèlent combien « le mystère ça peut être la lumière, « voir des filles, par exemple, se tenir droites alors qu’elles viennent de raconter l’horreur ». De fait, comment habiter le monde et trouver sa place, comment faire langue et faire sens de son histoire, individuelle ou collective ? Plantées comme des phares dans la nuit ces questions obsédantes vrillent le texte. Au cœur de cette rencontre à la fois terriblement pudique et intime, l’écrivain qui cherche à tâtons sa place -ni surplombante, ni en retrait, ni fusionnelle- se contente d’apparaître « dans le champ de la caméra » parce que l’expérience l’inclut, tout en s’appliquant à se taire par souci de faire entendre ce que les filles « ont à dire sans faire écran ».
Mais dans sa « mezzanine » intérieure continue de se jouer une double partition, subtile, dans laquelle alternent les aveux de l’homme et les cogitations de l’écrivain. Autant de séquences syncopées, organiques, entrecoupées de brefs arrêts sur image pour capter l’essence d’un détail surréaliste, d’une anecdote poétique, d’une parole singulière. Dans ce flux brut d’expérience sensible, les images s’enchaînent, sans filtre. A la prostitution des corps « qui rejoue tout le corps social » répond la mise à nu des âmes qui ne triche pas. C’est ainsi qu’on oscille entre des plongées en apnée dans la violence nocturne des rues de Brazzaville lors des maraudes de l’ONG qu’il accompagne, et des embardées réflexives sur les préceptes universalistes d’une pensée occidentale « au hâchoir », qui « voit de l’humain partout, et jamais la culture, l’histoire, la question sociale ». Dans son rapport aux autres, lui, l’étranger, le « mundélé », a tôt fait de poser le diagnostic de ce qui le pousse à se désorienter sans cesse dans « le grand dehors » : « ce qui me sépare d’eux est paradoxalement ce qui tend un pont entre les deux berges. Je désire quitter la rive où j’étouffe ; j’ai besoin d’un autre rapport au monde, au vivant, aux gens qui m’entourent.»
Voyage mental
Un véritable voyage mental met alors en marche l’écrivain qui tire peu à peu le fil de ses propres fantômes, questionné intérieurement dans sa difficulté à créer du lien, dans son désir impérieux d’échapper au « paysage natal » pour « tirer des bords loin de ce qui enferme » et ainsi fabriquer, par le fil de l’écriture, « d’autres liens, plus heureux ». C’est là que s’inscrit profondément sa foi dans la littérature comme aventure radicale de l’altérité. Se cristallise ainsi le noyau de ce qui fonde la valeur littéraire d’une oeuvre à ses yeux : un déplacement de pensée, de vision qui s’attaque aux normes convenues, aux préjugés comme aux certitudes, et que doit guider ce perpétuel « souci de justesse » dans les choix d’écriture et de langue pour mettre en acte ce principe éthique : faire une place à l’autre -marginalisé, opprimé, nié- en ouvrant grand la fenêtre de la littérature. Car « il faut voyager ou écrire, sans doute, pour retrouver le goût du mystère contre l’uniforme qui guette, et rendre aux étrangers leur part d’altérité. » D’où l’enjeu : « si l’on n’a qu’une langue cadenassée pour dire tout cela, comment s’y retrouver, comment trouver dans les mots intimidants ou inquiétants ce qui sera la porte de sortie, grâce à quoi on pourra s’extérioriser ? »
Ce que Bertina donne ici justement à voir, à entendre, à éprouver, dans ce texte qui échappe délibérément à toute tentative de classification, c’est à la fois la menace de ce qui fige les ressources infinies de la langue, de ce qui abrase le pouvoir émancipateur de la pensée, de ce qui enferme la liberté inaliénable des corps, de ce qui fait disparaître le sens profond des choses, logeant la nécessité d’écrire dans chacune des blessures que le réel imprime sur les corps et dans les âmes. « Qu’est-ce que je cherche à dire avec ce récit ? Peu importe son pittoresque, quelle est sa fonction littéraire ? » Jusqu’à buter sur une vérité parmi d’autres, sans nul doute la plus personnelle : « cette mélancolie qui est la mienne, embrasée par la solitude affective des filles d’ASI, le sentiment d’être abandonné. » Mélancolie existentielle et ô combien lucide de ne pas savoir comment vivre autrement qu’en fuite d’un monde auquel ne le tient jamais, viscéralement, que le fil de l’écriture.
Quand Nicolas Bouvier, cité par l’écrivain au détour d’un fragment, rappelle qu’ « on ne fait pas un voyage; c’est lui qui vous fait, ou vous défait », on pourra toujours opposer qu’à la littérature revient justement la possibilité de nous « défaire » et « refaire » à l’infini pour résister face à ce qui fait violence à l’humain. Exister ne serait-ce pas insister ? Selon l’étymologie latine, « ex-sistere » évoque le fait de sortir hors de soi, d’être capable de se projeter au-dehors, d’échapper à la prison d’un identité figée pour se penser dans le mouvement, le devenir, l’invention de soi. Ce rêve que toutes les filles d’ASI font en glissant tant bien que mal cet espoir fou dans la gangue fragile des mots de leur propre histoire. Rêve que l’écrivain rejoint à sa mesure, dans sa quête d’échapper aux artifices de l’écriture, de faire corps avec le réel, de « s’avancer ainsi nu, complètement nu, pour vivre l’aventure jusqu’au bout. » Lorsqu’il affirme qu’« un livre est un voyage si et seulement si l’auteur a été sorti de ses gonds en l’écrivant, s’il a été déplacé, charrié, emporté », c’est précisément cette profession de foi qu’Arno Bertina nous donne à vivre, et cette « tempête » qui « se rejoue en laboratoire » ébranle, pour notre plus grand bonheur, les contours de notre propre paysage intérieur.
- L’âge de la première passe, Arno Bertina, éditions Verticales, mars 2020
Lamia Berrada-Berca