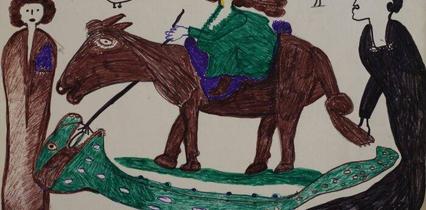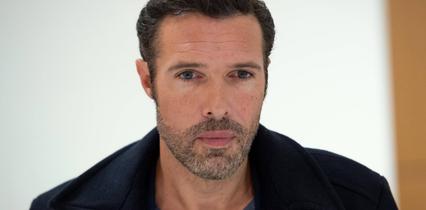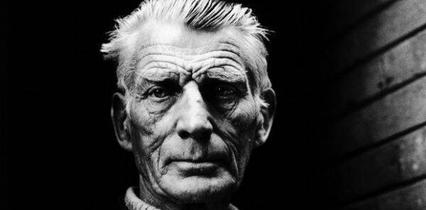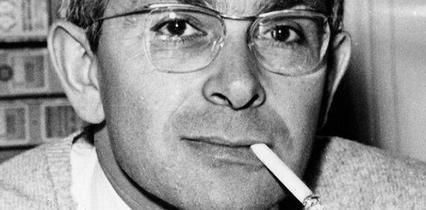Sans doute que Joëlle Zask, philosophe et professeur à l’Université de Provence, aurait préféré que son nouveau livre, Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique et publié par les éditions du Premier Parallèle, ne soit pas aussi fatalement actuel. En effet, les feux qui ravagent en ce moment la forêt amazonienne, des feux d’autant plus alarmants qu’ils ont tendance à se répéter en atteignant des proportions toujours plus grandes, posent des questions auxquelles il est urgent d’apporter des réponses intelligibles et consistantes. Si c’est en philosophe que Joëlle Zask entreprend de questionner le gigantisme de ces feux de forêt de plus en plus fréquents, elle n’oublie pas de joindre à ses réflexions une documentation édifiante et tout à fait significative pour n’importe quel lecteur. Et quoique certaines de ses conclusions fassent montre d’un optimisme contestable, celles-ci sont positivement contrebalancées par des raisonnements de la plus haute importance.
Le sombre avènement des mégafeux
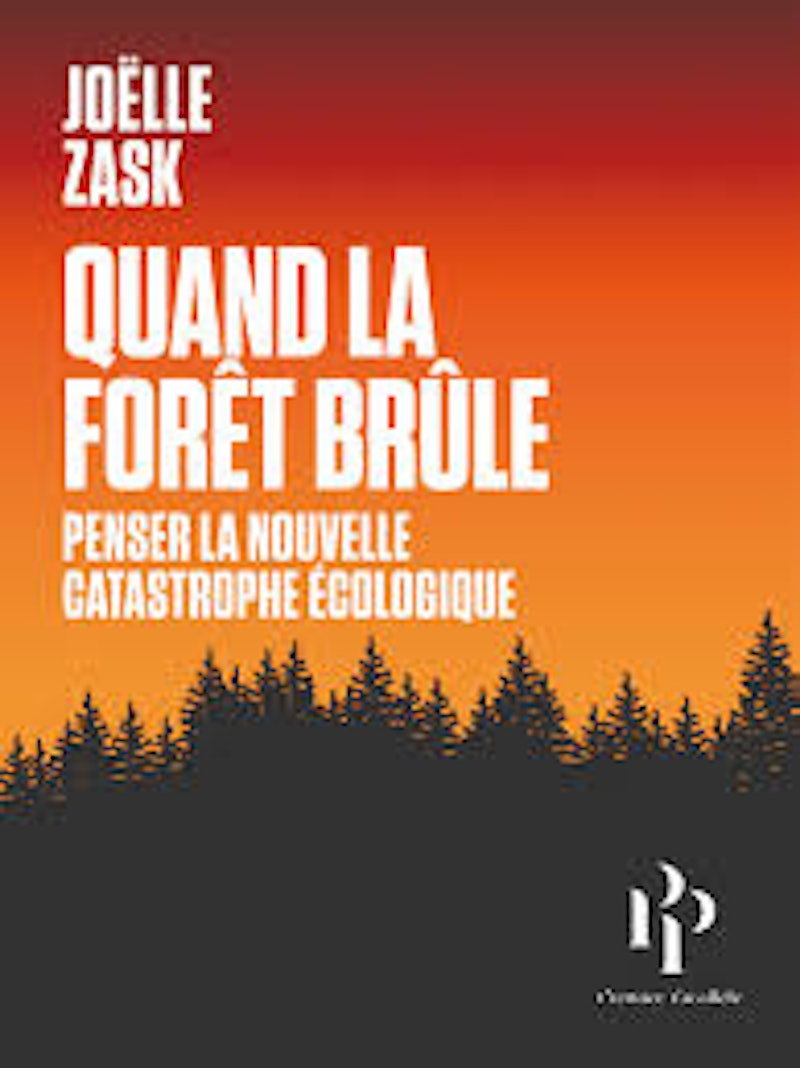
Le feu, par sa puissance de décimation analogue à notre propre nocivité envers la nature, détruit à présent nos eldorados et nos pastorales que l’on croyait invincibles.
En tant que tels, ces feux disproportionnés mais désormais solubles dans la litanie des catastrophes naturelles, se caractérisent par une « violence » et une « vitesse de propagation » sans précédent. Ils mettent en évidence la confusion d’un problème climatique et d’un problème d’ordre criminel, en cela que l’ensauvagement inhérent aux « megafires » reflète un ensauvagement préoccupant de l’humanité, le feu n’étant le plus souvent que l’enfant terrible de l’homme. Là où Freud espérait que les efforts culturels seraient en mesure d’atténuer les pulsions de violence contenues au cœur de chaque individu[1], là où la civilisation avait l’air d’avoir commis des avancées substantielles en termes de progrès moral et d’attention portée à la planète, une fissure s’est peu à peu affirmée, fragilisant lentement et résolument l’édifice des relations humaines ainsi que l’ensemble de nos relations avec la nature. Ces métamorphoses négatives ont symboliquement métamorphosé le feu de forêt en quelque chose de monstrueux. Le feu, d’une certaine manière, accentue la vision apocalyptique d’un monde menacé de mort, dégraissé de ses chairs et dépossédé de ses couleurs, nous exhibant un univers efflanqué, sorte de fantôme angoissant d’un Don Quichotte cosmique passé au crible d’Alberto Giacometti. Le feu, par sa puissance de décimation analogue à notre propre nocivité envers la nature, détruit à présent nos eldorados, nos pastorales que l’on croyait invincibles, comme la ville naguère bien-nommée de Paradise, en Californie, a perdu sa dimension édénique lors du passage diabolique des flammes durant l’automne 2018. Les paradis de jadis sont maintenant des paradis perdus que nul John Milton ne viendra sauver de la damnation. Nous avons en grande partie semé le mal qui nous accable, et tel que Jean-Paul Sartre soutenait que la bombe atomique nous exhortait à choisir de vivre ou de mourir, purifiant cyniquement notre liberté en nous offrant les moyens d’un suicide planétaire ou d’une survie réfléchie au quotidien[2], les mégafeux, aujourd’hui, nous indiquent l’étendue de nos responsabilités eu égard à un futur nettement compromis. Nous avons à résoudre la tension entre un feu de plus en plus féroce et des moyens de moins en moins efficaces pour contenir cette férocité. En d’autres termes, le fossé entre la nature et la culture s’est accru, alors même qu’il est urgent de retrouver la bilatéralité de ces notions canoniques en philosophie.
La démocratie a-t-elle vraiment les moyens de vaincre ces feux impitoyables ?
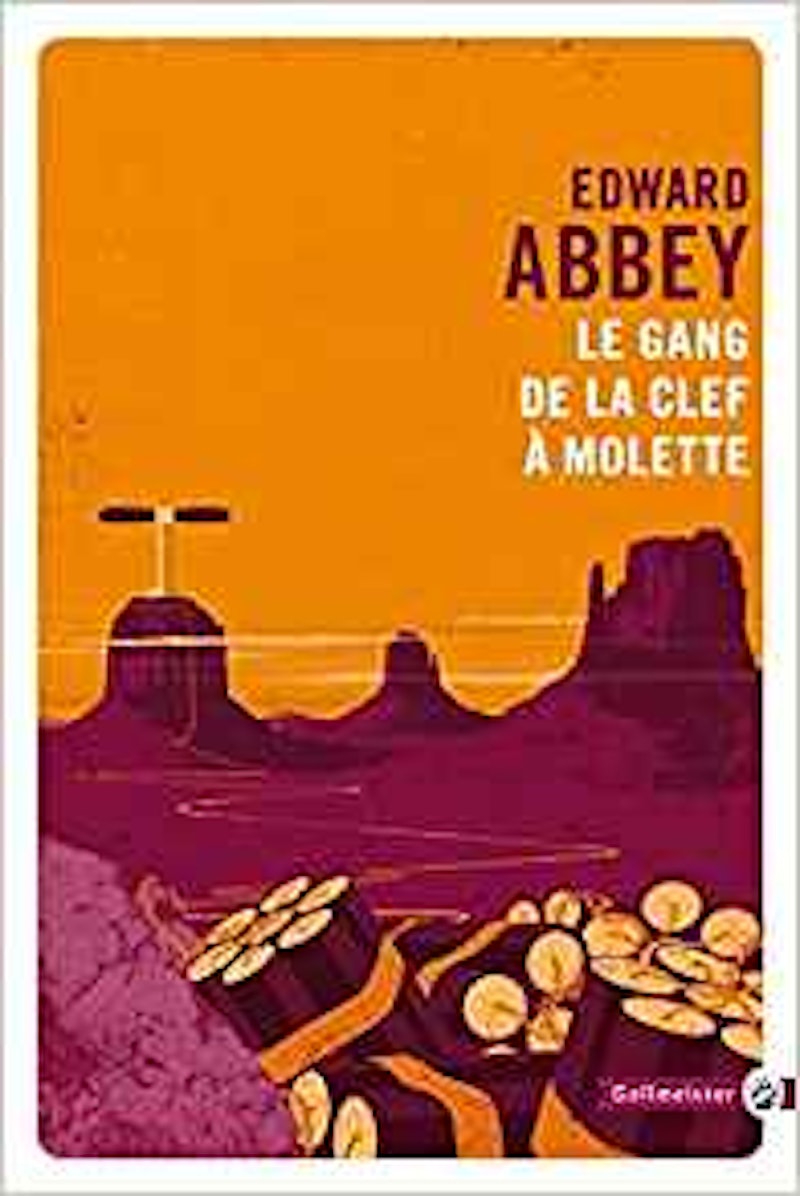
Or il n’est vraiment pas garanti que les forces concertées de la démocratie soient suffisamment adaptées pour surmonter l’impudence des magnats de l’industrie, ne serait-ce que parce que les plus connus de ces hommes d’affaires sont eux-mêmes issus de la démocratie triomphante, à commencer par celle qui vante son modèle politique sous les auspices de la bannière étoilée. Ce contexte contradictoire d’un méchant nourri par la main qui devrait l’abattre semble aussi vieux que le monde. Il n’est pas étonnant du reste que plusieurs consciences américaines aient rué dans les brancards pour critiquer ce pays qui incarne tout à la fois un gendarme du monde et un agent destructeur de ce qu’il est censé maintenir durablement dans la paix. Relativement au problème qui nous occupe, on pense évidemment à l’écrivain activiste Edward Abbey, auteur du mythique Gang de la clef à molette, un roman qui pourrait être pris comme la traduction fictionnelle des colères réelles de Theodore Kaczynski. On pense encore, plus anciennement, à Thoreau, et il n’est pas dit que la désobéissance civile du célèbre philosophe de Concord ne se fût pas envenimée si elle avait dû affronter les paralogismes d’un XXe siècle un peu trop sûr de ses techniques et de ses idées politiques. Pour toutes ces raisons qui frôlent l’évidence, nous nous autorisons à révoquer en doute les espérances démocratiques de Joëlle Zask, sans toutefois les éliminer car elles méritent d’être testées au plus tôt.
Le feu tueur : entre responsabilité humaine et fantasmes délirants
De surcroît, le livre de Joëlle Zask ne saurait se résumer à son épilogue légèrement candide. Pour preuve, son avant-dernier chapitre, à rebours de tout angélisme facile, nous avertit des dangers afférents au « pyro-terrorisme ». La stratégie de la terreur par le feu, inspirée par la « démoralisation » qui succède au défilé d’un gigantesque incendie, tend à se développer dans l’esprit des organisations terroristes. Cette stratégie s’explique aussi par l’économie des moyens déployés et la maximisation des effets observables à la suite de n’importe quelle incinération scélérate. Il s’agit de faire écho à la mélancolie traditionnelle qui colonise les intelligences au lendemain d’un incendie, d’autant que le feu terrorisant, appesanti d’une irrécusable intention de tuer, s’accompagne presque immédiatement d’une calamiteuse tonalité, charriant dans son sillage une iconographie des Enfers et la résurrection de quelques peurs millénaires. Le plus troublant, néanmoins, c’est que le terrorisme pyrotechnique représente un spectre encore embryonnaire, bien moins insaisissable que les mégafeux enregistrés pendant les années 2010 et qui nous laissent stupéfaits à chaque fois qu’ils ravagent un segment de la biodiversité. Le terrorisme est passablement prévisible tandis que les grands feux de forêt sont susceptibles de se déclarer intempestivement, quand bien même leur origine gît d’ordinaire dans un mauvais aménagement du territoire, suppressible en amont, ou dans une rationalisation outrancière des forêts, également dispensable si l’on accepte de reconnaître que la simplification abusive de la biodiversité exaspère les risques de combustion.
Joëlle Zask propose d’en finir avec une maîtrise onéreuse et orgueilleuse de l’environnement
Soucieuse de marteler ces deux facteurs aggravants, Joëlle Zask ne manque pas sa cible et propose d’en finir avec une maîtrise onéreuse et orgueilleuse de l’environnement. Alors même que la multiplication des mégafeux fonctionne selon toute vraisemblance en synergie avec la multiplication des techniques et l’infatuation d’une raison instrumentale qui voudrait tout arraisonner, il conviendrait, plutôt que de surenchérir massivement dans la réification du monde, de procéder à une décélération contrôlée de nos interventions dans la nature. De toute façon les grands feux de forêt ont une autonomie invulnérable qu’il est inutile de vouloir perturber. Ils abritent en eux-mêmes leur principe de vie et leur principe de mort puisqu’ils sont « destinés à mourir de causes naturelles », tout en ayant été la plupart du temps, rappelons-le, motivés par des causes artificielles entièrement imputables aux hommes. Par conséquent la volonté acharnée qui consiste à dominer les mégafeux aussitôt qu’ils se manifestent paraît sinon vaine, du moins coûteuse en énergie. Ce n’est pas une fois que la forêt brûle qu’il faut pousser des cris d’orfraie et combattre le feu comme si l’on entrait en guerre contre un adversaire sinistrement déconcertant. Une fois que l’autonomie du feu a confirmé l’hétéronomie des hommes, il est trop tard, quel que soit l’argent immodéré que l’on investit dans la bataille. Partant, ce dont nous avons manqué a priori, c’est probablement d’humilité d’une part, et, d’autre part, d’une prise de conscience vis-à-vis de nos attitudes envers la forêt, laquelle se voit sommée de correspondre à une mathesis universalis qui nie la réalité naturelle. Tant que nous ne verrons pas que les gains obtenus dans le temps court entraînent un effondrement dans le temps long, nous subirons la violence incommensurable des mégafeux. C’est toute la rythmique de la coordination des forêts qui doit être révisée, sinon, fatalement, nous continuerons de profiter éphémèrement de nos innovations tout en souffrant durablement, voire éternellement, des dommages causés par les mégafeux.
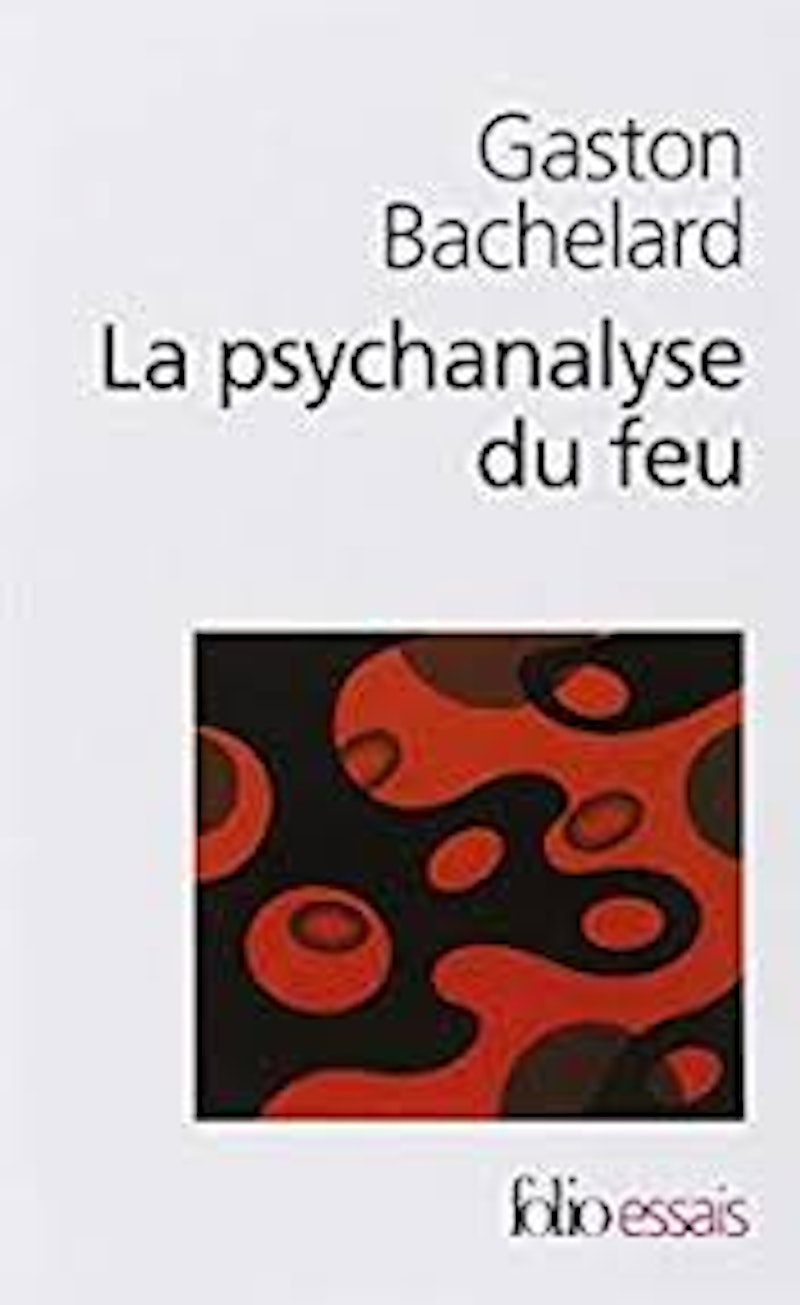
La promotion d’une existence archaïsée
Prenant à contre-pied les postures les plus interventionnistes et les tendances à la libéralité bohème, Joëlle Zask affirme que « l’équilibre ne réside ni dans l’interventionnisme régulateur humain ni dans le laisser-faire », du fait même que « les régulations écosystémiques naturelles et les pratiques humaines de contrôle [sont] toujours enchevêtrées. » Ce type de réflexion amène de la porosité dans la frontière qui sépare trop arbitrairement les notions de nature et de culture. Elle suggère encore d’envisager un net changement de paradigme, ne serait-ce que dans notre façon inconsidérée de poursuivre le maillage urbain dans les zones forestières où à la lisière de celles-ci. Elle suggère en outre une reconnaissance et une prise en charge du cercle vicieux suivant : à savoir que le réchauffement climatique, objectivement, prête la main aux mégafeux et ces derniers, par effet pervers, favorisent la production de gaz à effet de serre. C’est pourquoi Joëlle Zask milite pour une pressante réforme de notre relation au feu, se référant au mythe de Prométhée comme « gardien de la flamme », nous encourageant aussi à confier ce gardiennage presque mystique aux autochtones qui possèdent une connaissance inégalable des forêts, lesquelles doivent être travaillées par un feu régénérateur et non par des feux incontrôlables qui révèlent l’épidémie du profit industriel. Du reste, Joëlle Zask a raison d’associer l’anthropocène au « pyrocène », car la configuration des paysages et leur viabilité ont été assurées par de longs et patients usages du feu, à l’inverse de toutes les pyrotechnies modernes qui se moquent des savoirs archaïques où croît nécessairement ce qui sauve.
Laissons alors ce récent passé de cendres que nous ne pouvons plus rattraper et concentrons-nous, tel que le conseille sensiblement Joëlle Zask, à habiter la Terre en « y [passant] d’un pied léger ».
Conformément à cela, contre les « rhétoriques de la domination et de l’idéalisation », Joëlle Zask veut croire en une « interaction entre les activités humaines et la dynamique de l’environnement », assortie d’un retour aux méthodes ancestrales dans le but de repenser une cohabitation apaisée avec le feu. Il est impératif de ne plus vivre « l’individualité sans dehors » que nous endurons lorsque le grand feu de forêt a sévi. De même qu’il est impératif de ne plus se confronter à l’impossibilité d’habiter le monde après l’horreur des mégafeux, car là où ils ont détruit tous les liens qui constituaient la trame d’une société humaine, il n’est même plus concevable de vouloir habiter le monde en poète. Laissons alors ce récent passé de cendres que nous ne pouvons plus rattraper et concentrons-nous, tel que le conseille sensiblement Joëlle Zask, à habiter la Terre en « y [passant] d’un pied léger ». Et comme la réalité des grands feux de forêt a pu susciter des néologismes accablants, un comportement humain allégé, délivré des fantasmes de la « domestication » ou du « laisser-faire », est tout à fait en mesure d’insuffler une manière de parler davantage appropriée aux cadences naturelles. Nous revenons en somme à une remarque décisive de Rousseau qui supposait, dans son Essai sur l’origine des langues, une vie meilleure selon que l’on était locuteur des « langues chantantes et passionnées » plutôt que des « langues simples et méthodiques ». Les premières langues augurent une existence viscéralement guidée par la nature, alors que les secondes, orientées par des revendications d’efficacité à peine voilées, semblent assujetties à l’arythmie de certains progrès, pour ne pas dire brutalement qu’elles sont déjà mûres pour le règne des algorithmes, assassin des émotions fondatrices de fraternité sociale. Gageons ainsi que le feu, tant qu’il sera pris en compte par une langue immunisée contre les présomptions de supériorité, continuera d’être un élément amical pour les hommes, tel un feu d’artifice qui peut émouvoir les cœurs ou un feu de cheminée qui réchauffe tranquillement une maison.
- Quand la forêt brûle, Penser la nouvelle catastrophe écologique, Joëlle Zask, Première Parallèle, 208 pages, 17 euros.
NOTES
[1] Freud, Malaise dans la civilisation.
[2] Sartre, Les temps modernes (octobre 1945).
[3] Theodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1998).