Auteur de L’Abîme (éditions du Cherche midi, 2023), Nicolas Chemla a écrit Amsterdam, paru dans notre collection « Vrilles » cette année. Ce texte court évoque pourtant de nombreux sujets : le rapport au genre et au sexe, l’homosexualité, l’homophobie, la violence de certaines relations amoureuses, mais aussi, grâce à son post-scriptum, les réseaux sociaux. Estelle Derouen est revenue sur ces différentes questions avec Nicolas Chemla. Entretien.
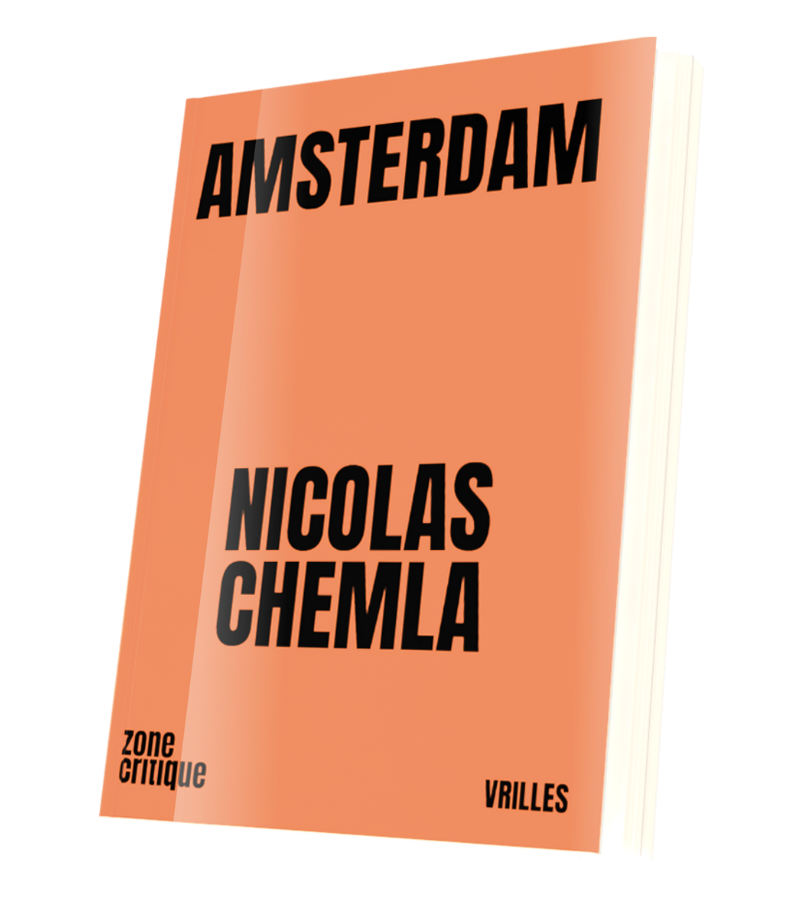
Estelle Derouen : Merci de nous mettre Rihanna dans la tête avec cette épigraphe qui ne nous quitte plus pendant la lecture, pourquoi ce choix ?
Nicolas Chemla : Alors déjà je revendique, même si mon écriture peut paraître à rebours, un côté assez pop. Le texte s’intitule Amsterdam en référence à Jacques Brel, mais je trouvais ça intéressant de l’inscrire dans sa propre contemporanéité avec cette chanson de Rihanna qui date à peu près de l’époque de son écriture. Cela électrise l’approche d’entrée de jeu. Puis, indépendamment du fait que je sois un immense fan de Rihanna, je trouve cette chanson incroyable dans sa manière de dépeindre le tourbillon de la violence conjugale, surtout quand on sait que Rihanna a elle-même souffert à cause de Chris Brown. C’est une femme forte et indépendante, c’est un modèle pour la jeunesse et malgré tout, elle raconte qu’elle a pu être prise dans ce tourbillon destructeur – elle l’a dénoncé, l’a quitté puis malgré tout est retourné le voir – avant, heureusement, de parvenir à s’en libérer. Ce morceau (« Love the Way you Lie », avec Eminem) parvient à encapsuler ce vertige. Pour certains, c’est problématique de romantiser la violence domestique et l’emprise, mais pour moi, au contraire, il est nécessaire d’en parler, et d’en parler bien, et cela demande un talent incroyable.
ED : Vous faites références aux « vrais » hommes, aux « vrais » mâles alpha. Vous allez jusqu’à écrire : « Enfant, il me manquait toujours quelque chose par rapport aux autres garçons. » Quelle serait votre définition actuelle de la virilité ?
NC : Je ne me suis jamais identifié aux garçons ou aux hommes, ce qui m’intéresse c’est d’être un individu libre en cohérence avec moi-même. Je rêve d’un monde où la question du genre ne se pose plus, qu’on aille au-delà – ce qui n’est pas vraiment le cas de nos jours, sorti d’un petit cercle grossi par la loupe des médias et des réseaux sociaux. La plupart des jeunes garçons continuent de se sentir obligé de « faire montre » de leur virilité, par des regards, des attitudes.
C’est très présent dans l’esprit des jeunes et je trouve cela dommage.
ED : Vous écrivez aussi « Ma virilité est virtuelle », est-ce une manière de dire que l’on peut se créer une virilité à travers notre manière de nous mettre en scène sur Internet ? Est-ce une façon de se recréer ? Cela rappelle un aspect de votre dernier roman L’Abîme paru aux éditions du Cherche midi.
NC : C’est un des points de Judith Butler, le genre est performatif et c’est quelque chose qu’on écrit à l’extérieur du corps ou qu’on nous écrit.
Moi, ce qui m’intéresse c’est l’écart entre le substrat biologique et la capacité de se réinventer : c’est là qu’il y a une histoire à raconter.
Mais plus que Butler, ma référence c’est le Manifeste Cyborg de Donna Haraway – que j’enseignais à mes élèves de Sciences Po, quand j’étais le premier à donner des cours sur le genre dans une grande école parisienne, il y a près de quinze ans. C’est un texte fondamental, incontournable sur la question du genre, et trop souvent ignoré. Il date de 1984, mais il est d’une incroyable modernité – on pourrait presque dire « prescient ». Haraway y explique que la vraie émancipation passe par la figure du Cyborg – une individualité qui va être augmentée par la technologie, les avatars par exemple mais aussi les hormones, les appendices etc. Elle a aussi l’intuition que cette identité fluide, qui évolue en permanence, est liée aux interactions avec les autres. C’est une vision qui intègre complètement le numérique, le social et la technologie dans une sorte de réinvention permanente, de fluidité, qui est le terme le plus important pour moi, y compris et surtout d’un point de vue littéraire – c’est ce qu’incarne le passage sur le Delta du Mékong dans ma nouvelle.
Mais dans la phrase que tu cites, c’est beaucoup plus simple : c’est davantage un clin d’œil à ce que l’on appelle la culture des « clones » dans les années 1980-90 dans la communauté gay, qui constitue à surjouer l’apparence du masculin pour se le réapproprier – une sorte de revanche sur les humiliations subies enfant. Mais pour la plupart des hommes, dans le monde entier, le masculin n’est pas seulement « de surface » – c’est un rapport de domination, à soi, aux autres, aux objets, une forme de contrôle aussi. Un rapport plus mécaniste et pragmatique aux choses, comme je le raconte dans le texte d’ailleurs.
ED : N’est-ce pas cliché de parler des hommes hétérosexuels ainsi aujourd’hui ?
NC : Il me semble au contraire que c’est de plus en plus vrai, malgré une évolution « de surface », liée à un microcosme, grossie comme à la loupe par les médias et les réseaux sociaux. La réalité sociologique montre que les choses n’évoluent que très peu, et encore plus quand on se place à l’échelle planétaire. Il n’y a qu’à voir la répartition des tâches au sein des foyers ou encore dans les professions exercées – il y a encore des métiers essentiellement masculins. Cela confirme le fait que le cliché est encore bien présent. De Poutine en Russie à Milei en Argentine en passant par les masculinistes ultra-populaires sur les réseaux sociaux, la culture « caillera » dans les collèges et j’en passe, le virilisme se porte hélas très bien.
ED : Quand on vous lit, on a finalement l’impression qu’il n’est toujours pas si évident d’assumer son homosexualité en 2024. Vous parlez de la peur mêlée à la honte d’être homosexuel. L’acceptation de toutes les sexualités serait un truc de bobo, de CSP+, de gens qui vivent dans les grandes villes ? Pour reprendre les termes de « safe space », celui-ci serait en fait infime ?
NC : À moins de s’enfermer dans une bulle avec que des copains homos ou queers avec lesquels tu ferais toute ta vie – ce qui serait non seulement dommage, mais utopique et difficilement réalisable – je ne crois pas que l’on puisse passer sa vie dans un « safe space ». À moins d’être dans cette situation-là, la réalité de la vie homosexuelle c’est le coming-out permanent, et Didier Eribon l’explique très bien dans son texte Réflexions sur la question gay. Cela veut dire que l’on est constamment en train de se demander, quand on rencontre une nouvelle personne par exemple, si l’on peut le dire ou pas, et à quel moment. Avec son copain, la question se pose de savoir si on peut s’embrasser en public. À quel moment on peut dire qu’on est attiré par les hommes, si on se retrouve à partager un dortoir lors d’un trek par exemple ? Même question dans le cadre d’un nouveau job, quand tes collègues racontent leur weekend en couple avec leur épouse – bien sûr ça dépend des jobs, mais je peux vous dire qu’il y en a encore une majorité où ça ne va pas être évident.
Récemment, à mon club d’escalade, qui est un peu mon « safe space », des gamins turbulents, de la cité d’à côté, se traitaient de « pédés » entre eux, à deux pas de moi. J’ai beau être à l’aise, avoir toujours été « out », être encore dans la force de l’âge, c’est le genre de situation où la blessure, le malaise, se rappelle à toi. C’est une peur presque physique, la possibilité d’un déferlement de violence, et ça arrive régulièrement dès qu’on sort de son cercle de gens bienveillants. C’est ce que je raconte dans Amsterdam, c’est une blessure qui ne se referme jamais.
La grande force de la nouvelle génération c’est qu’elle sait qu’elle a la loi de son côté – mais la loi ne te sera pas d’un grand secours face à la menace d’un coup de canif.
ED : Une partie de ce texte, nous l’avons dit, date de 2007, donc avant la grande démocratisation des réseaux sociaux et des applications de rencontre, avant 2013 et le mariage pour tous. Dans quelle mesure ces sensations sont encore d’actualité ?
NC : En fait, ça n’a pas changé tant que cela. Je pense même que cela a empiré. L’homophobie a énormément augmenté depuis 2007, quand on regarde les statistiques c’est assez frappant. Plus l’identité homosexuelle se cristallise et se visibilise, plus il y a une crispation. Une bonne partie des hétéros restent terrorisés à l’idée « d’en être ». L’idée de faire de sa sexualité le fondement de son identité est assez récent, le terme même d’homosexualité n’apparaît qu’en 1865, en même temps que le terme sexualité, d’ailleurs, et c’est à partir de là qu’apparaît cette idée, totalement inédite et saugrenue jusqu’alors, que nos pratiques sexuelles détermineraient de façon fondamentale notre identité. Auparavant, il y avait des pratiques sexuelles mais elles n’étaient en rien structurantes de l’identité individuelle. On peut lire à ce sujet The Emergence of Sexuality de Davidson, c’est passionnant – mais c’est aussi ce qu’explique très bien Foucault dans son Histoire de la Sexualité.
ED : Est-ce qu’en voulant protéger, on a finalement vulnérabilisé ?
NC : On a surtout enfermé. La conséquence de cette essentialisation d’une « identité sexuelle » – qui fait de quelque chose qui pourrait être « anodin » un élément structurant de l’identité –, c’est une forme de crispation, voire de vertige – comme si d’avoir tel ou tel désir à un moment donné allait déterminer pour toujours qui on est – or, de par le monde, la plupart des garçons, qui pourraient très bien accepter une petite passade anodine de temps en temps, ne veulent surtout pas « devenir gay », et donc rejettent avec violence le moindre désir qui pourrait les « faire basculer ». Le problème de l’homophobie c’est que le choix du mot « phobie » est malheureusement pleinement justifié. La différence avec les autres formes de haine, c’est que l’homophobie n’est pas un rejet de l’altérité, c’est un rejet de quelque chose qu’on a tous en nous potentiellement. Aucun homme n’est « à l’abri » d’avoir un fantasme pour un autre. Ça devrait être anodin, mais la modernité en a fait quelque chose de « structurant » – d’où le rejet, d’où la violence.
À cela s’ajoutent les applications de rencontre, qui ont énormément détérioré les relations entre les humains. Il y a beaucoup d’usages à mauvais escient et il arrive souvent que des homos soient victimes de guet-apens. Le fonctionnement de ces apps est intrinsèquement violent : la réduction de l’autre à une simple marchandise, le fait de pouvoir être ghosté du jour au lendemain, de se faire rembarrer plusieurs fois par jour – c’est très destructeur, à long terme, tous les psys vous le diront, et ça ne fait que renforcer le mal-être – mais là-dessus, désormais, les hétéros n’ont rien à nous envier.
Amsterdam n’est pas là pour donner des leçons et on fait parfois cette erreur d’attendre des artistes qu’ils s’expriment sur le bien et le mal. Mais je n’ai aucune leçon à donner.
ED : En tout cas, le personnage de Pascal semble ressentir un dégoût vis-à-vis de ses attirances sexuelles et cela se manifeste notamment par des rapports charnels violents. Cette violence qui peut, par ailleurs, être recherchée et désirée, mais qui traduit surtout un profond mal-être. Comment expliquez-vous ce transfert ?
NC : Sur la haine de soi, énormément de gays ont grandi avec une homophobie internalisée. L’ouvrage The Velvet Rage d’Alan Downs parle exactement de ça, de ce transfert de haine. On gère plus ou moins le fait de grandir avec cette blessure et cela engendre pas mal de comportements autodestructeurs. La réalité de la plupart des communautés gays dans le monde, contrairement à ce que veut nous faire croire une certaine représentation médiatique, c’est une recrudescence des comportements autodestructeurs, le chemsex, les taux de suicide élevés chez les adultes, des violences, etc. Le film Sans jamais nous connaître raconte cela très bien. Mon roman L’Abîme en parle aussi. Je crois que c’est aussi ce qui rend les grandes drag queens aussi fascinantes : elles sont rageuses et furieuses, elles transforment cette blessure et cette rage en énergie festive et flamboyante.
ED : Pour revenir à la question d’assumer son identité, vous parlez justement d’identités préfabriquées, comme si les gens n’étaient plus capables d’être eux-mêmes en dehors de modèles préconçus « marketés » ?
NC : Oui, tous les sociologues sérieux savent que les réseaux sociaux encouragent et renforcent le mimétisme, qui est au cœur même de leur fonctionnement. Ça entraîne un conformisme assez consternant, une manière de coller à son identité et de s’y enfermer qui laisse peu de place au vertige. Ajoutez à cela cette approche « idéologique » de la création artistique, qui voudrait que, comme la représentation structure le réel, il y aurait une sorte de devoir de représentativité positive, comme un cahier des charges algorithmiques : « on ne veut que du gay gai, surtout pas de gay triste » ! Cela amène à des créations complètement lisses, alors que pour qu’il y ait littérature, il faut cet écart, cette brèche, ce vertige. C’est là qu’il se passe quelque chose.
ED : Justement, à la fin est écrit « il restera toujours un infini entre toi et toi, entre toi et le monde » et on dirait que c’est cet infini qui vous inspire.
NC : La réalité du désir, c’est que c’est un mouvement hors de soi, une « é-motion ». Pour faire ce mouvement vers l’autre, il faut faire ce pas au-dessus du vide, et c’est là qu’il y a un vertige, un abîme qui s’ouvre et d’où peuvent émerger des histoires, des phrases, des images qui vont marquer. Là est le plus important pour moi.
C’est ça, le vrai sujet d’Amsterdam : Comment la rencontre amoureuse, qui devrait être la plus belle chose de l’existence, peut se transformer en cauchemar absolu. Amsterdam n’est pas là pour donner des leçons et on fait parfois cette erreur d’attendre des artistes qu’ils s’expriment sur le bien et le mal. Mais je n’ai aucune leçon à donner.
Oui, pour moi, la seule littérature qui vaille est celle qui s’échappe et qui échappe : au contrôle d’identité, aux assignations à résidence.
ED : Et écrire cette nouvelle était-il salvateur, une manière de vous purger ?
NC : Je n’ai pas cherché à me soigner en l’écrivant. Il ne s’agit pas d’écriture thérapie ou d’un texte qui va aider les lecteurs. Il s’agit juste, au moment où j’étais pris dans ce vertige destructeur, de se dire qu’il y avait là matière à créer un diamant noir, à créer et à transformer cette souffrance et ce vertige en quelques phrases qui encapsuleraient comment l’amour devient destructeur, comment le rêve devient cauchemar – à creuser cette idée exprimée par Rilke dans Les Élégies de Duino, que la beauté n’est peut-être que le premier pas de la terreur, que le désir et le danger sont intimement liés.
Et puis ça posait aussi la question de l’âme, et de l’amour : Est-ce que le désir est purement mécanique ? C’est quoi, « faire l’amour » ? La réduction à la machine, présent dans L’Abîme, est un thème récurrent dans le fantastique. Déjà, dans Le Marchand de sable de Hoffmann, il y a cette idée d’automate, qui est aussi une figure du Diable. Or, les algorithmes, la consommation de l’autre comme un objet de catalogue, c’est justement une marchandisation et une mécanisation de l’être humain.
C’est pour ça qu’à mon sens, la singularité du style est en elle-même une réponse à cette menace. Écrire contre l’algorithme, c’est assumer la déroute et la discorde, être là où on ne nous attend pas, oser faire ce pas de côté.
ED : Dans cette nouvelle, il est question notamment de genre, mais quelle place lui consacrez-vous dans votre œuvre ?
NC : Oui, pour moi, la seule littérature qui vaille est celle qui s’échappe et qui échappe : au contrôle d’identité, aux assignations à résidence. Celle qui se situe dans cette zone interstitielle entre le rêve et le réel, la vérité et la fiction, le drame et la comédie. Elle échappe au genre, masculin et féminin, et elle échappe aux genres.
Dès Monsieur Amérique, mon premier roman paru chez Séguier, c’est la question fondamentale : légende ou réalité ? homme ou machine ? masculin ou féminin ? roman ou biographie ? En plus, le sujet lui-même, le bodybuilding, est l’incarnation même de toutes les questions sur le genre, construit et déconstruit. Dans Murnau des Ténèbres, au Cherche Midi, on est à nouveau dans cette zone trouble entre les genres, les identités, les cultures. Murnau était le premier réalisateur ouvertement gay, et le premier à tourner avec une équipe entièrement « indigène », tous pays confondus, et l’histoire du tournage de Tabu, que je raconte dans le roman, est tout entière située à la lisière du rêve et de la réalité, de la légende et de l’histoire vraie. Dans la culture maorie, comme dans son cinéma, il n’y a pas de frontière clairement définie entre les êtres, il y a quelque chose de fluide qui traverse le monde et passe de l’un à l’autre. C’est aussi ce trouble que je travaille dans L’Abîme (la figure du Chat comme mystère insaisissable est, en ce sens, fondamentale) – et déjà dans Amsterdam. D’où cette « sorcellerie évocatoire », pour reprendre les termes de Baudelaire, que je recherche dans mon style, afin de placer le lecteur dans cette interzone où les genres se troublent.
- Pour vous procurer Amsterdam, rendez-vous sur notre boutique.


















