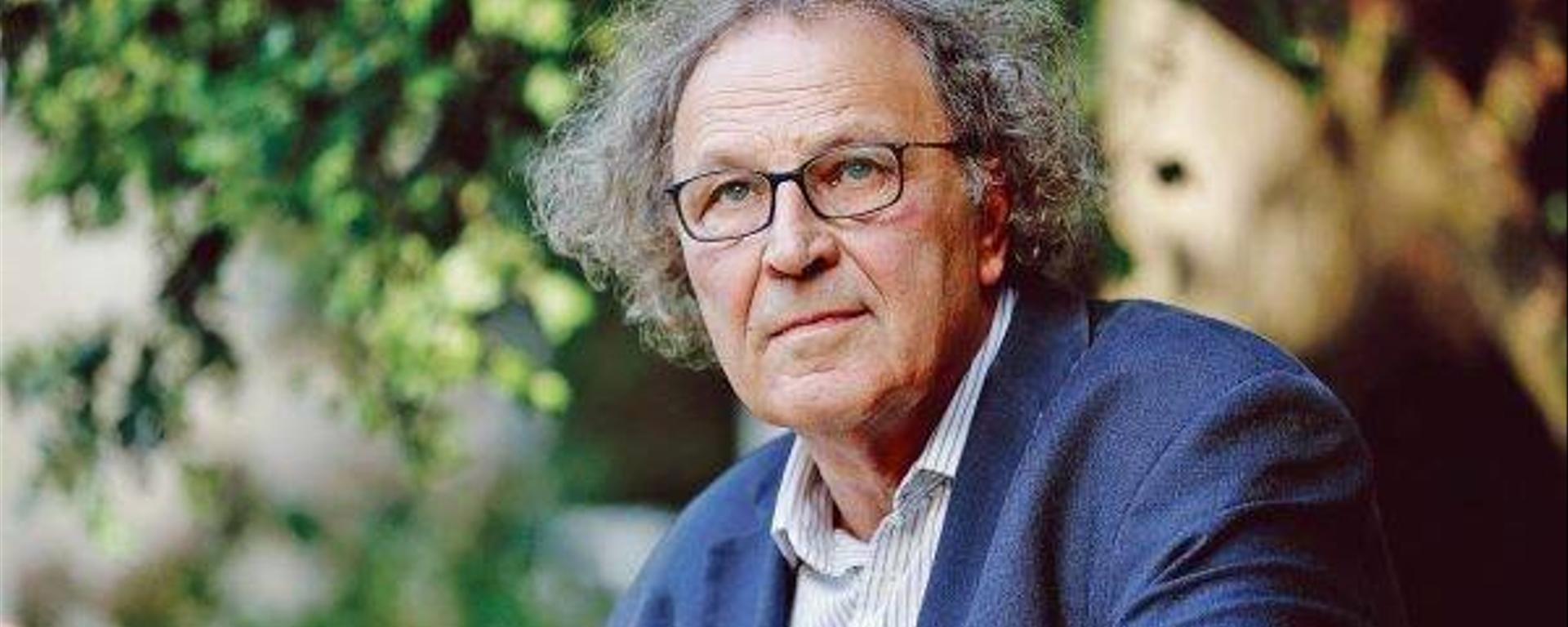Une revue telle que Zone Critique ne peut que répondre qu’il y a encore un espoir. Mais cet avis n’est pas partagé par Jean-Michel Delacomptée, l’auteur de l’ouvrage Notre Langue Française, qui vient de paraître chez Fayard. Dans cet essai, l’écrivain fustige la déchéance de la littérature, intrinsèquement liée selon lui à la décrépitude de la langue parlée.
Quel est le lien particulier entre la langue française et la littérature ?

En effet, la littérature pour plaire à un public avide de divertissement se simplifierait au lieu de le tirer vers le haut par son exigence langagière. Ainsi Jean-Michel Delacomptée compare deux traductions du Club des Cinq, une série de romans pour enfants, écrite par l’auteur britannique Enid Blyton. En 1955 : « Bientôt, les enfants virent déboucher la locomotive, coiffée d’un panache de fumée. » En 2006 : « Bientôt, les enfants voient déboucher le train ». Ceci revoie à une autre idée défendue par l’essayiste : « «il n’y a pas de culture de masse », puisque la culture par définition suppose une exigence. Elle demanderait de sortir du commun pour s’élever vers un absolu. Ainsi Delacomptée fustige la démocratisation de l’accès aux livres si c’est au prix d’un nivellement généralisé de la production littéraire. Aujourd’hui, la littérature deviendrait aussi le lieu narcissique d’une contemplation de soi, plutôt que de permettre de s’abstraire dans un style exigeant et des connaissances nouvelles : « Du coup, on se rue sur les autofictions où l’on cherche ce qui se rapporte à soi, aux questions que nous pose notre existence personnelle, aux réponses qu’on espère». Enfin, la littérature actuelle se devrait d’être bien-pensante, et comme on ne peut faire de la bonne littérature avec de bons sentiments, nous irions irrémédiablement vers la médiocrité.
Ainsi Delacomptée fustige la démocratisation de l’accès aux livres si c’est au prix d’un nivellement généralisé de la production littéraire
Ainsi s’oppose à la beauté l’utilité, à la littérature la communication, à l’écrit l’oral, au temps long de la pensée, l’immédiat de la parole jetée sans réflexion. On pourrait encore ajouter à l’unité du français son anglicisation, à la cohérence entre le code écrit et le code oral, l’écriture inclusive. Traiter de cette dernière question nous entraînerait trop loin (peut être dans un prochain article?) mais on voit que pour l’auteur les menaces sur la belle langue ne cessent de se multiplier.
Qui peut juger de la beauté de la langue?
Jean-Michel Delacomptée qui est essayiste et non philosophe, ne rentre pas dans des considérations sur une justification profonde de ce qui fait ou non une belle langue. Il ne se pose pas non plus la question de savoir s’il est possible d’en juger. Il préfère dire qui pose ce critère d’une belle langue française : « Le peuple retient ce qui lui plaît et élimine le reste ». Ce peuple serait le premier correcteur de l’élite : « Mieux que tout autre, notre peuple, sait que la langue de l’État lui renvoie son image. La répartie vulgaire d’un président à l��’encontre d’un quidam qui l’insulte l’atteint dans la représentation qu’il se fait de lui-même. Il se sent diminué par les phrases banales, les tournures bancales, les maladresses et les lourdeurs ». Même si le critère du nombre pour juger de la valeur semble une idée commune, il est difficile de savoir de quoi il s’agit ici.
L’auteur défend l’« usage » du peuple comme critère ultime, tout en insistant sur la nécessité des règles et de l’exigence formelle. Il porte Malherbe aux nues, mais le trouvant trop dur, défend l’usage, qui « supprime ce qui détonne ». Le raisonnement ne semble pas tout à fait juste : pourquoi l’usage d’aujourd’hui et sa tendance à la simplification seraient-ils alors à remettre en cause ? Entre la règle et l’usage – et je reconnais que c’est un problème ardu à résoudre – Jean-Michel Delacomptée semble choisir en fin de compte son propre usage. Ainsi écrit-il « Je me vois mal souscrire au… », suivent toutes les règles énoncées par Malherbe que Jean-Michel Delacomptée juge trop rigides. Cependant son livre est bien un pamphlet contre l’usage actuel de la langue. On a du mal à ne pas voir que personne ne semble apte à déterminer les critères de rectitude et de décrépitude sinon lui-même. Si l’on passe à la littérature, son écriture assez alambiquée rend le propos d’autant moins convaincant que son style n’est ni très clair ni très séduisant.
On a du mal à ne pas voir que personne ne semble apte à déterminer les critères de rectitude et de décrépitude de la langue sinon l’auteur lui-même. Si l’on passe à la littérature, son écriture assez alambiquée rend le propos d’autant moins convaincant que son style n’est ni très clair ni très séduisant.
Je me demande aussi si Jean-Michel Delacomptée n’est pas trop exigeant pour le temps présent : quant aux chefs-d’œuvre, il faut peut être accepter que c’est la postérité qui en jugera. Toute époque a du mal à distinguer le bon grain de l’ivraie en matière littéraire. Même la Phèdre de Racine ne fut pas immédiatement reconnue à sa juste valeur, puisqu’elle subit la concurrence de Phèdre et Hippolyte de Nicolas Pradon, également créée en 1677. Il fallut un peu de temps au public pour reconnaître un génie que l’on considère comme classique aujourd’hui. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il ne faudrait pas trop vite patrimonialiser ces potentiels chefs-d’oeuvre en les faisant étudier dans les classes, comme on le fait parfois sans prudence.
Une langue peut-elle véhiculer des valeurs?
Cette question reste en suspens. On lie communément des représentations aux langues : le grec serait par exemple la langue de la pensée et de la philosophie. Cependant, la sociologie remet en question cette idée : on attribuerait des qualités à une langue selon la domination qu’exerce ceux qui la parlent. Max Weinreich écrit ainsi «Une langue est un dialecte avec une armée et une marine ». En revanche, il est certain qu’une langue porte en elle une histoire, qui a construit son vocabulaire et ses expressions. On ne peut alors souscrire aux volontés de rendre la langue purement utilitaire en supprimant tout ce qui est difficile à écrire en termes de grammaire. Pour Jean-Michel Delacomptée, « notre langue a toujours tendu à l’égalité». Il attribue ce lien à des caractéristiques formelles : « Il s’ensuit que, pensée dans le moule de notre langue, la Révolution a chaussé le principe d’égalité comme un soulier fait sur mesure ». La langue française ne marquerait pas de distinction insurmontable entre les êtres. Elle serait aussi parfaitement rigoureuse et claire, ce qui correspond à une pensée elle aussi précise et limpide. On reconnaît ici le bel idéal classique.
Cette vision de la langue explique que l’essayiste associe à la décrépitude de la langue la décrépitude des valeurs : mais le propos devient alors trop général puisqu’il traite de tout ce qui dans notre temps peut être perçu comme des signes de décadence (je me suis souvent demandé « Par rapport à quand ? »). On peut d’ailleurs souligner que cette défense de la clarté est elle-même quelque peu embrouillée.
Cette vision de la langue explique que l’essayiste associe à la décrépitude de la langue la décrépitude des valeurs. On peut d’ailleurs souligner que cette défense de la clarté est elle-même quelque peu embrouillée
Il y a cependant quelque chose d’intéressant dans cette idée d’égalité : la mission de la langue française serait une égalité par le haut, proposer à chacun un medium magnifique et varié pour exprimer une pensée complexe. Pour subvertir des règles, il faut d’abord les maîtriser. On peut parler une langue qui n’est pas celle de l’école du moment qu’on sait également utiliser la première. Je ne sais si toutes ces choses existent essentiellement dans la langue française, mais je trouve que c’est un objectif exigeant, qui dessine une pédagogie tendant de toutes ses forces vers l’égalité. Jean-Michel Delacomptée craint précisément le nivellement à cause de l’absence de maîtrise contemporaine de la diversité des codes. Il remarque également que ce sont souvent les gens qui maîtrisent les codes qui pensent qu’il ne faut pas les transmettre : « Un groupe restreint d’héritiers bardés de culture bourgeoise et d’exotisme révolutionnaire a dilapidé la fortune que des démocrates véritables se seraient attachés à distribuer au plus grand nombre. »
Quelles sont les causes de cette décrépitude ?
C’est une question que je n’ai eu de cesse de me poser. Les causes de la dégradation de la langue n’interviennent qu’à la moitié de l’ouvrage : « Causes de cette dégradation : la chute du mur de Berlin, qui a déclenché une financiarisation sans limites, l’obsolescence des utopies qui stimulaient l’inventivité des théoriciens à petites lunettes rondes et à cigarettes roulées, la spécialisation intensive des travaux de recherche qui focalise sur d’étroits segments les vastes vues autrefois déployées, la technicité en pole position dans les études de lettres qui a glacé leur agrément, les penchants indolents de l’hédonisme permis par la prospérité matérielle et par la libération sexuelle malgré le sida, le retrait de l’Etat enfin dans les traditionnels enjeux d’une politique culturelle conquérante à défaut d’édifier ses pratiquants et ses publics (hip-hop et Mozart dans la même cour, tags et Rembrandt même combat). Ces ressorts, et certainement d’autres, sans fin renforcés par la prévalence de la représentation audiovisuelle du monde, “vidéorale” plutôt – voix des smartphones et des machines, écouteurs omniprésents, yeux zappeurs des écrans –,ont rendu solitaire la littérature à prestance affirmée.»
De tout cela, retenons la standardisation des pratiques culturelles et le culte du plaisir et de l’immédiateté. Sans m’étendre, je m’interroge ici malgré tout sur la place du fantasme: d’une langue, d’une époque et d’un peuple à l’usage raisonné. Ainsi selon l’essayiste, l’expression notre langue française « nous fait souvenir que nous parlions une langue partagée, que nous nous y sentions naturellement à notre aise ». Disons qu’il y aurait une baisse de niveau par rapport à l’école de la troisième République, et à partir du collège unique en 1975. Mais c’est précisément des analyses poussées sur ces faits qui manquent dans Notre langue française. Il manque peut être aussi une certaine largeur de vue : l’histoire de l’unification de la langue ne s’est pas faite facilement en France, voir violemment avec l’interdiction des patois sous la troisième République. Plutôt que conspuer ce qui existe, ne faut-il pas en expliquer les causes ? Et surtout proposer des solutions ?
À cet amour blessé et vindicatif, je préfère les réflexions patientes de Jacqueline de Romilly dans Le Trésor des savoirs oubliés
Je comprends la nécessité de partager son indignation, mais Jean-Michel Delacomptée en appelle sans cesse à l’exigence de la langue. Proposer est une attitude exigeante. Je pense à ce qu’écrit Bertrand Binoche dans son ouvrage Philosopher à l’âge des Lumières à propos de l’esprit de ces philosophes :« La négation est héroïque, mais enfin, elle n’est que négation. Et en tant que négation, elle ne peut être que passagère ». De plus, la pente de la négation est glissante, l’essai devient parfois un fourre-tout pour fustiger tout ce qui fait notre époque. En attendant, c’est là où nous sommes. Et Jean-Michel Delacomptée reconnaît lui-même que c’est une attitude qui le fatigue quand il la retrouve chez les autres : « La conception de notre langue exposée par Paul-Marie Coûteaux, fière de ce qu’elle défend, ardemment éprise de ce qu’elle protège, irréductiblement fidèle à la mémoire, à la terre du peuple français, me parle à cœur ouvert mais aussi me fatigue […] sa lecture manque d’air. » Ce qui le sauve est de ne pas être tout à fait dupe de sa propre attitude : il cite lui même des écrivains qui déjà au début du XXe siècle étaient désespérés par la déchéance de la littérature. Léon Daudet critique ainsi Georges Sand dont les romans seraient « fades et illusoires » !
A-t-on encore le droit de croire en la langue française ?

On peut tirer deux choses de cela : la première est que la croyance enthousiaste de Jean-Michel Delacomptée en la langue est difficile à recevoir pour un lecteur contemporain, à cause de cette impossibilité du lyrisme. La seconde est que lier la perte d’idéal transcendant de la société contemporaine au manque d’exigence envers la langue est cohérent : comme on ne peut adhérer sans distance à des valeurs, on ne peut porter aux nues une langue que l’on dirait sublime. On peut probablement suspendre personnellement son jugement sur cette question, mais a-t-on le droit de le faire lorsqu’il s’agit de transmettre ?
À cet amour blessé et vindicatif, je préfère les réflexions patientes de Jacqueline de Romilly dans Le Trésor des savoirs oubliés. Elle qui enseigna toute de sa vie explique, une fois de plus, la beauté et l’importance des lettres et de leur enseignement, passionnément mais sans acrimonie. L’indignation est parfois juste mais elle se fait trop souvent désespérante dans Notre langue française.
- Notre langue française, Jean-Michel Delacomptée, Fayard, 220 pages, dix-huit euros.