
Dans L’Autre art contemporain, paru récemment chez Grasset, Benjamin Olivennes, professeur de philosophie à Columbia, revient, au prisme de l’esthétique et des idées, sur la production contemporaine. Dans un essai direct mais non simpliste, l’auteur s’affirme lassé d’une Histoire à sens unique où Balthus serait irrémédiablement dépassé par Jeff Koons. Cet essai d’esthétique remet en cause les doctrines qui voudraient en finir avec la forme en art. Loin d’une critique facile de la production contemporaine, cet ouvrage au parti pris assumé tente d’établir un autre récit de celle-ci, où la belle part est faite à la représentation, au sens du Beau, ou encore à la notion d’école nationale.
Contre l’Art contemporain comme dogme
Tout d’abord, l’auteur rassure ce qu’il nomme le «sens commun», bien souvent perplexe devant nombre d’œuvres actuelles dépourvues d’intérêt, et dont l’avis à leur propos serait d’emblée méprisé. Rabâchée par les collectionneurs, les appareils d’État ou encore par les Écoles, l’art contemporain constitue une idéologie contre laquelle il est difficile de pester, sans passer pour un ignare ou pour une chaisière à serre-tête. Ce catéchisme aux relents mercantiles est bien sûr à distinguer d’une production authentique dont l’auteur se fait le relais.
Or, « l’admiration » reste un besoin fondamental de l’âme humaine rappelle Olivennes : avant d’être réalisée par un artiste, la création est avant tout une « œuvre ». Caractérisée par son unicité, elle demeurait irremplaçable. Fruit d’un dur labeur, elle était nimbée d’une « aura magique », maintenant une forme de proximité et d’éloignement selon la formule de Walter Benjamin. La preuve en est que le Moyen Âge nous a légué une quantité importante de sculptures non signées, suscitant toujours notre émerveillement.
A rebours de ce désir, l’art contemporain avec ses requins dans le formol, son goût pour les « sécrétions humaines » et du « fun » veut choquer. Tel le mutin de Panurge de Muray, l’artiste commercial surenchérit pour provoquer le bourgeois, alors qu’il ne choque plus personne.
Contre cet instinct, Olivennes cherche à renouer avec le classicisme éternel.
En somme, une circulation entre la production et le monde, la mimèsis présente de Lascaux jusqu’à Kiefer, dont le philosophe affirme qu’elle est un « droit de l’homme » permettant d’habiter le monde, de revenir vers lui tout en le rendant supportable.
Il en tire d’ailleurs plusieurs points saillants : « l’observation de la réalité sensible, et sa mise en forme par l’intelligence ; le monde, et l’œuvre ; la vérité, et la beauté ; le monde en trois dimensions, dans l’espace et dans le temps, et sa recréation en sculpture ou sur une surface plane ». En somme, une circulation entre la production et le monde, la mimèsis présente de Lascaux jusqu’à Kiefer, dont le philosophe affirme qu’elle est un « droit de l’homme » permettant d’habiter le monde, de revenir vers lui tout en le rendant supportable. « Nous avons l’art, afin de ne pas mourir de la vérité » écrivait Nietzsche.
Enfin, Olivennes cherche à réhabiliter par cette sensibilité harmonieuse à la fois la production artistique comme métier, et comme quête de la beauté. Tandis que le premier, qualifié « d’alliance de savoir et de délectation », retourne à son étymologie signifiant « savoir-faire » (ars), le second implique le « mélange de fraternité humaine et de distance infinie ».
De cette critique acerbe va naître un récit alternatif face au credo contemporain.
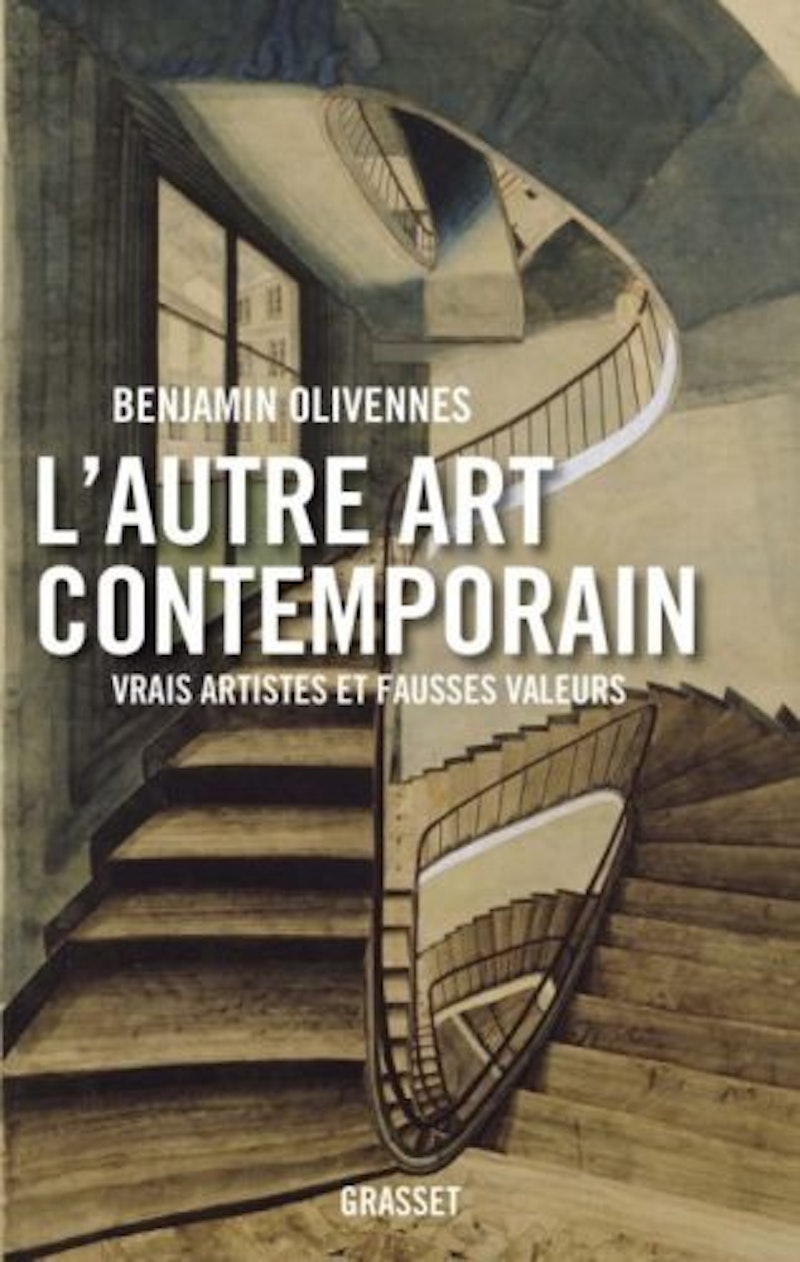
Avant de critiquer judicieusement la conception contemporaine de l’art, Olivennes cherche à la spécifier : progressive et linéaire, elle établit la « non-réversibilité » des choses. Calquée maladroitement sur les thèses hégéliennes, elle implique le dépassement permanent d’un état par un autre dans un mouvement dialectique. Pour illustrer son idée, l’auteur cite tous les -ismes de la modernité : l’impressionnisme veut dépasser l’académisme, le futurisme le cubisme… Chaque artiste, chaque mouvement n’est qu’une étape entre deux avant-gardes. Ainsi, ce genre de postulats implique forcément ces paroles que nous avons tous entendues : « L’Histoire fera le tri ». Chacun sera le Van Gogh de demain : mal comprise, mal vendue, considérée comme vulgaire, son œuvre triomphera devant le Tribunal de l’Histoire de l’art.
Cependant, Olivennes défend à l’inverse la véritable création comme pouvoir de soustraire l’individu au temps, elle « délivre de l’histoire bien plus qu’elle n’indique son règne inflexible ». La Ronde de Nuit de Rembrandt n’exerce-t-elle pas un effet tout autre que la Fontaine de Duchamp ?
De plus, cette irréversibilité supposée de l’Art s’oppose aux faits : les Préraphaélites cherchent à retrouver cet aspect artisanal avant Raphaël, la Renaissance est un retour à l’Antiquité et la peinture de Bonnard ne peut s’inscrire dans aucun mouvement d’avant-garde.
Voulant supplanter la téléologie infernale moderne, Olivennes se fait le défenseur d’une histoire organique, où « chaque grand artiste est une singularité qui émerge de ses prédécesseurs puis s’individue : une histoire en forme de constellation ». Cette conception paradoxalement historiciste se révèle être celle de l’artiste génial du romantisme, dont le talent est soit chuchoté par les dieux, soit inné.
Olivennes défend à l’inverse la véritable création comme pouvoir de soustraire l’individu au temps, elle « délivre de l’histoire bien plus qu’elle n’indique son règne inflexible ».
Somme toute, ce narratif s’apparente à un récit dépeint « par les artistes eux-mêmes », très loin d’une route qu’il s’agirait de suivre sans rechigner : Par l’éloge d’Hopper, de Freud ou encore de Balthus, Olivennes conçoit l’art comme « un passage de flambeau », un héritage à faire fructifier. Ces artistes sont d’une certaine façon « anachroniques », dit-il, puisqu’ils s’inscrivent dans une tradition du Beau, tout en restant de leur temps. Or comment peut-on circonscrire celle-ci ?
A l’instar d’un Léon Bloy, pourfendeur d’un « art de saint-sulpice » dénué de grandeur, le philosophe n’est point laudatif concernant le kitsch ou le pompiérisme. En effet, le formalisme ne fait pas le grand artiste. Ici, l’auteur met plutôt à l’honneur « la beauté d’adulte » : « Il y a un chemin pour la beauté en peinture (…) pour une beauté qui incorpore en elle la laideur, la noirceur, la dureté ». Courbet plutôt que Gérôme, Spilliaert plutôt que Cabanel.
A rebours des « épate-bourgeois », ce sont les créateurs qui « bouleversent en silence », ceux qui prolongent l’immense chaîne des pères, de Rembrandt à Kiefer, de Poussin à Picasso qui nous émeuvent toujours. Surtout ceux qui s’accrochent à la référentialité, à savoir ceux qui créent sans faire l’impasse sur notre besoin de sens et d’évocation.
Après cette tentative de délinéation de ce qu’il nomme l’art underground, véritable classicisme occulté (délibérément ?) de Sam Szafran, Raymond Mason ou encore de Truphémus, Olivennes s’attarde sur l’art français. Une occasion pour lui de s’interroger sur la notion d’école nationale.
De l’art français
D’emblée, le philosophe cherche à esquiver d’éventuelles critiques de chauvinisme concernant sa recherche sur l’art français : « Même si j’avais cherché des artistes en France, je ne me préoccupais guère de leur « francité » ». Après s’être trouvé pris au dépourvu, Olivennes confesse avoir été frappé par des constantes au sein de notre production artistique.
Prenant pour appui les arts langagiers, l’auteur démontre aisément les particularités nationales qui différencient chaque artiste tout en constituant son humanité. Dostoïevski est profondément russe, Shakespeare profondément anglais mais leur ancrage n’empêche pas leur universalité.
Si les arts non langagiers semblent à première vue plus complexes à particulariser, Olivennes avance un point de vue contraire. Tout érudit en peinture peut distinguer un tableau français d’un tableau italien. Olivennes utilise un parallèle frappant : le tableau est peint comme s’il l’était « dans une langue – ou pour être plus exact dans un accent ». Par cela, l’amateur d’art fait ressurgir l’antique querelle entre les nominalistes et les réalistes : ceux-ci postulent qu’une chose existe lorsque nous la nommons, puisque tout est convention arbitraire. Ceux-là pensent au contraire qu’une essence des choses subsiste indépendamment des subjectivités. Loin d’être radical dans sa position, Olivennes se révèle comme un défenseur ardent d’un certain réalisme : l’art français existe comme tel, mais il s’est élaboré par une lente sédimentation à travers les âges.
« Jusqu’au XIXème siècle, déclare-t-il, la peinture française n’existe pas comme telle ». En effet, l’école française représentait alors un équilibre entre le Sud et le Nord de l’Europe. Elle était plus précisément une peinture qui regardait ailleurs, selon les mots de Pierre Rosenberg (La peinture française). David aime Raphaël, Delacroix copie Rubens..
Or, la création du Musée du Louvre pousse les peintres de l’Hexagone à se considérer comme les héritiers d’une longue tradition. Ainsi, la notion d’école nationale française commence à poindre avec les impressionnistes vers 1860. Aussi paradoxal que cela puisse être, c’est le classicisme qui représente la quintessence de l’art français aux yeux d’Auguste Renoir : « Il n’y a rien en dehors des classiques ». Quant à Manet, il proclame avec vigueur : « Il n’y en a qu’un ici, c’est Corot. Nous ne sommes rien, rien, près de lui ! ».
Cratyle plus qu’Hermogène, le philosophe postule une certaine épaisseur ontologique à la notion d’école nationale, que les étrangers ont affermi de par leur regard extérieur.
Source d’innovation et de renouveau, la tradition nationale n’est en rien un carcan académique qui briderait l’originalité des créateurs. Lorsque Cézanne peint « sur la sphère, le cône et le cylindre », n’est-il pas le successeur d’un Lorrain ou d’un Poussin ? Comme l’écrit Olivennes : « Cézanne, c’est le paysage et la nature morte devenus géométrie. C’est le classicisme, c’est l’architecture. Et c’est la France ». Cratyle plus qu’Hermogène, le philosophe postule une certaine épaisseur ontologique à la notion d’école nationale, que les étrangers ont affermi de par leur regard extérieur. Douce, claire, géométrique, pudique, amoureuse de la vie sur terre, des femmes et des choses simples de l’existence, rebelle à la métaphysique, la peinture classique française perdure malgré les diktats contemporains : Sam Szafran, Chiara Gaggiotti ou encore Avigdor Arikha continuent cette «possibilité de l’esprit ».
Enfin, l’auteur conclut sur ce qui semble être un défi lancé au nihilisme contemporain. En Occident, la mort de Dieu a laissé derrière elle un désenchantement du monde. Désacralisant aussi l’artiste, cette révolution a mené à la « déshumanisation de l’art » déplorée par Ortega y Gasset. Opposée à la disparition progressive de la forme de nos vies, la tradition artistique défendue par Olivennes réside dans « la confrontation entre les facultés créatrices de l’homme et la réalité », et dans le refus d’une histoire de l’art dictée par une instance surplombante. D’abord philosophique, cet essai questionne la pertinence de l’hégémonie d’une création purement cérébrale, la cosa mentale dont Duchamp reste le parangon. En effet, Olivennes vise avant tout à réhabiliter l’iconodulie occidentale, où l’essence se dévoile par les sens, à l’encontre de tout déterminisme rationaliste.
Insolent mais pertinent, cet essai restera dans les mémoires comme un vibrant plaidoyer en faveur de l’art éternel.
















