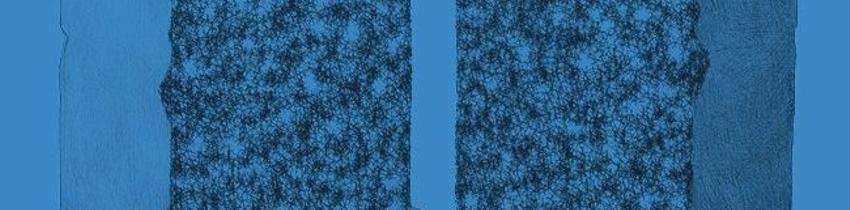Une généalogie du Je par le lieu
On pourrait dire que la prose d’Olivia Resenterra est celle de la matérialité du territoire ; la même qui constitue la spécificité des perceptions exacerbées de l’enfance : pas encore réflexives, mais avides, observatrices et comme fascinées devant les choses. Il y a une généalogie du « Je » par le lieu ; mais le lieu déborde toujours cette finalité définitionnelle, et est à lui-même, en tant qu’élément pris dans un processus naturel de dégradation, son propre objet littéraire :
« Avant la ruine, la noble ruine, la blancheur lisse des fossiles, il y a la décrépitude, ce processus patient et dérisoire qui ne laisse aucun doute sur son issue, qui, malgré tous nos efforts de lessivage, mêle la moisissure pulvérulente aux souvenirs. »
La vie propre du lieu, son mouvement de corruption spontanée, a toujours une temporalité plus ample que celle de l’histoire familiale, qui s’y inscrit passagèrement :
« Quand j’étais enfant, une grande peinture à l’huile représentant des vaches au pâturage était accrochée dans ce hall. Elle me semblait étrange dans cette maison, où les reproductions d’images pieuses et les travaux d’aiguille avaient plus droit de cité, en matière de décoration, que les tableaux. […] Désormais, le petit hall est nu. Des cloques éparses le long des murs révèlent la prolifération du salpêtre qui fait se boursoufler et éclater la peinture blanche d’une simple pression du doigt. »
L’un des objets dominants du texte est alors cette temporalité propre du lieu, qui est, en quelque sorte, impersonnelle, indifférente à la vie humaine. Au-delà du Je, au-delà de l’histoire collective elle-même.
Le lieu demeure insaisissablecomme l’objet du désir de voir échappe au voyeur
La littérature d’Olivia Resenterra est de celles qui sont capables de décrire un mystère sans le percer.
La littérature d’Olivia Resenterra est de celles qui sont capables de décrire un mystère sans le percer. L’exemple le plus saillant qui me vient à l’esprit est celui du personnage de Coleman Silk dans La Tache de Philip Roth, dont l’opacité est entière à la fin du récit, inaliénable, comme si le roman lui-même avait manqué sa cible, et que lui survivait l’aura du personnage. Dans Le Mur de l’Atlantique, ce qui survit, c’est l’aura du lieu. Les mots racontent sans démystifier, quoique la prose prenne souvent l’allure d’une enquête. L’enquête n’épuise pas l’objet mais lui donne, au contraire, un surcroît de réalité. Il en va ici comme des silences et des ellipses dans les récits d’Aharon Appelfeld, là où un excès de discours falsifierait l’objet et échouerait à lui être fidèle. « Tout ce qui ressortait » de l’effort de rapporter, par des commentaires exhaustifs, les épreuves les plus douloureuses, écrit Appelfeld dans L’Histoire d’une vie, « était un magma de mots, ou plus précisément des mots inexacts, un rythme faussé, des images faibles ou exagérées. Une épreuve profonde, ai-je appris, peut être faussée facilement ». Appelfeld écrit avec la conscience de ce que les mots manquent nécessairement ; la matière de son écriture n’est pas moins le silence que le verbe : « avec le même sens que celui des aveugles, j’ai compris que dans ce silence était cachée mon âme et que, si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me reviendrait ». Il y a un silence semblable du « Je » dans Le Mur de l’Atlantique, qui laisse place aux « faits bruts » de Sartre, ceux qui apparaissent dans leur radicale extériorité lorsqu’aucune conscience humaine n’y projette ses propres qualités. La perspective est quasiment a-subjective – une contradiction dans les termes : elle ne saurait être désincarnée, mais elle est toujours dépassée par l’imposante et énigmatique matérialité de son objet :
« Dans ce vaste programme de restauration et d’embellissement des monuments du littoral, les blockhaus et batteries en béton armé des plages royannaises, vestiges du Mur de l’Atlantique voulu par l’occupant allemand lors de la Seconde Guerre mondiale, ont toujours suscité un sentiment de malaise chez les baigneurs et promeneurs. Ils semblent n’avoir rien d’autre à offrir que leurs masses aveugles et bancales s’enlisant toujours plus profondément dans le sable. On leur en a toujours voulu d’être aussi récents, de suinter sous un soleil éclatant, au milieu des corps dénudés et des parasols aux couleurs vives, les souvenirs de l’enfermement, la peur, l’ennui et l’épuisement. Parfois, un petit vacancier, un enfant comme nous l’avons été, s’immobilise, fasciné, devant l’un de ces blocs et fixe l’ouverture dans laquelle, à marée montante, des vagues s’engouffrent, tournoient et dégorgent en bouillonnant. Des adultes l’appellent, lui ordonnent de ne pas trop s’approcher. Mais qu’y a-t-il au fond de cette grande bouche sombre qu’il ne sache déjà ? »
On pourrait dire que Le Mur de l’Atlantique rapporte finalement l’ambivalence qualitative des vécus sensoriels et perceptifs de l’enfance.
À la fin du parcours, pourtant, c’est bien une mélodie de l’enfance qui, projetée sur l’étendue du paysage, semble le rendre pour une fois de façon immanente, les souvenirs rejaillissant d’eux-mêmes, sans plus être déduits d’indices extérieurs ou de détours historiques. On pourrait dire que Le Mur de l’Atlantique rapporte finalement l’ambivalence qualitative des vécus sensoriels et perceptifs de l’enfance. D’une part, les choses et les êtres les saturaient toujours, par ce surcroît de réalité que j’ai évoqué, qui les rendait inassimilables et fascinants – toujours premiers sur la conscience. D’autre part, ces sensations, quoique leur objet fût mystérieux, ébranlaient le corps et les sens avec une intensité que nous ne pouvons que jouer à nous rappeler. Le roman convoque constamment ce mélange troublant d’intensité – là où le vécu corporel se confond avec l’existence, comme si le « Je » était la somme des sensations produites par le milieu –, et d’étrangeté – là où le milieu résiste à toute saisie empirique, étant incommensurable avec toute vie subjective limitée, et même avec toute temporalité historique. Une sorte de voyeurisme narratif redouble la pulsion scopique de l’enfant – le désir de l’auteur de revoir l’enfance restitue le désir de voir de l’enfant, dont l’objet demeure, par essence, indéterminé :
« Je finis par tourner en rond dans la maison. Au bout d’un moment, mon père me demande si j’ai vu ce que je voulais voir. J’acquiesce, même si, en réalité, je ne sais même pas ce que je suis venue voir ni ce que je suis venue chercher. Sans un mot, nous refermons les volets, puis les portes, les unes après les autres, derrière nous. »
- Le mur de l’Atlantique, Olivia Resenterra, éditions du Rocher, 2023.