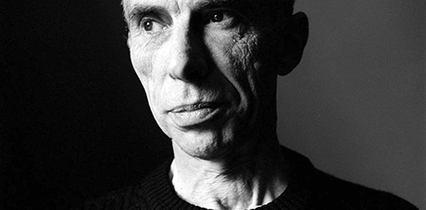Le nouvel essai de Pierre Bouretz, Lumières du Moyen-Âge entend réhabiliter la pensée juive et arabe médiévale et ainsi destituer l’idée qui veut que l’Europe ait assumé la destination universelle de l’humanité, notamment et essentiellement à travers son double héritage hellénique et chrétien, qui aurait abouti aux Lumières. Un ouvrage indispensable en ces temps délétères.

La réconciliation de la foi et de la raison
Si Bouretz privilégie la figure de Maïmonide au détriment d’autres philosophes (même si Farabi est longuement évoqué, et Averroes et Avicenne souvent cités), c’est qu’il a formulé très clairement le problème théologico-philosophique, dans un ouvrage qui est au cœur de l’étude proposée par Bouretz, à savoir le Guide des perplexes – c’est même la notion de perplexité qui cristallise, selon Bouretz, le problème théologico-politique. En effet, la perplexité désigne chez Maïmonide cette contradiction qui s’empare de l’homme confronté à l’apparente incompatibilité entre la philosophie et la théologie, de l’homme « qui a étudié la philosophie et qui a acquis des sciences véritables, mais qui, croyant aux choses de la Loi, est perplexe au sujet de leur sens ».
Selon Bouretz, tout l’enjeu de la philosophie médiévale arabe et juive consiste donc à résoudre le problème théologico-politique. Mais, avant la résolution du problème en tant que telle, c’est la question du statut du discours qui pose problème : en somme, comment faire de la philosophie en des temps de sectarisme ?
Comment faire de la philosophie alors que sévit le sectarisme religieux ?
Le contexte est en effet celui d’un rejet de la philosophie, d’une époque où sont apparus « des rois qui protègent la religion », qui établissent des « propositions profitables pour leur croyance » et réfutent « les opinions qui renversaient les bases de leur religion ». Farabi quant à lui affirme que la philosophie et les philosophes étaient en « grave danger ». La thèse de Léo Strauss à ce propos est de considérer que les philosophes médiévaux ont élaboré un « art d’écrire » ésotérique en réponse à la censure et à la « persécution » – thèse, on le voit, essentiellement négative. Selon Bouretz, au contraire, les philosophes ont tenté de surmonter le sectarisme en élaborant un art de la dialectique et du discours qui ne soit pas un repli dans l’ésotérisme et dans un sectarisme philosophique, mais qui permette de convaincre même « les commençants qui n’ont encore fait aucune étude spéculative » (Guide des perplexes). Tout le problème est donc celui de l’élaboration d’une « philosophie populaire », qui n’oppose pas la philosophie et la théologie, mais mette la religion au service de la philosophie.
La philosophie, politique par nature ?

Bouretz s’attarde alors sur les affirmations philosophiques de Fârâbi : « Nous autres philosophes sommes politiques par nature » en sorte qu’ « il nous incombe de vivre en harmonie avec le vulgaire, de l��’aimer et de préférer agir ainsi qu’il lui est profitable. Il nous revient d’améliorer sa condition, tout de même que la même chose lui incombe à notre égard. Nous devons l’associer à la jouissance des biens dont la garde nous est confiée, lui faire percevoir la vérité dans les opinions qui appartiennent à ses religions ». La consubstantialité de la philosophie et de la politique est une thèse que Fârâbi emprunte à Platon et à sa République – thèse selon laquelle « pour être un philosophe véritablement parfait, il faut posséder à la fois les sciences théoriques et la faculté de les utiliser pour le bien de tous les autres selon leurs capacités » ; « Celui qui acquiert les sciences théoriques sans avoir atteint la perfection la plus haute qui lui permettrait de transmettre aux autres ce qu’il connaît selon leur capacité » ; « La philosophie doit nécessairement advenir en chaque homme à la manière qui lui est possible ».
Mais tout le problème d’une philosophie populaire et politique consiste précisément dans la question de l’éducation – ce problème devient crucial lorsqu’il est reconduit à son dénouement classique, devenu un véritable leitmotiv chez les médiévaux : la mort de Socrate. Dans l’allégorie de la caverne, Platon évoque le drame de la philosophie, l’apparente inconciliabilité de la philosophie et de la politique. Le philosophe, qui a contemplé le Bien, ne souhaite pas revenir dans la caverne : il ne « consent pas à s’adonner aux affaires des hommes » mais son âme « n’éprouve toujours d’attirance que pour ce qui est en haut » (517 d-e) ; « [Être] forcé, devant les tribunaux ou dans quelque autre lieu, de polémiquer au sujet des ombres de ce qui est juste, ou encore des figurines dont ce sont les ombres, et d’entrer en compétition sur la question de savoir comment ces choses peuvent être comprises par ceux qui n’ont jamais vu la justice elle-même » (517 d-e). Mais, selon Platon, « nous ne serons pas injustes à l’endroit de ceux qui chez nous deviennent philosophes, mais nous leur tiendrons un discours juste en les contraignant, en plus du reste, à se soucier des autres et à les garder » (520 a-d).
Selon Platon, la relation entre philosophie et politique est condamnée, puisqu’elle est entachée de la mort de Socrate
Cependant, on sait le dénouement fatal d’une telle confrontation de la philosophie et du politique – la mort de Socrate : « Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les conduire en haut, s’ils avaient le pouvoir de s’emparer de lui de quelque façon et de le tuer, ne le tueraient-ils pas. – Si, absolument » (517a).
Comment surmonter dès lors l’écart entre la philosophie et le vulgaire ? C’est ici que Fârâbi enrichit la thèse platonicienne d’une cosubstantialité du philosophique et du politique d’une théorie du langage – et plus précisément de la dialectique – héritée d’Aristote. Cette « réinterprétation politique » de la dialectique aristotélicienne est explicite : « Il nous incombe de détourner le vulgaire des arguments, des opinions et des lois dans lesquels nous voyons bien qu’il n’atteint pas la vérité » en l’associant « à la garde des biens qui nous sont confiés » afin de lui « faire percevoir la vérité dans les opinions qui appartiennent à ses religions ». Comment faire ? Selon Bouretz, toute la logique de l’éducation déployée par les philosophes arabes et juifs du Moyen-Âge, à travers la réappropriation de l’héritage philosophique grec, consiste en l’élaboration d’une pédagogie gradualiste : « Tout cela, écrit Fârâbî à propos des Topiques d’Aristote, il n’est pas possible de le faire avec des démonstrations certaines, car celles-ci [le vulgaire] ne peut les comprendre ; elles lui paraissent étranges et lui sont difficiles. Cela n’est possible qu’en utilisant les connaissances que nous partageons avec lui, c’est-à-dire en s’adressant à lui avec des arguments qui sont chez lui généralement acceptés, qu’il connaît bien et reçoit bien. De ce genre d’enseignement naît la philosophie répandue, que l’on appelle philosophie populaire (hariga) et publique (barraniyya) » ; « Le présent traité se propose de trouver une méthode qui nous rendra capables de raisonner déductivement en prenant appui sur les idées admises » . Il faut donc opposer « démonstration » et « déduction dialectique » : les secondes s’appuient sur des « idées généralement admises », c’est-à-dire en grec endoxa.
La philosophie populaire de Fârâbî

Cependant, Bouretz note de manière très fine une différence entre les deux approches, celle d’Aristote et celle de Fârâbî commentant Aristote. Selon Aristote, les endoxa sont de plusieurs sortes : « Les opinions partagées par tous les hommes, ou par presque tous, ou par ceux qui représentent l’opinion éclairée et, pour ces derniers, par tous, par presque tous, ou par les plus connus et les mieux admis comme autorités » (100 b 21-23). Selon Fârâbî, il y en a seulement deux sortes : « L’opinion à laquelle nous accordons confiance lorsqu’il s’agit d’objets intelligibles est tantôt celle d’un homme ou d’un groupe, c’est l’opinion reçue (maqbul), tantôt celle de tous les hommes et c’est alors l’opinion communément admise (mashur) » (p. 36). La dialectique authentique repose sur l’endoxa comme mashur, tandis que les discussions reposant sur des maqbul appartiennent à la sophistique et à la rhétorique. Selon Bouretz, une telle réappropriation de la théorie du langage aristotélicienne par Fârâbî est essentiellement politique : « Le travail sur la notion même d’endoxa isolait pour l’exclure de la dialectique une « opinion reçue » qui semblerait aisément façonnée par les croyances religieuses » (p. 40) ; « Le théologien se contente de valider les choses théoriques du point de vue de ce qui est commun selon une opinion non-examinée » (p. 46), et qui désigne, selon Bouretz, l’exercice du kalam, « entendu comme stricte « défense » de la doctrine religieuse » (p. 46).
On peut donc résumer le projet pédagogique de Fârâbî ainsi : transformer les opinions reçues (maqbul) en opinion communément admise (mashur), afin d’en faire le point de départ d’une éducation dialectique, qui permette de se réapproprier philosophiquement le contenu de la religion
On peut donc résumer le projet pédagogique de Fârâbî ainsi : transformer les opinions reçues (maqbul) en opinion communément admise (mashur), afin d’en faire le point de départ d’une éducation dialectique, qui permette de se réapproprier philosophiquement le contenu de la religion. On voit donc qu’il ne s’agit pas de prime abord de nier la religion, mais bien plutôt de concilier le discours théologique avec les finalités philosophiques : « Il reste que le lecteur philosophe devra conserver cette idée et prendre au sérieux l’introduction d’une forme d’instruction combinant compréhension [c’est-à-dire la méthode proprement philosophique, démonstrative] et assentiment [c’est-à-dire la méthode dialectique] d’une manière qui n’est ni celle de la religion, ni celle de la philosophie proprement dites : « Si les intelligibles eux-mêmes [c’est-à-dire les objets de la philosophie en tant que telle] sont adoptés et que l’on emploie des voies persuasives pour cela, alors la religion qui les contient est appelée philosophie « populaire », « généralement acceptée », et « extérieure » » (p. 42). Le projet pédagogique et politique de Fârâbî consiste donc à faire des endoxa « l’objet d’une dialectique dont le commentateur explique qu’elle est l’instrument grâce auquel le philosophe peut et doit s’adresser au vulgaire afin de l’élever par degrés vers la vérité » (p. 43). C’est pourquoi Fârâbî peut conclure que « La religion est une imitation de la philosophie » (p. 41). La religion a donc une dignité propre, dignité proprement pédagogique : « [la religion] acquiert une dignité ou une noblesse à tout le moins pratiques et liées à cela qu’elle contribue authentiquement à la popularisation d’objets spéculatifs, même si ce n’est qu’au moyen d’images et par le biais de procédés d’argumentation inférieurs à celui de la démonstration » (p. 45). L’art dialectique, c’est-à-dire l’art pédagogique, se confond avec le projet d’une « philosophie populaire », « qui peut maintenant se définir comme un art d’examiner les propositions ambivalentes de la religion afin d’en dégager la part de vérité spéculative et de la dévoiler progressivement au plus grand nombre » (p. 47).
La grande subtilité de Fârâbi se mesure donc à la synthèse tout à fait originale qu’il propose de la pensée platonicienne et de la pensée aristotélicienne : de la première, il retient l’intention proprement politique ; de la seconde, il retient l’orientation pédagogique. Cette réappropriation du corpus antique se résume selon Fârâbî : « Quant au mythe de Platon, qu’il a placé dans son livre sur la République, au sujet de la caverne, décrivant comment l’homme en sort puis y rentre, il est tout à fait en accord avec l’ordre qu’Aristote a posé pour les parties de l’art de la logique » (p. 47). Bouretz commente : « Grâce à cette analogie séduisante Fârâbî se livre à un travail de reconstruction en quelque sorte architectonique de l’Organon : le mouvement ascendant est celui qui débute avec les Catégories, se poursuit au travers du traité sur l’interprétation puis des Premiers analytiques et culmine dans les Seconds ; la descente commence au travers des Topiques et s’accentue avec les Réfutations sophistiques qui bornent le corpus dans sa forme classique. La raison est désormais claire pour laquelle Fârâbî élargit ce dernier afin d’inclure la Rhétorique et la Poétique : ces deux livres doivent être pris en compte pour autant qu’ils fournissent des moyens spécifiques de provoquer l’assentiment » (p. 47).
Au terme de ce premier aperçu du projet philosophique du Moyen-Âge arabe et juif, il convient de souligner que Bouretz enrichit et dépasse tout à la fois la thèse classique de Léo Strauss.
Au terme de ce premier aperçu du projet philosophique du Moyen-Âge arabe et juif, il convient de souligner que Bouretz enrichit et dépasse tout à la fois la thèse classique de Léo Strauss. Pour Strauss, en effet, la philosophie arabe est ésotérique parce qu’elle cherche à dissimuler ses intentions à la religion (il s’agit donc d’un projet d’écriture négatif : la dissimulation) ; pour Bouretz, au contraire, si la philosophie arabe a recours à la fois à des images théologiques et à des énoncés philosophiques, c’est qu’elle développe une pédagogie gradualiste. A ce titre, Fârâbî incarne une figure exemplaire du projet de philosophie populaire : « Tout porte donc à penser que Fârâbî offre une image originale du philosophe, dans un moment et un espace longtemps ignorés des histoires philosophiques modernes de la philosophie » (p. 49).
Le fusil à deux coups de Bourretz
L’enjeu de cet ouvrage est double : il questionne notre époque 1) d’une part en tant que celle-ci s’orientant toujours davantage vers une compréhension « civilisationnelle » d’elle-même (le fameux thème de la « guerre de civilisations » – mais qu’est-ce que cela signifie exactement qu’une « civilisation » ?) ne cesse d’accentuer les différences culturelles, en sorte de les opposer et, peut-être surtout, de les hiérarchiser : selon le préjugé hégélien (dont se revendique aujourd’hui Onfray dans sa « philosophie de l’histoire » morphologique – inutile de dire que cette réduction de Hegel à la théorie morphologique de Spencer ne fait précisément aucun sens quant à ce que Hegel lui-même entendait par « histoire ») que nous évoquions au début de notre article, qui veut que l’Europe ait assumée la destination universelle de l’humanité, notamment et essentiellement à travers son double héritage hellénique et chrétien, qui aurait abouti aux Lumières. Bouretz propose ici de corriger cette image biaisée de la pensée, qui privilégie l’Europe et l’époque moderne, et rappelle que les « Lumières » ne sont pas d’aujourd’hui – mais qu’il existe des « Lumières du Moyen-Âge ». Par ailleurs, cette première blessure narcissique s’accompagne d’une seconde, qui destitue l’Europe de son exclusivité philosophique – comme s’il n’y avait eu de la pensée qu’en elle !
Bouretz propose ici de corriger cette image biaisée de la pensée, qui privilégie l’Europe et l’époque moderne, et rappelle que les « Lumières » ne sont pas d’aujourd’hui – mais qu’il existe des « Lumières du Moyen-Âge ».
2) Un enjeu plus directement politique, qui concerne le sens de l’image dans les sociétés contemporaines – et qui nous invite à déplacer la question théologico-philosophique sur un autre plan : quelle est notre perplexité à nous ? En quoi sommes-nous, en quelque manière, nous aussi des perplexes ? Et comment pourrait-il nous être permis à nous aussi de sortir de cette perplexité ? Notre question n’est plus la question théologico-philosophique, mais la question médiatico-philosophique et que ce problème radicalement nouveau nécessite une réforme de la philosophie. Ce qu’explique Bouretz, c’est que le rôle de la religion pour ces penseurs des Lumières du Moyen-Âge était de rendre accessibles, c’est-à-dire sensibles (imagées), les concepts philosophiques (seulement intelligibles) – autrement dit, de représenter la pensée de telle sorte que chacun puisse n’en être pas exclu. Mais il s’avère que notre époque est ce temps paradoxal où la représentation ne représente plus qu’elle-même, où l’image ne réfère plus à son sens philosophique, mais simplement à elle-même : l’image ne donne plus accès à la philosophie, mais, bien au contraire, elle en barre l’accès. C’est ce qui apparaît si l’on considère un instant que ce qu’autrefois on appelait par exemple « devises » ne sont plus aujourd’hui, la plupart du temps, que des slogans. Face à ce privilège de l’image, il faut redonner son poids à la pensée, quitte à la séparer radicalement de l’image qui est censée la représenter : il n’est peut-être plus temps pour la philosophie de se battre sur le terrain des images (ne parle-t-on pas de la « guerre des images » que se livrent les médias ?) car il se pourrait bien que dans ce genre de lutte, elle ait toujours déjà perdu. Mais cela ne signifie nullement qu’il faille que la philosophie abandonne son destin politique et populaire : mais bien plutôt, peut-être, que le destin politique et populaire de notre temps soit philosophique.
- Lumières du Moyen-Âge, Pierre Bouretz, NRF essais, Gallimard, 960 pages, 34 euros, 10 septembre 2015.