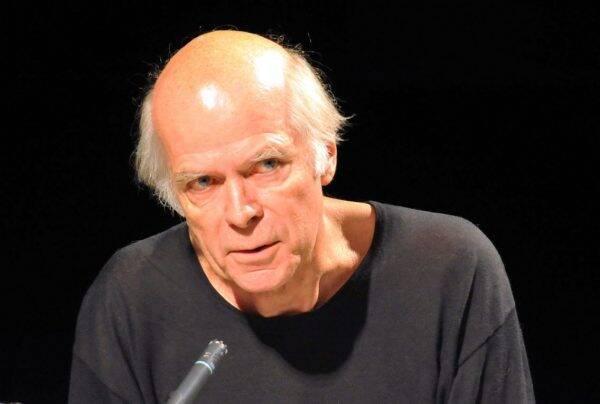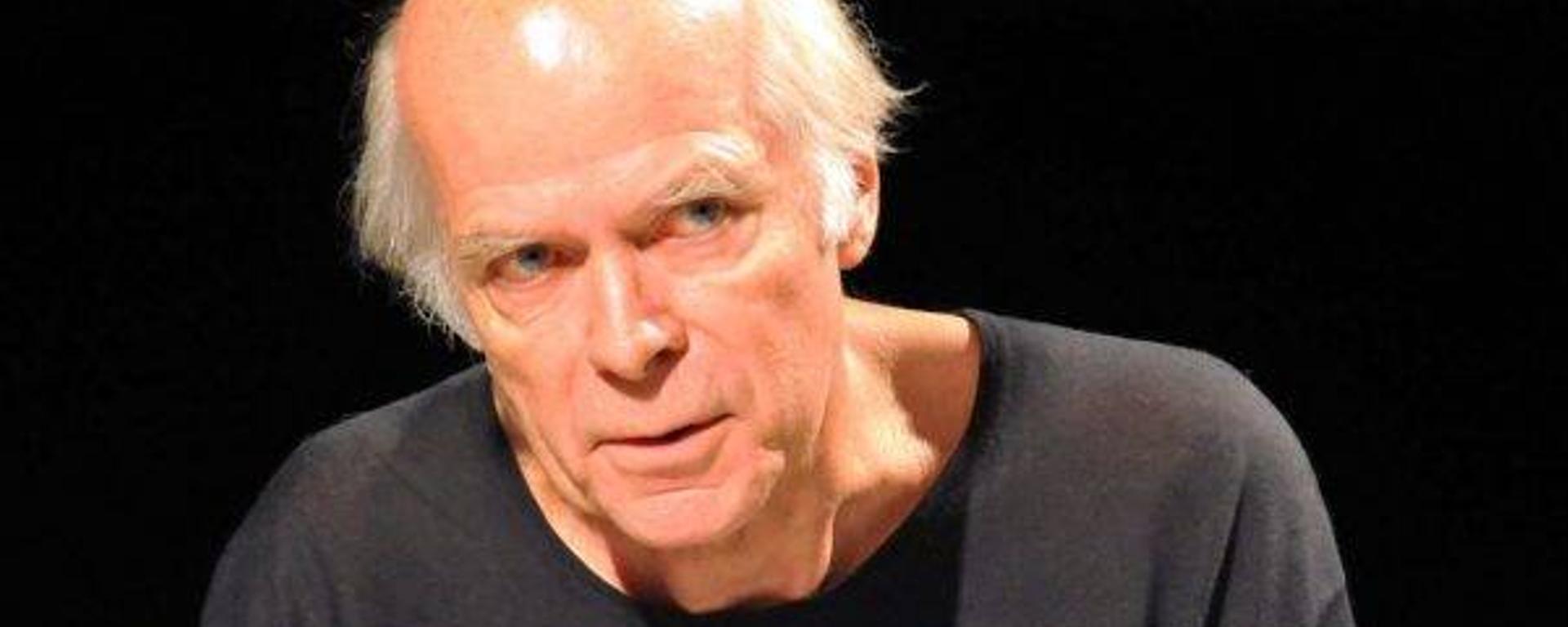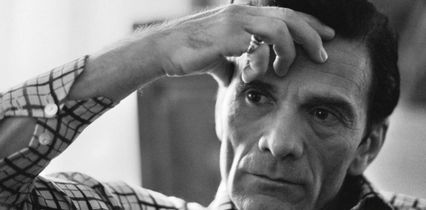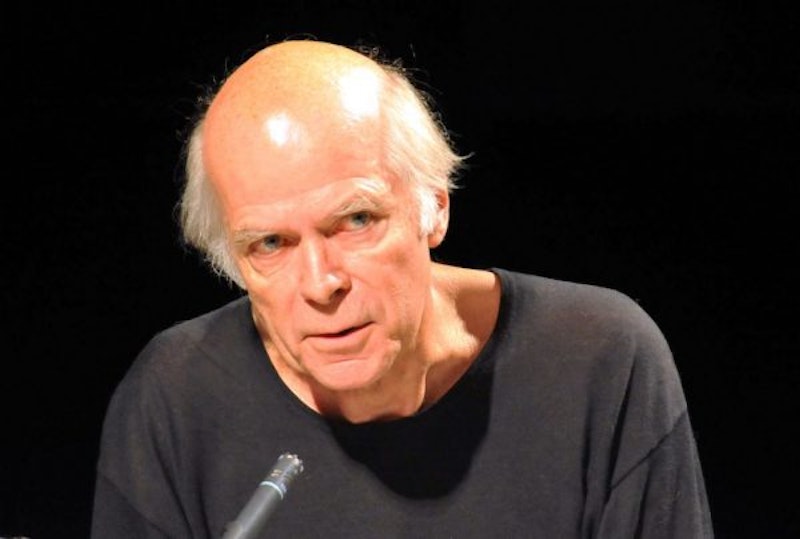

« Hélas le malheur projette un charme sur ceux qui y ont survécu qui les rend invulnérables. […] La haine est une carapace, une plume sublime, une fourrure. Comme elle les rend indifférents, et même enthousiastes, à l’égard de ceux qui souffrent à leur tour. Elle les sauve de l’humanité. Mais est-ce une rédemption ? »
C’est, en quelques mots, une réalité impalpable que Quignard circonscrit, avec précision, élégance, finesse. La réflexion est ouverte et ne se complait pas en de plates redites de ce que nous savons déjà, mais inquiète au contraire nos certitudes les plus établies, en sape les fondements pour nous laisser face à des perspectives que nous n’avions jusqu’alors jamais envisagées.
Fiction et réalité : le délicat ménage
Cette peinture du XVIIe siècle est également portée par le jeu des références tissées dans le roman. Outre les références à d’anciens personnages, comme Meaume le graveur, ou bien le musicien de Sainte-Colombe (lui-même inspiré d’une figure bien réelle) qui côtoient les nouveaux, des noms de philosophes, de peintres, de musiciens connus du lecteur, ponctuent ces pages, aux détours desquelles tous se croisent parfois. Ainsi, sur un tableau du peintre bien réel Jan Baptist Bonnecroy (Bonne-croix dans le roman), on devrait pouvoir reconnaître Thullyn, élève de Sainte-Colombe et nouveau personnage introduit par Quignard. Cependant, cette référentialité peut par moment appesantir le rythme du roman, et s’il est bien une chose que prouve la lecture de L’amour la mer, c’est la certitude que la fiction est toujours bien plus suggestive et prompte à rendre compte d’une atmosphère, que le réel. La prépondérance du style descriptif du texte rendait, de fait, impératif de fonder son esthétique sur la fiction, puisque ce n’est pas la description de ce qu’il connaît déjà hors-texte qui intéresse le lecteur, mais bien au contraire la capacité de l’auteur à inventer, à tisser dans le langage un monde neuf et imprévu. Parce qu’elle travaille de trop près le réel, la description, dans L’amour la mer, prend le risque de s’y confondre et de perdre l’atmosphère onirique et magique qu’elle a été pourtant parfois capable de mettre magistralement en scène.
Certains passages emportent et laissent le lecteur suspendu aux mots de l’auteur, tandis que d’autres peinent davantage à susciter l’engouement.
Cette critique, que l’on peut adresser à l’ouvrage, rejoint ici celle qu’il est possible de faire à l’usage du fragment pour introduire diverses réflexions, qui relèvent de l’essai ou de la maxime. On est déçu, lorsque l’on connaît la capacité de l’auteur à produire des réflexions d’une complexité, d’une beauté – littéraire et théorique – époustouflantes, de la simplicité parfois presque banale de certaines vérités dont il ponctue son texte. Entrecoupant une intrigue talentueusement décousue, ces fragments réflexifs ne semblaient pas tous essentiels à l’économie globale de l’œuvre, si bien que c’est malheureusement une impression de contingence qui frappe le lecteur. Là où l’on aimerait que chaque fragment, que chaque mot trouve sa nécessité dans les précédents et les suivants – ce qui est parfois le cas, comme nous le relevions plus tôt – il est en réalité compliqué de déceler, dans cette partition du texte en maximes, une unité qui fasse du roman un tout que l’on puisse aimer ou rejeter d’un bloc. Certains passages emportent et laissent le lecteur suspendu aux mots de l’auteur, tandis que d’autres peinent davantage à susciter l’engouement. Si l’on saisit parfaitement l’intention de détachement, de simplicité et de fragmentation que l’auteur a désiré mettre en scène dans son œuvre, il est plus complexe de la ressentir, de l’éprouver et lui donner pleinement son suffrage.
Intention et réalisation
L’amour la mer demeure à l’état d’intention, une intention qui n’est pas pleinement réalisée ; le livre est bon, il est beau, mais il n’est pas magique.
En effet, tout le problème de L’amour la mer tient à ce qu’il sait trop ce qu’il veut nous dire, mais ne nous le montre pas. Le livre est plus que bon ; par le style, par le travail colossal, qui mérite tout le respect qu’il est possible d’offrir à une création, il se tient et se dresse avec dignité, il maintient tout au long des pages l’onirisme envoutant que l’on connaît à la littérature de Quignard. Cependant, c’est la question de la nécessité d’un tel livre, et de l’équivoque entre l’intention et la réalisation qui se pose lorsque l’on achève sa lecture. Si chaque page de Tous les matins du monde attire la suivante et appelle une suite, c’est qu’une nécessité tisse de l’intérieur la courte nouvelle et nous la livre comme une pièce brodée d’un unique fil, reproduisant une évidente figure que tout en nous brûlait de reconnaître, que nous avions sans le savoir toujours attendue. Or, c’est peut-être là ce qui différencie le très bon livre du chef-d’œuvre ; cette nécessité qui, d’une simple intention, fait une création achevée, animée de toute la texture et la vérité d’un monde nouveau offert au lecteur ébloui. L’amour la mer demeure cependant à l’état d’intention, une intention qui n’est pas pleinement réalisée ; le livre est bon, il est beau, mais il n’est pas magique. On pourrait s’étonner d’une telle critique : si le roman est un bon roman, pourquoi lui en demander davantage ? Une réponse s’impose – au nom de ce que mérite la littérature aujourd’hui, et de ce que peuvent des auteurs comme Quignard, lorsque l’on sait les merveilles que sont Tous les matins du monde, Vie secrète, ou même, sur un versant davantage théorique, Le sexe et l’effroi.
Au nom du talent que l’on connaît à notre auteur, il est possible de désirer et d’espérer des œuvres qui, plus que de revendiquer des intentions, les incarnent, les portent au-devant de nos yeux et de nos cœurs ; c’est ce que nous souhaitons pour les romans à venir, qui, nous le souhaitons avec la même vigueur, seront nombreux. Ce roman dépasse de loin ce que l’on peut voir sur la scène littéraire actuelle ; et il se démarque, encore une fois, par cette atmosphère onirique et baroque, répandue entre les pages, dont Quignard a le secret. Nous nous permettons simplement, par cette lecture critique, d’adresser à l’auteur de ce beau texte un vœu, le vœu que les choses n’en restent pas là, et qu’il nous promette déjà de nouvelles et vibrantes créations qui détruirons les intentions pour bâtir sur leurs ruines un chef-d’œuvre de chair et de mots.
- Pascal Quignard, L’amour la mer, Gallimard, janvier 2022