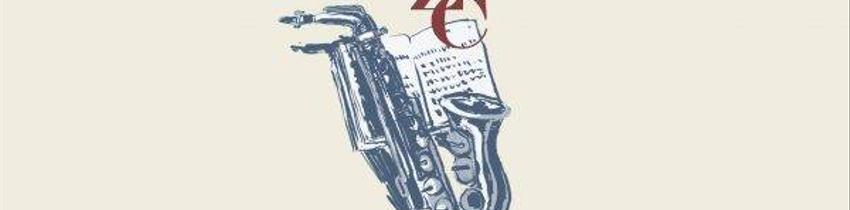Je ne crois qu’en moi est l’affirmation sobrement choisie par la critique Murielle Joudet afin de donner un titre à son livre d’entretien avec la cinéaste et romancière Catherine Breillat. Publié aux éditions Capricci, il accompagne la sortie de L’Été dernier (2023), fiction transgressive à l’image d’une filmographie qui illustre la complexité féminine d’une quête identitaire qui passe par la sexualité. Rencontre avec Catherine Breillat.

Je n’appellerais pas ça du désir. J’ai une nouvelle théorie après ces heures d’entretien avec Murielle. Je ne parle pas réellement du désir féminin mais de l’entité sexuelle féminine. Je ne sais pas si les femmes désirent les hommes, elles désirent être désirées. C’est différent et plus secret. Et effectivement il y a la honte et le déni qui peuvent s’y glisser tant que l’on n’a pas une entité sexuelle autre que celle que l’on vous a imprimée au fer rouge. On ne s’en dégage jamais tout à fait. Le monde a absolument tout faux en voyant le sexe et la sexualité sous l’égide de la morale, du moralisme et de la bienséance. Les vertueux s’engagent toujours dans une morale pseudo-religieuse. Il y a une chose qu’ils ne disent jamais : le désir de la jouissance c’est de la pensée en marche. C’est cela qui fait que l’on transfigure dans sa tête un acte sexuel morne et répétitif en quelque chose qui peut vous amener à une extase et à une idée d’éternité, d’exultation de l’âme.
Précisément, vous ne filmez pas le désir féminin mais une transcendance.
Oui, c’est trivial. Ça marche un peu mais c’est vite ennuyeux. Même du côté de la dégradation volontaire. Ça marche une fois, deux fois, mais ça ne va pas très loin. Après ce sont des perversions requises, on en a marre. On sait faire, on l’a déjà fait.
À partir du moment où c’est mis en acte, où ça s’est concrétisé, on n’est plus dans l’idée.
L’amour est purement imaginaire mais nécessaire à la survie de l’espèce.
Il y a une exaltation amoureuse, ce qu’on appelle la fusion charnelle, qui existe mais cela existe dans l’abstraction de la pensée qui lui permet d’exister. Pourquoi ? Car le propre de l’homme c’est « je pense donc je suis ». Maintenant on pourrait dire : « je désire donc je suis ». La survie de l’espèce passe par le désir. Quand les femelles ont des chaleurs, elles choisissent le mâle pour la survie de l’espèce, celui qui sera le plus valeureux. Elles ne choisissent pas dans les sentiments et dans une espèce de langage amoureux qui est purement imaginaire. Le fait de tomber amoureux c’est un fantasme, ça n’a rien de réaliste et pourtant c’est très très fort. La survie de l’espèce humaine passe par notre propension à imaginer un rapport amoureux. L’amour est purement imaginaire mais nécessaire à la survie de l’espèce. C’est complètement physiologique, c’est essentiel. Donc tout le monde se trompe sur la morale.
On voit dans vos films que vous détestez la morale.
Le moralisme, c’est très différent. Je pense que le cinéma est un art moral. Il ne faut pas le confondre avec le moralisme.
Pourquoi un art moral ?
Parce que le cinéma est intègre. C’est le discours que j’ai fait en Iran, j’ai affirmé que le cinéma était un art moral (Conférence internationale sur la présence de la femme dans le cinéma contemporain, Téhéran, février 1997). Le sujet du colloque était « Place de la femme dans le cinéma, utilisation du corps de la femme dans le cinéma ». On voit bien quelle est la réponse. Toutes les féministes doivent s’insurger.
Ça c’est une grille de lecture qui est dans l’air du temps mais qui n’est pas celle de tout cinéphile, de tout réalisateur. Vous parlez ici d’un rapport idéologique au cinéma tandis que vous, comme vous l’expliquez dans le livre d’entretien, vous cherchez l’idéalisme.
Quand on vient faire ce discours à la télévision iranienne avec les gardiens de la révolution c’est quand même de l’idéalisme. J’estime qu’il faut se battre, ça a un sens éthique. On a besoin de croire à des choses grandes. Le sentiment amoureux est un idéal. Autrement, on n’est que des ventres.
L’amour pour vous c’est uniquement idéaliste, ça ne peut pas exister en dehors de cet idéal ?
C’est imaginaire en tout cas, ça passe par de la pensée. Donc ça n’a rien de concret, ça n’a aucune existence scientifique mais c’est une exaltation qui s’empare de vous et contre laquelle on ne peut rien. À quoi ça tient quand on tombe amoureux ? Quand on ne l’est plus on voit bien que ça ne tenait à rien. La personne dont on n’est plus amoureux devient une pauvre petite chose sans intérêt or on aurait presque donné sa vie pour cette personne. C’est très beau. Ça fait de la littérature, de l’art, plein de choses mais ce n’est pas parce que c’est beau que ça existe. On a besoin de l’imaginer sinon quel intérêt à notre existence ?
Alors si ça correspond à une exaltation ça n’a aucune chance de durer ?
Il faut toujours courir après son idéal, essayer de l’attraper. Le retenir, on ne peut jamais. C’est comme ça. Ensuite on peut se marier, former un couple. Quand ça devient du compagnonnage ce n’est plus de l’amour, c’est la peur d’être seul. La force de l’habitude c’est une autre force. Mais on est programmé pour ça. Être amoureux, avoir du désir… Un désir parfois curieux.

Oui. À un moment j’enviais presque les filles du porno qui au moins n’avaient pas de complexe à exhiber leur sexe. C’est dommage que ce soit pour des choses aussi nulles mais le geste en lui-même est une sorte de liberté que je suis incapable d’avoir.
C’est dommage qu’on ne fasse pas quelque chose de la pornographie. Il y a une phrase que j’adore dans Une vraie jeune fille (1999). Elle vomit et juste après elle dit : « le dégoût me rend lucide ». Vous avez peut-être besoin de mettre en scène le dégoût pour que vos personnages perçoivent quelque chose de vrai, qui ne serait pas de l’ordre de l’idéal ?
Vous voyez dans L’Été dernier on avait fait quelque chose au montage qui ne me plaisait pas. J’en avais vomi toute la nuit. J’ai compris que, quoi qu’il en soit, on ne pouvait pas couper le corps de Samuel (Kircher) dans la dernière scène d’amour.
Pourquoi il fallait éliminer ce corps, parce qu’il est trop jeune ?
Bien sûr. Et je l’ai recollé. Il fallait passer par cette transcendance. C’était fondamental pour le sens du film. Il faut de la poésie, elle est essentielle dans le cinéma.
Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans vos films. Ce sont ces femmes coupées en deux. Dans Romance, il y a cette séquence de fantasme où Marie est coupée en deux. Entre un décor virginal, aseptisé et un autre avec des hommes prêts à la pénétrer. C’est ça être une femme ?
C’est ce qu’on nous apprend, la honte absolue d’avoir un sexe féminin. C’est quand même beaucoup moins apparent que le sexe masculin. Quoi qu’on ne pouvait pas montrer un homme nu au cinéma. Même les poils des femmes n’étaient pas filmés. Les féministes anglaises m’avaient dit : « vous déshabillez les femmes au cinéma, quand on est une femme on ne doit pas les déshabiller ». Et bien moi je déshabillais les femmes mais aussi les hommes. Le cinéma n’est pas fait pour le militantisme féministe.
On ne peut pas dire que vous faites un cinéma féministe. D’ailleurs il n’y a jamais une victime et un bourreau, un personnage peut être l’un et l’autre.
C’est beaucoup plus ambigu que ça, évidemment. Souvent on désire obscurément parce qu’on ne se le dit même pas. Le désir est toujours imperceptible et obscur.
Dans Sex Is Comedy (2002), Jeanne (Anne Parillaud) dit : « elle a envie de se faire avoir mais elle veut que ce soit lui le coupable ».
Faut toujours que ce soit les hommes qui soient coupables. Le désir féminin ça n’existe pas, c’est quelque chose d’enfoui.
Au fond, le désir féminin est quand même le sujet de votre cinéma.
Je pense que l’homme agit comme révélateur de la femme dans son désir.
C’est le sujet mais ce n’est pas le désir comme une flèche qui va vers l’homme. C’est le désir que la flèche ce soit l’homme. Dans Tapage nocturne (1979), le personnage de Bruno (Bertrand Bonvoisin) dit de Solange (Dominique Laffin) qu’ « elle désire être faite » donc que ça arrive sans qu’elle n’y soit pour rien. Ce qui est très différent. D’ailleurs lorsque Dominique criait, il demandait : « pourquoi tu cries ? » et elle répondait : « c’est moi que je cherche ». Je pense que l’homme agit comme révélateur de la femme dans son désir.
C’est pour ça que vous ne filmez pas le désir de la femme envers un homme mais un désir qui lui permettrait d’accéder à elle-même.
À la fin de L’Étédernier, Léa (Drucker) jouit avec les poings fermés. Elle est enfermée en elle-même.
Cette idée de poings fermés est géniale. C’est de vous ?
Oui, elle m’est venue dans la nuit. C’était la quatrième scène d’amour. Je ne voulais pas qu’il y ait plus de sensualité. Je voulais au contraire qu’elle jouisse crispée. Je lui disais : « compacte-la ! », il fallait qu’il la serre jusqu’à l’étouffer, alors elle devient cramoisie.
Elle garde son plaisir pour elle. Ce que vous voulez c’est une quête identitaire. Ce qu’elle fait elle le fait uniquement pour elle-même.
On m’a très mal éduquée. Les hommes je m’en fous de leur plaisir à eux. Je ne suis pas altruiste pour les hommes. Sauf la fusion charnelle parce que là je suis amoureuse, il y a quelque chose. La fusion ça n’est pas s’occuper d’un homme, c’est autre chose. Il y a beaucoup de femmes amoureuses qui s’occupent des hommes. Moi, pas du tout. Je n’ai jamais été comme ça, ça m’est égal.
Sauf quand vous êtes amoureuse.
Là il y a quelque chose qui est de l’ordre de la poésie, de la danse avec l’autre. Les mouvements sont extrêmement harmonieux. Quand il y a une espèce de symbiose absolue des gestes, du rythme. Ce mouvement ondulatoire, c’est ça faire l’amour.
Vous allez faire un autre film ?
En principe, oui. Il ne faut jamais dire oui. J’avais écouté une masterclass de Saïd (Ben-Saïd), je m’étais dit : « c’est un producteur pour moi ». Moi qui suis toute vieille et rabougrie, je n’intéresse plus personne.
Vous intéressez les personnes intelligentes.
Là vous réduisez l’éventail. La plupart des gens ne font du cinéma que pour la gloire et s’enrichir, ce qui va avec la simplicité. La complexité ne fait pas vendre. Les spectateurs ne se sentent pas bien devant mes films, ils reconnaissent leurs points de déni.
Vous avez fait votre psychanalyse avec vos films, vous avez combattu votre déni. Certaines personnes ne sont peut-être pas prêtes à regarder vos films, à s’y confronter.
Je ne respecte pas le gentlemen’s agreement, je suis une cinéaste de l’émotion.
Je ne respecte pas le gentlemen’s agreement, je suis une cinéaste de l’émotion. On ne peut pas échapper à l’émotion or ce n’est pas tout à fait une fiction. La fiction c’est une histoire qu’on vous raconte à l’écran. Les spectateurs savent se reconnaitre mais secrètement. Face à mes films le spectateur est obligé de se reconnaitre mais s’il est avec quelqu’un, il va avoir honte. Il va essayer de lutter contre cette émotion mais il peut aussi m’accuser de le violer, ce qui est vrai.
C’est plus insidieux.
Ça l’est et donc on ne peut pas s’en défendre et c’est tout le problème. Le spectateur est obligé de reconnaitre que ce n’est pas un personnage mais que c’est lui. Lui dans cette situation là est exactement comme ça mais il ne veut pas le savoir. Ou alors il veut le savoir mais dans son coin.
Je pense que c’est pour ça que vous êtes la seule à montrer ça, personne n’est prêt à admettre que c’est comme ça que ça fonctionne. Et c’est très difficile de représenter cette contradiction du désir. C’est la lâcheté qui fait qu’on ne filme pas ça.
On veut le cliché.
C’est rassurant.
Finalement tous mes films sont dangereux, justement à cause de la complexité des sentiments. Et en même temps c’est comme ça, c’est du lieu commun.
Vous parlez du lieu commun dans le livre d’entretien, vous dites que c’est « le lieu du déni ».
Il est entendu que coucher ou faire l’amour c’est une chose. Une fois que c’est fait, c’est fait. Or non, c’est une histoire qu’on raconte et cette histoire on ne la raconte jamais. Dans L’Été dernier il y a quatre scènes d’amour, on aurait pu n’en faire qu’une. On imagine que c’est juste : ils couchent ensemble. Non, c’est : Comment ils couchent ? Qu’est-ce que ça signifie ? Quelle histoire ils se racontent ? Quelle est la manière de jouir ou de ne pas jouir ? Tout ça raconte quelque chose.
- Catherine Breillat, Je ne crois qu’en moi, Entretien avec Murielle Joudet, Editions Capricci, en librairie le 15 septembre.
- L’Été dernier, réalisé par Catherine Breillat, SBS Productions, avec Léa Drucker et Samuel Kircher, en salles le 13 septembre.
Entretien réalisé et retranscrit par Anastasia Marchal
Crédit photo : Catherine Breillat, pour la revue Hors-Série, entretien avec Murielle Joudet, 2015.