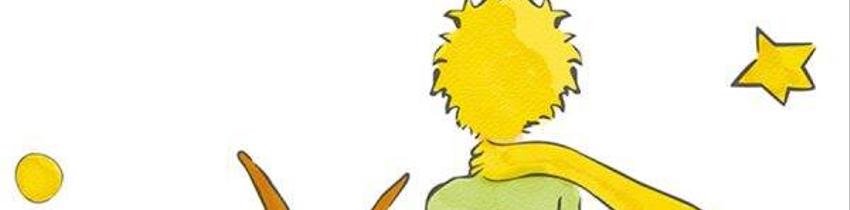En promettant une romance entre Andrew Scott et Paul Mescal, Andrew Haigh avait allumé bien des désirs de voir, qui ne demandaient qu’à être des désirs d’aimer. Aime-t-on Sans jamais nous connaître ? Plus nébuleux que mystérieux, le dernier film du réalisateur britannique s’embrouille dans ses procédés et nous égare dans les méandres de son intrigue.

Adam (Andrew Scott), la quarantaine bien entamée, flâne mélancoliquement dans la petite banlieue londonienne qui l’a vu grandir. Au détour d’un petit bois, une silhouette mâle s’approche, rôde et lui fait signe. Un homme svelte, petite moustache noire, cheveux soigneusement gominés. Cette scène est de celles qui hantent l’imaginaire gay, on la reconnaît tout de suite : c’est une scène de cruising, cette drague publique que pratiquent les hommes en quête de coups d’un soir. Adam suit le jeune homme, l’aborde, et l’accompagne jusqu’à l’un de ces petits pavillons de banlieue tous identiques où il rencontre…son épouse ? Une femme les attend sur le seuil, jeune aussi, et le petit couple accueille Adam, un peu plus âgé qu’eux, comme un membre de la famille longtemps perdu de vue. Qu’est-il devenu ? Il est écrivain — scénariste, plutôt. Et ce sont, eux, on finit par le comprendre, ses parents : tels qu’ils étaient alors, avant l’accident tragique, dans cet intérieur préservé des années 1980 et prêts à recevoir le témoignage de la vie qu’a vécue, en leur absence, l’enfant qu’ils ont élevé.
L’amour, les sorts
À ce premier décalage fantastique, Sans jamais nous connaître en combine un second, celui de la rencontre d’Adam avec le jeune Harry (Paul Mescal), seul autre locataire de leur immeuble déserté. On nous laisse volontairement dans l’incertitude sur le statut de ce personnage ambigu, moitié fantasme, moitié apparition. Ces ficelles narratives, qui tiennent autant du réalisme magique que du bon vieux Chair de poule, s’usent à l’usage et gênent aux entournures. Car quelle empathie développer pour ces fumerolles de personnages, qu’un nouveau repli du scénario risque à chaque instant d’abolir ? On aimerait croire au beau Harry, mais le film ne cesse de nous le dérober dans des tours de passe-passe de mise en scène qui ont vécu : il se perd dans les lieux publics, s’évapore au passage d’un train, on s’endort à ses côtés et on se réveille seul – comment ne pas se douter de son caractère fantasmatique ? Signe de ce déséquilibre initial, on n’apprend quasi rien sur ce personnage fonction qui n’est que l’exutoire des angoisses du protagoniste.
Et ainsi Sans jamais nous connaître n’en finit pas de se désamorcer, en aplatissant l’émotion qu’il voudrait susciter sous l’empilement de ses procédés fantastiques. Les effets spéciaux ne sont pas spécialement laids (quoique…), mais ils ne renouvellent rien et relèvent de tics d’écriture. L’inévitable scène de boîte de nuit a ses néons violets et ses foules qu’on traverse un verre à la main ; la drogue provoque ellipses temporelles, bad trips, hallucinations et autres distorsions violentes du visage (peut-être le seul effet vraim...