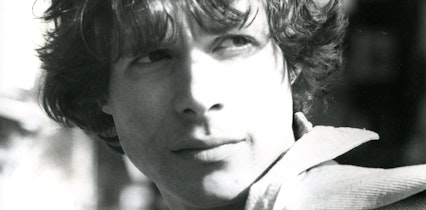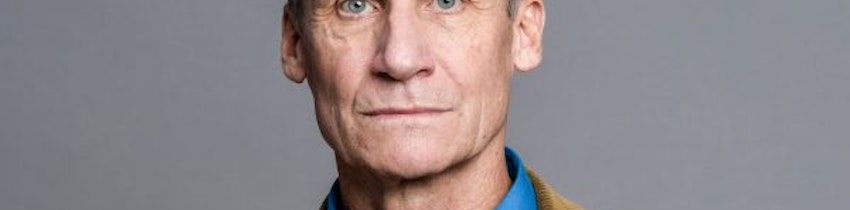Comment parler de maternité, de désir, de domination et de pouvoir aujourd’hui ? Sarah Haidar y parvient grâce à l’utilisation d’une violence stylistique qui rend chaque phrase aussi tranchante qu’un scalpel. L’écriture clinique s’attaque alors aux représentations convenues de la féminité et du corps, transformant l’œuvre elle-même en une dissection de la condition féminine prise dans un réseau de contraintes biologiques, sociales et politiques. Plus qu’une critique sociale, Aménorrhée fait exploser les discours normatifs en exposant ce qu��’ils cherchent à masquer.

Aménorrhée expose une voix narrative pleine de courage et qui fait preuve de revendication, qu’elle soit biologique, sociale ou politique. En effet, le roman suit une narratrice confrontée à une maternité imposée dans un monde où l’avortement est criminalisé et où le corps féminin est un territoire de surveillance et de contrôle. Le texte fonctionne ainsi par éclats, alternant introspection crue, scènes de dépossession et moments de résistance : la révolte ne passe ni par le langage ni par la violence traditionnelle, mais par une exposition radicale du corps. L’écriture clinique devient presque hallucinée et dissèque sans compromis la maternité, le désir et la domination, faisant du texte une attaque contre les illusions imposées par l’ordre social.
Le corps féminin, possédé dépossédé
L’incipit s’ouvre sur l’histoire d’une voix qui constate une transformation imposée, une maternité inévitable dictée par un système qui interdit toute possibilité d’avortement : “Je m’attribuais une morphologie interne au-delà du pensable et me pensais particule virale pour que la vie puisse batifoler hors du sens commun.” La maternité est vécue comme une contamination, une présence intrusive qui nie toute individualité. Ce qui devrait être un accomplissement apparaît comme une dérive, un mouvement hors de soi, une réduction à un corps destiné à porter, nourrir et enfanter. La narratrice pourtant refuse ce rôle et l’ordre biologique se heurte à une conscience qui refuse de se plier à l’ordre établi La possibilité de l’infanticide s’installe ainsi : “Quelques centimètres de plus, une maladresse, un geste involontaire, un accident est vite arrivé…” La phrase n’est pas restitution d’un fantasme morbide, mais l’expression d’une révolte contre l’assignation maternelle, contre un corps qui échappe à sa volonté propre.
Cette résistance s’exprime face à toutes les injonctions qui entourent la maternité. “Tu dois être la femme la plus heureuse sur terre !” Le bonheur maternel obligatoire est imposé comme une évidence, un principe indiscutable. Le texte démonte cette fiction par le ressenti brut de la narratrice, qui voit son corps comme un espace d’aliénation. N’étant ni refuge ni plénitude, la maternité devient une assignation sociale, un rôle joué sous contrainte.
Le désir comme territoire de domination
Le corps n’appartient jamais totalement à celle qui l’habite car est une possession partagée entre les attentes sociales et les rapports de force. La sexualité, qui ne peut donc plus être lieu d’épanouissement, est vécue comme une scène où se rejouent le pouvoir et l’humiliation. “Le sexe n’est pas le plaisir, c’est le mépris !” La phrase claque, brutale, dénuée d’ambiguïté. L’imaginaire romantique est ainsi mis de côté, puisque la relation physique est perçue comme un acte où l’un impose et l’autre subit. Cette vision s’incarne dans des scènes où la narratrice exprime une lucidité impitoyable sur les dynamiques de domination. “Pris dans un double délire du sauveur et du pervers sexuel, vaniteux et trop obnubilés par leur gland.” Les figures masculines oscillent entre la posture du protecteur et celle du prédateur, sans jamais renoncer au contrôle qui leur semble inhérent. Même ceux qui se disent “déconstruits” reproduisent les structures qu’ils prétendent rejeter.
Le regard porté sur la sexuali...