Steve Aganze signe avec Bahari-Bora un premier roman d’une intensité rare, porté par une langue poétique et une force de témoignage bouleversante. À travers le regard d’une jeune fille broyée par la guerre, il donne voix à l’indicible – sans jamais céder à la complaisance ni au pathos. Dans cet entretien, il revient sur les origines du livre, ses choix d’écriture, et sur ce que signifie encore espérer dans un monde fracturé.
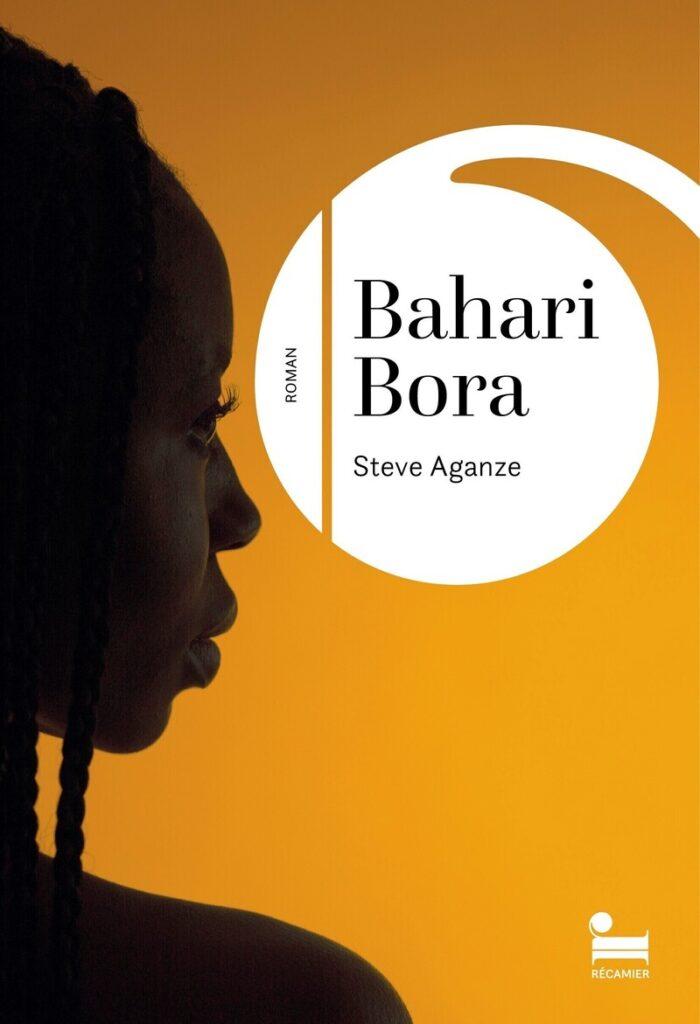
Velimir Mladenović : Bahari-Bora est un roman profondément marqué par la violence sexuelle, la guerre et la résilience. Qu’est-ce qui vous a conduit à raconter cette histoire à travers les yeux d’une jeune fille victime et survivante ?
Steve Aganze: J’ai choisi de raconter cette histoire à travers les yeux d’une jeune fille parce que, dans toutes les catastrophes sociales, ce sont toujours les mêmes que l’on retrouve sur la ligne de front : les femmes, et plus encore, les enfants. Et quand une personne incarne à la fois ces deux vulnérabilités – être une fille et être une enfant –, elle devient la cible la plus exposée, la plus fragile et souvent la plus oubliée. J’ai voulu écrire depuis ce regard-là parce qu’il est trop souvent ignoré, et pourtant il dit tout. Dans les zones de guerre, les jeunes filles sont utilisées comme des armes, des butins, des instruments de terreur. Et quand elles survivent, on ne les célèbre pas pour leur force – on les accuse d’avoir vécu. De nombreuses jeunes filles enlevées sont ensuite rejetées par leurs propres familles, répudiées par leurs communautés, comme si elles étaient responsables de l’horreur qu’elles ont subie.
Le rapport à la valeur est aussi au cœur de cette histoire. La société traditionnelle attribue aux filles une certaine « valeur » dès leur naissance – une valeur conditionnée à leur silence, leur obéissance, leur pureté. À chaque pas de travers, ou même sans faute de leur part, cette valeur diminue. Elle parle trop fort ? On lui soustrait de la valeur. Elle s’assied sans croiser les jambes ? Encore une soustraction. Et si des mains violentes s’abattent sur elle, on ne condamne pas ces mains – on retranche encore de sa valeur, comme si elle en était responsable. Les garçons, eux, naissent sans cette étiquette : ils acquièrent ou perdent leur valeur au fil du temps, mais ils ne sont pas d’emblée comptés comme un capital à protéger.
La force de Bahari-Bora, c’est celle que j’ai admirée très tôt chez les femmes de mon entourage. Une force silencieuse, obstinée, souvent invisible, mais inaltérable. Ce roman est un témoignage, un hommage aussi, à toutes ces femmes du monde entier qui affrontent l’horreur avec une dignité qu’on ne leur reconnaît pas. Parce que, dans les conflits, l’ennemi n’a pas toujours d’uniforme. Pour une femme, il peut avoir le visage du voisin, du frère, quelquefois même du père. Cette insécurité constante, cette peur tapie dans le quotidien, c’est ce que j’ai voulu raconter. J’ai vu certaines choses, j’en ai entendu d’autres, et j’ai senti que je devais en témoigner à ma manière. Bahari-Bora, c’est leur voix que je rends visible. C’est leur combat que je salue.
VM : Le personnage de Bahari-Bora est à la fois brisé et incroyablement fort. Comment avez-vous conçu sa voix intérieure et son évolution tout au long du roman ?
SA: Bahari-Bora vit dans ce que je nomme le déni de l’anormalité. Elle ne se pense pas comme une victime, parce que dans son monde, l’horreur est la norme. Dans cette région oubliée d’Afrique centrale, la guerre n’est pas un événement : c’est un paysage. Depuis plus de trente ans, les habitants vivent dans une terreur continue. On parle de plus de dix millions de morts, de centaines de milliers de femmes violées, mutilées, brisées dans leur chair et dans leur dignité. Et pourtant, la vie continue. Les enfants naissent, trouvent ce conflit comme d’autres trouvent un climat, et ils apprennent à survivre dedans, puis à le transmettre malgré eux. Bahari-Bora est née dans ce chaos. Elle n’a pas connu autre chose. Son esprit s’est construit dans un monde où le silence est une stratégie de survie, où les corps n’appartiennent plus tout à fait à ceux qui les habitent. Elle ne s’autorise ni à s’effondrer ni à se plaindre, non par bravade, mais parce que ce n’est tout simplement pas une option.
Quand j’ai conçu sa voix intérieure, je ne voulais pas qu’elle implore, ni qu’elle accuse. Je voulais qu’elle témoigne. Qu’elle pense. Qu’elle ressente profondément, dans sa chair, dans ses silences. Bahari-Bora n’est pas une héroïne tragique, ni un symbole à plaindre. Elle est l’incarnation de cette force discrète mais inébranlable que j’ai toujours admirée chez les femmes autour de moi. Et c’est précisément pour cela que je ne pouvais pas la rendre pitoyable. Ce roman n’est pas un appel à la pitié, mais un hommage à la résilience, à l’empathie, à la dignité dans les ruines. Bahari-Bora est résignée à disparaître, oui, mais elle refuse de disparaître sans laisser une trace, sans transmettre la vie. Son espoir, c’est son enfant. Et dans cet espoir-là, elle redevient puissante. L’espoir, c’est peut-être tout ce qui reste quand tout a été pris – et c’est souvent ce qui sauve. Nous en avons besoin, plus que jamais.
VM : La présence des femmes dans les groupes armés est abordée avec une grande complexité, entre contrainte et complicité. Souhaitiez-...

















