
L’alcoolisme n’est pas mon fort. Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir croisé sur ma route, à force de vivre. Proches, familiers, collègues, amis, étudiants… Quand on brasse du monde, on finit toujours par rencontrer les effluves des brasseries. Ça s’amuse, ça s’imbibe, et puis ça sombre, parfois. Certains meurent. Il faudrait raconter cela. J’en serais bien incapable : je suis spectateur de l’alcoolisme comme d’un monde à part, distant, et reste, moi, bien à l’abri, comme tous ceux qui consomment et vivent avec modération. Heureusement, il y a les livres des autres. Les Latins avaient un mot pour ça. On le trouve chez Lucrèce : suave mari magno… « Il est doux, quand la vaste mer est soulevée par les vents, d’assister du rivage à la détresse d’autrui ; non qu’on trouve si grand plaisir à regarder souffrir ; mais on se plaît à voir quels maux vous épargnent. » Ce n’est pas forcément très noble, mais c’est aussi comme ça qu’on apprend. Place à l’artiste qui va sombrer pour nous, donc. Entre ici, Antoine Blondin, avec ton pénible cortège…
Légendes
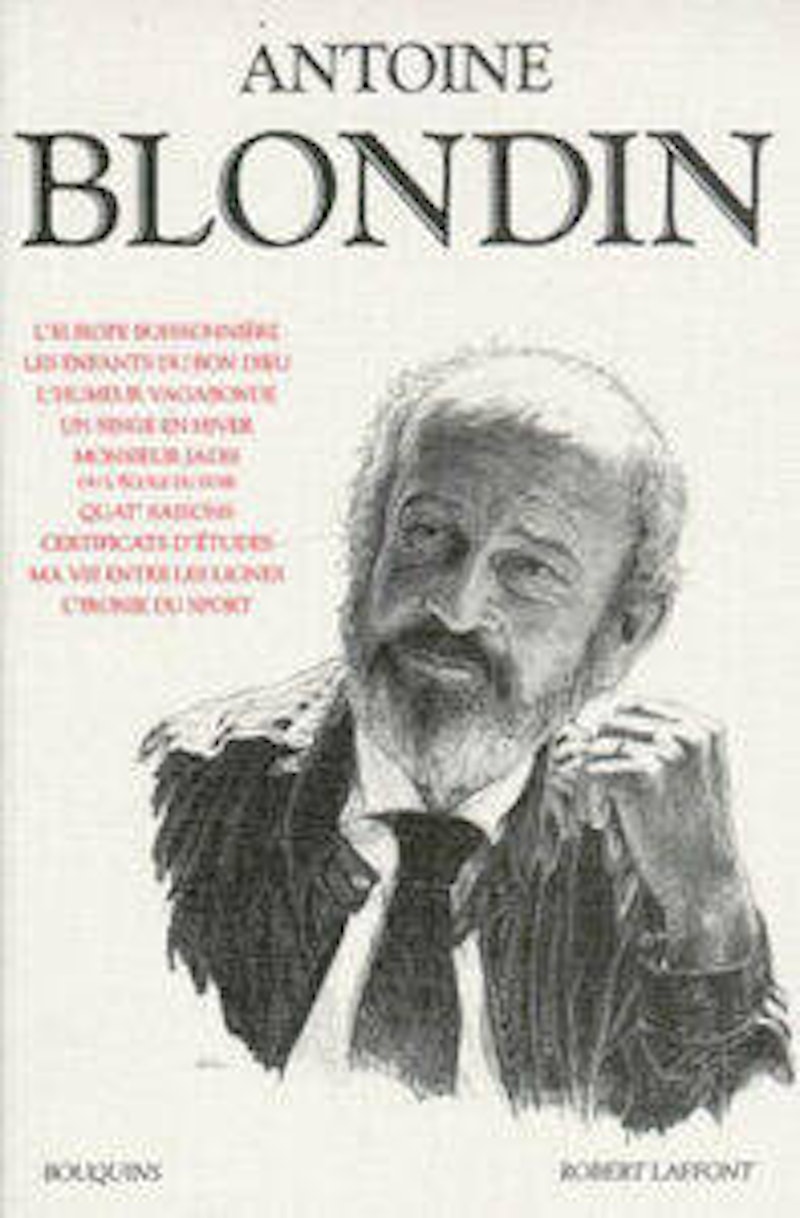
L’autre gros morceau du déjà su, de ce déjà connu qui peut faire obstacle à notre lecture, aujourd’hui, de l’œuvre blondinienne, c’est la petite mythologie usée des Hussards. Roger Nimier, Jacques Laurent, Michel Déon, Kléber Haedens, d’autres encore et, donc, Blondin. Qu’on ait l’honnêteté de se plonger vraiment dans leurs œuvres et on en ramènera de très beaux livres (Paul et Jean-Paul, Roman du roman, Le Grand d’Espagne, quelques autres…). Mais, avant cela, il y a la photo de groupe, avec tout ce qu’elle raconte malgré elle : le côté pénible de la grégarité masculine – qu’elle soit ici littéraire n’y change rien. Les types alignés contre un mur, façon Minuit, ou entassés dans un bureau, ou encore surpris en pleine séance spiritualisto-surréaliste, bon…
Pour ne rien arranger, les Hussards étaient à droite, et même très à droite, quoique ça ne soit finalement pas l’obstacle le plus difficile à enjamber de nos jours. Dans sa charmante Panoplie littéraire, Bernard Frank résumait ça très bien : « Les écrivains de droite, pour la plupart, ne sont pas des écrivains qui se moquent de la politique, ou qui croient que la politique est un mal pour la littérature, plus véridiquement ce sont des écrivains que les circonstances ont contraints à se moquer de la politique. »
Et aussi (cette fois dans le fameux article qui baptisa le mouvement, « Grognards et Hussards », paru dans Les Temps modernes en 1952) :
« Comme tous les fascistes, ils détestent la discussion. Ils se délectent de la phrase courte dont ils se croient les inventeurs. Ils la manient comme s’il s’agissait d’un couperet. À chaque phrase, il y a mort d’homme. Ce n’est pas grave. C’est une mort pour rire. À les lire pourtant on a l’impression cauchemardesque qu’on se trouve en face d’automates dont le masque se serait figé en une expression d’hilarité perpétuelle. »
Très vrai, tout cela, très juste, surtout concernant Nimier et Blondin. Ensuite, honnêtement, je crois que cet aspect ne défrise plus tellement leurs éventuels lecteurs du jour. Après tout, si les antifascistes du XXIe siècle sont encore étonnamment nombreux, compte tenu du faible risque pour eux de croiser la bête immonde sortie de son ventre encore fécond, ils ne lisent plus guère de littérature : ils préfèrent les bédés (pardon : les romans graphiques), la sociologie et les livres d’Édouard Louis. Les ouvrages, le style et les idées d’un Déon ou d’un Laurent leur posent aussi peu de problème que ceux d’un Dumas ou d’un Diderot : ils n’existent tout simplement pas pour eux, puisqu’ils les ont complètement invisibilisés (pour parler comme eux) de leur horizon culturel.
Non, le véritable obstacle à mon avis, le versant vraiment désagréable de la mythologie hussarde, et finalement le plus à même de décourager les lecteurs de bonne volonté, c’est plutôt le côté déconneur, insolent, « luron » comme disait Frank, si complaisamment étalé et sempiternellement remémoré dès qu’il est question de ces éternels anciens jeunes gens, pourtant tous bien morts à présent.
Oui, les Hussards pâtissent sans doute surtout d’avoir été une sorte d’incarnation de la littérature cool et dispensable, grise, grisante et grisée, celle de tous les Beigbeder du monde à travers les âges : soit tout le romanesque faiblard de la mélancolie fêtarde et du spleen cocaïné. Ils aimaient les blagues, les farces et les canulars (parfois très drôles d’ailleurs, il faut le reconnaître). Grand bien leur en fasse, mais cela ne justifie nullement qu’on continue à les lire. Après tout, Homère et Chrétien de Troyes étaient peut-être d’excellents convives qui régalaient leur compagnie d’anecdotes drolatiques. Qui le sait ? Surtout : qui, aujourd’hui, s’en soucie ?
Mais bref, assez balayé devant leur porte. Une fois mises bout à bout toutes ces excellentes raisons de ne pas lire Antoine Blondin, pourquoi ne pas le lire enfin ?
L’écriture comme un art éthylique, pudique et charmant
Pour commencer, lui-même parlait très drôlement de l’écriture, c’est déjà ça. Je ne retiendrai que deux propos sur ce point, tirés de ses Certificats d’études :
« N’écrivant pas sous l’empire d’une nécessité intime fort vive, je ne suis pas suffisamment pénétré de mes charmes pour estimer qu’il convient de m’infliger trop souvent cette torture délicieuse. Du moins, je m’en persuade dans l’intérêt commun. » Et plus loin : « Si “l’existence précède l’essence”, comme a dit, paraît-il, Jean-Paul Sartre, signifiant par là, non sans quelque apparence de raison, que c’est en forgeant qu’on devient forgeron, je suis un phénomène existentialiste, n’étant devenu écrivain qu’en écrivant, contrairement à d’autres qui, très légitimement, commencent par mener de front le Prix Nobel et le Certificat d’études. »
Écrivain dilettante, donc. Esprit de sérieux s’abstenir. Tout ça avec une réelle élégance, un tact à vous inviter à entrer dans les pages de ses récits jamais bien longs, jamais intimidants, par des attaques tout en rythme et en drôlerie. Il est certain que l’on y pénètre comme dans des chaussons. C’est agréable, ça n’est pas compliqué – ça ne veut pas l’être. Et c’est très bien ainsi.
Quelque chose frappe immédiatement le lecteur, cependant : le style. Un peu trop travaillé, presqu’agaçant dans son désir forcené de toujours chercher la formule qui claque, le calembour à chaque ligne (avec le risque inhérent à ce type de procédé : ça ne fait mouche qu’une fois sur deux). Je songe à la formule de Sainte-Beuve à propos de Flaubert : « Il a du style, il en a même un peu trop. »
Il ne s’agit pas pour autant de nier le charme d’une telle écriture. Elle rappelle (dans des romans comme Un singe en hiver et Monsieur Jadis, il y a de ce point de vue une belle adéquation entre fond et forme) l’amuseur ivre qui veut plaire, en soirée. Qui vous tire par la manche pour vous divertir, vous séduire et surtout, bien souvent, pour éviter de se retrouver seul avec lui-même. Il y a quelque chose de touchant dans ces fioritures, ces excès d’écriture, dans cette largesse qui mime par de pauvres mots l’illusion d’une splendide fête sans fin, dont on sent qu’elle masque mal un indécrottable fond de tristesse – de même qu’une certaine pauvreté. Cela, l’écriture de Blondin le fait sentir avec l’élégance paradoxale d’un dandy clochardisé, avec canne en jonc, petit melon et pantalon trop large. Notre Charlot des lettres.
Quiconque connaît le bonheur de compter parmi ses amis quelques ivrognes magnifiques sait à quel point ce peuvent être des gens exaspérants et infantiles, qui parlent beaucoup mais n’écoutent jamais, attendant toujours de vous un soutien, une aide qu’ils seraient bien en peine de vous rendre un jour. Mais, aussi, combien ils peuvent être drôles, fantaisistes, irrésistiblement sympathiques, comme si, avec eux, c’était tout le poids de la vie qui soudain s’allégeait, le quotidien morne se dissolvant pour enfin laisser place au rêve, au monde devenu théâtre, et à la joie. Or, il me semble que c’est justement ce miracle, minuscule mais précieux, que l’écriture de Blondin, par ses tics, ses enjolivures et ses ridicules même, parvient à susciter.
Paris est un rêve
Ainsi dans Monsieur Jadis ou l’École du soir, ce merveilleux roman autobiographique (le dernier de son auteur) du retour aux errances nocturnes et bachiques dans le 7ème arrondissement de Paris.
Nous voilà embarqués dans une succession de nuits d’ivresse, tantôt joyeuses, tantôt tristes – souvent les deux. Blondin, homme mûr, se souvient de la fin d’une jeunesse qui traîne en longueur, dans les années 1950. Il a la trentaine, se retrouve déjà père, déjà divorcé, retourné vivre chez sa mère parce que sa maîtresse ne peut l’accueillir chez elle à plein temps. Un grand adolescent pataud, en somme, incapable d’entrer véritablement dans sa vie d’adulte. On songe au Gilles de Pierre Drieu la Rochelle, cet autre hésitant qui, lui aussi au sortir d’une guerre, ne sait pas très bien comment s’y prendre pour devenir un homme. Un type très français au fond, léger, sympathique, dont on se demande bien qui il peut bien intéresser en dehors de nos frontières, mais dont il faut reconnaître qu’il nous touche et nous parle encore, ce lointain héritier, titubant et falot, de Cyrano et de Villon. C’est comme un cousin qu’on a toujours connu, un ami de la famille.
Alors il erre, la nuit, autour de la rue du Bac et du quai Voltaire. Parfois il voyage, mais le plus souvent il se contente de fuguer pas trop loin : Champs-Élysées, parc Monceau, Billancourt… Il prend des taxis, marche beaucoup, s’arsouille, se bat et, bien souvent, se fait démolir la gueule. Les flics du quartier le connaissent, à force : il finit chez eux un soir sur deux.
Paris, ainsi raconté, lui appartient. Les boulevards ne sont que les allées de son jardin des mille et une nuits d’ivresse. Toutes les portes s’ouvrent : celles des bars, des hôtels miteux, mais aussi des hôtels particuliers, et même des ministères, dans un chapitre particulièrement onirique, drôle et réussi. On y croise les camarades Nimier et Haedens, mais aussi quelques bonnes fées qui ont pour nom Marcel Aymé ou Paul Morand, ou encore la tonitruante prostituée Popo.
Et le lecteur de se laisser entraîner, ravi, par cet arlequin bancal, ce génie maladroit, ce mauvais jeune homme à la fois affligeant et touchant, qui ne s’épargne guère (comme dans la terrible scène où il s’endort, un soir de Noël, oubliant ses filles venues le retrouver, qui finissent par repartir chez leur mère en abandonnant leurs cadeaux sur le pas d’une porte qu’il n’a pas su ouvrir à temps) et qui pourtant, à chaque nuit, à chaque tour de piste, nous tire une fois encore par la manche, nous promettant qu’il va nous amuser, nous éblouir, nous faire vivre et voir ce que nous n’avons jamais vécu ni vu. En quoi il n’a pas complètement tort.
Après quoi nous reposons le livre. Nous sommes chez nous, entourés de meubles et d’objets à la rassurante familiarité. Tout est calme. L’enfant dort, et la ville avec lui. Le monde enchanté, celui où nous ne vivons pas, s’est évanoui. Il existe pourtant, puisque certains livres nous y emmènent. Et certains hommes, aussi. Qu’ils en soient pour toujours remerciés, surtout quand ils s’y sont perdus.
Bibliographie :
Blondin, Antoine, L’Humeur vagabonde, La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2016.
Blondin, Antoine, Les enfants du Bon Dieu, La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2016.
Blondin, Antoine, L’Europe buissonnière, La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2016.
Blondin, Antoine, Monsieur Jadis ou l’École du soir, La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2020.
Olivier Maillart

















