
Pour accompagner votre confinement et vos vacances de noël, Zone Critique lance sa rubrique “Les classiques” de la rédaction” ! Chaque semaine, l’un de nos rédacteurs vous présentera une oeuvre qui l’a particulièrement marqué, et tentera de vous donner envie de la lire, si ce n’est pas encore fait. Pour le premier numéro de notre série, nous revenons sur le roman Uranus de Marcel Aymé.
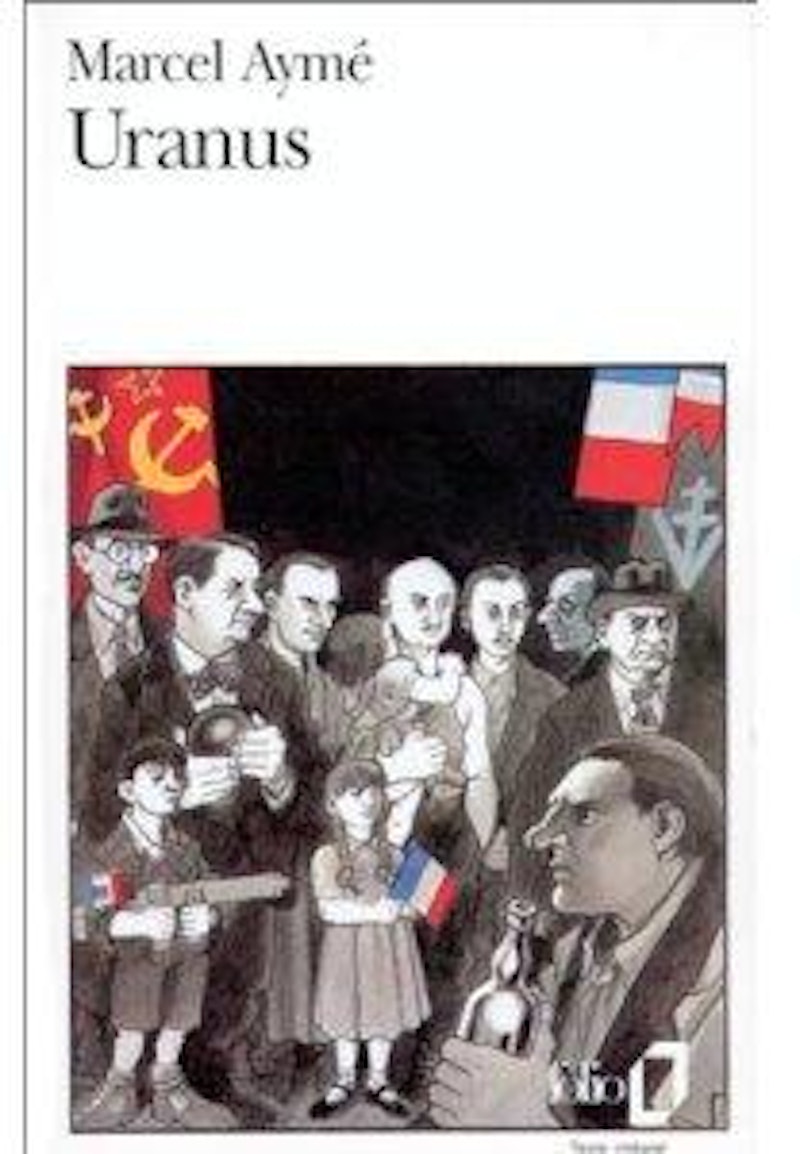
Je ne dis pas que vous soyez un hypocrite, mais il y a des époques où le meurtre devient un devoir, d’autres qui commandent l’hypocrisie. Le monde est très bien fait. L’homme a en lui des dons qui ne risquent pas de se perdre. »
Pas plus que leur village, dévasté aux trois quarts par un bombardement à la Libération, les habitants de Blémont ne sont sortis indemnes de la guerre et de quatre années d’occupation allemande. Tourmenté ou non par sa conscience, chaque Blémontois doit désormais se frayer un chemin dans la France libérée et partiellement épurée. Personne ici n’a oublié l’exécution publique d’un traître dont on a crevé les yeux avant de le forcer à faire à genoux le tour du village. Dans les journaux et les cérémonies officielles, la réalité est indiscutable : les Français, sous la houlette du général De Gaulle, ont vaillamment résisté puis vaincu la vermine nazie, et ses collaborateurs indignes. Mais dans l’intimité des foyers, la réalité semble plus nuancée… Et c’est précisément ce décalage entre discours officiel et version officieuse qui intéresse Marcel Aymé.
Archambaud, ingénieur respecté par ses pairs, un peu moins par ses enfants, ne se le cache pas : il a cru à l’utilité de la collaboration, et le croit encore « dur comme fer ». Comme de nombreux Blémontois, il a été maréchaliste, « sans tapage », pas suffisamment pour se voir reprocher quoi que ce soit à la Libération. C’est donc avec agacement qu’il assiste au spectacle des regards faux et des sourires complaisants de ses compatriotes, pourtant pas plus résistants que lui mais soucieux de se ranger derrière le nouvel esprit du temps. Et il constate, avec plus d’agacement encore, qu’il cède lui aussi aux sirènes du conformisme trompeur : « Parfois, il se voyait lui-même attentif à ne pas laisser deviner ses vraies pensées et se tirant d’affaires par un silence, un hochement de tête ou un sourire donnant à entendre, sans équivoque pour l’interlocuteur, qu’il se rangeait à son avis. » Il faut dire que l’heure n’est pas à la fanfaronnade dans ce village où les militants communistes ont pris l’ascendant moral et sont prêts à dénoncer n’importe quel villageois pour le moindre pas de côté. Aux prises avec ces réflexions, Archambaud rentrant chez lui un soir, est interpellé dans la cour de son immeuble par un homme qu’il reconnaît immédiatement : Maxime Loin, ancien employé de son usine ayant œuvré, pendant la collaboration, pour des journaux fièrement acquis à la cause hitlérienne. Condamné à mort par contumace, recherché, traqué, Maxime Loin demande un abri. Archambaud, pris de pitié et contraint, lui offre son toit… Advienne que pourra.
Pendant ce temps, la discussion va bon train au café du Progrès, dont le patron Léopold, gorgé de ses douze litres de vin blanc quotidiens, se prend d’affection pour Racine depuis que – le collège ayant été détruit – les professeurs font classe chez lui. Si d’aucuns doutent de la probité du cafetier en temps de guerre et de marché noir, il se met hors de cause, lui qui a « employé un juif comme garçon de café ». Les gendarmes le savent pourtant, il s’agissait de son neveu qui n’avait rien d’un juif… mais tant pis, chacun s’arrange comme il peut pour jouer sa carte de résistant de la première heure. À Blémont, on invente, on brode, ou à défaut de mieux… on se tait. Surtout quand on se trouve à portée de voix d’un militant d’extrême-gauche. Lesquels se déclinent en une multitude de profils : Jourdan, le zélé marxiste, René Gaigneux, membre loyal du comité de la section locale du parti communiste, ou encore Fromentin, socialiste combatif, planant bien au-dessus de ses contemporains dans le ciel des idées politiques, « épris de grandes lignes, de schémas, de vues cavalières ». Depuis la destruction partielle du village, ce concentré d’humanité se voit contraint à la plus grande proximité. Certaines familles doivent désormais partager leur appartement avec les sinistrés et s’accommoder de ce nouveau voisinage, souvent incommodant.
L’histoire mise à rude épreuve
Sorti trop tôt, le roman dérange. Le mythe d’une France gaulliste, débarrassée de ses éléments impurs commence à prendre, mais avec Uranus, Marcel Aymé vient mettre à mal l’hagiographie nationale. Insolent, il remue le couteau dans la plaie, encore béante… et rappelle, avec humour plutôt qu’acrimonie, qu’il n’existe pas de récit en noir et blanc.
Marcel Aymé avait déjà apporté la preuve de son talent de romancier avant la seconde guerre mondiale, mais cette dernière est incontestablement venue lui fournir une matière littéraire inestimable. Lui qui se plaisait dès les années 30 à peindre l’âcreté des relations humaines sur fond de dissensions politiques (dans la Jument Verte, conservateurs et républicains battent le fer à l’époque du boulangisme) ne pouvait rêver mieux. Le Front populaire et l’Occupation lui avaient déjà servi de décor pour Travelingue (1941) et le Chemin des écoliers (1946). Avec le thème de l’épuration, Uranus vient en 1948, clore la trilogie. Une publication détonante,quatre années seulement après la Libération, alors que la mémoire de Vichy est encore à vif et de nombreux procès en cours. Sorti trop tôt, le roman dérange. Le mythe d’une France gaulliste, débarrassée de ses éléments impurs commence à prendre, mais avec Uranus, Marcel Aymé vient mettre à mal l’hagiographie nationale. Insolent, il remue le couteau dans la plaie, encore béante… et rappelle, avec humour plutôt qu’acrimonie, qu’il n’existe pas de récit en noir et blanc.
Comme le roman nous le signale, la résistance, comme la collaboration active, demeurèrent des comportements minoritaires. Avant de se mêler de politique, il s’agissait d’abord d’assurer sa survie. Mais cette version peu glorieuse du Français moyen passif, voire consentant, mettra du temps à s’imposer et à égratigner le mythe de la France résistante. Ce n’est qu’une vingtaine d’années après la guerre, par les assauts répétés d’historiens et de journalistes ayant mis leur nez dans des archives, que cette version va se fissurer. La sortie en 1971 du documentaire Le Chagrin et la pitié, (autorisé à la télévision en 1981 seulement), subvertit la version officielle et choque profondément. En montrant les comportements ambigus des Français vis-à-vis de l’occupant, il inaugure une nouvelle phase historique, celle de la « mémoire brisée », telle que l’appellera l’historien Henry Rousso. Les deux scénaristes de ce documentaire, André Harris et Alain de Sédouy insistent et publient en 1978 Qui n’est pas de droite, un ouvrage interrogeant le rapport des Français à leur histoire. Ils y interrogent diverses personnalités sur leur cheminement idéologique et politique. Dans un de ces entretiens, Jacques Benoist-Méchin, ministre des affaires étrangères sous Pétain, (condamné à mort en 1947, puis gracié par Vincent Auriol) relate un propos qu’il avait adressé à l’historien Robert Aron, venu le consulter pour son Histoire de Vichy : « Ecoutez, vous voulez être absolument objectif alors que vous présentez l’affaire comme s’il y avait eu 50% de gaullistes et 50% de pétainistes. Ce n’est pas vrai ! Au début, il y a eu 90% de pétainistes et 10% de gaullistes et pour finir, il y a eu 90% de gaullistes et 10% de pétainistes. » Marcel Aymé, à travers le monologue intérieur de son personnage Archambaud, ne dit pas autre chose (avec un style plus relevé tout de même) : « Cette vague d’hypocrisie, qu’il croyait voir déferler sur la France, prenait maintenant à ses yeux des proportions grandioses. Que la presse entière feignît d’ignorer qu’il existait des millions d’individus tenant pour telle opinion ou en réduisît le nombre à quelques dizaines de milliers d’imbéciles et de vendus, il y avait là, songeait-il, un mensonge colossal. »
Éloge de la faiblesse
Cependant, rassurons le lecteur peu friand de politique, nous ne ferons pas l’exégèse des querelles historiographiques concernant le régime de Vichy. La politique est surtout, chez Marcel Aymé, un prétexte pour peindre la condition humaine, un élément de décor qui permet de corser les situations et les dialogues, art dans lequel l’écrivain excelle. Ses personnages s’expriment avec simplicité, dans un vocabulaire du quotidien qu’on croit entendre jaillir de la bouche d’un Gabin ou d’un Bourvil1… (et qui sonnera aussi à la perfection dans celles de Depardieu et Marielle, interprétant Léopold et Archambaud dans l’Uranus de Claude Berri). Ce parler populaire où cohabitent une « gueule d’ahuri avec sa mine de papier mâché » et un « genre de Quasimodo abruti d’alcoolisme », a toujours maintenu une distance entre Marcel Aymé et ses pairs. Trop vulgaire et n’ayant jamais dénié s’associer à un mouvement littéraire, cet auteur à succès fut, de son vivant, boudé par les professionnels de la littérature et dix ans après sa mort, voué aux gémonies par l’historien Pascal Ory qui l’accuse, dans un article du Monde, de professer un « anarchisme du mépris, qui promène sur la condition humaine un regard dénué d’aménité et qu’agrémente un masque sarcastique ». C’est pourtant lui faire un mauvais procès que de reprocher à Marcel Aymé son mépris de l’humanité. À moins d’épingler également le cruel Flaubert qui s’acharne sur Charles Bovary et accable page après page Frédéric Moreau, dans l’Education sentimentale… S’il brosse un portrait de nos lâchetés, veuleries et autres bassesses déshonorantes, Marcel Aymé les pardonne aussi bien souvent. Ainsi, le grincheux Gaigneux, communiste peu aimable, perd ses moyens devant l’épaule rose d’une jeune fille, le vulgaire fils Monglat, indécrottable collaborateur rêve d’ouvrir un magasin de chaussures avec la même jeune fille ou le fanatique Jourdan, dans l’attente d’une nouvelle terreur révolutionnaire, confie dans une lettre ses angoisses à sa « petite maman chérie ».
Certains de ses lecteurs ont voulu lire Uranus comme une réhabilitation sournoise de Vichy, par l’intermédiaire d’affables personnages maréchalistes vers lesquels semble se porter l’affection de l’auteur. Pascal Ory, parmi eux, ne voit qu’« une dénonciation sardonique de l’épuration », là où Marcel Aymé se contente de décrire, avec un humour délectable, une époque cruelle envers les siens, quand eux ne sont coupables que de leur faiblesse et de leur manque d’héroïsme. Mais il semble que ses détracteurs ne lui pardonnent pas d’avoir publié pendant la guerre dans des journaux pro-allemands, bien qu’il n’y ait jamais manifesté de sympathie à l’égard du gouvernement de Vichy. Il y publiait des nouvelles ou chroniques plutôt anodines. Ils ne lui pardonnent pas non plus d’avoir milité, aux côtés de Jean Anouilh et François Mauriac, pour obtenir la grâce de Brasillach en 1945. Dans une émission de France Culture de 1991, Michel Lécureur, qui a préfacé et dirigé la publication des œuvres de Marcel Aymé à la Pléiade, prend la défense de l’écrivain, accusé de tous les maux (notamment celui de « manger à tous les râteliers ») par une journaliste faussement candide : « Si vous étiez charpentier ou marchand de vitre, vous pouviez continuer votre existence sans que cela touche à la politique. Si vous étiez journaliste, restaient que des journaux collabo. » Il fallait bien travailler, en somme. Et c’est au travail de Marcel Aymé uniquement que devraient s’intéresser ses lecteurs, à l’œuvre considérable qu’il nous laisse et dont Uranus est, sans aucun doute, l’une des pièces maîtresses.
« Ce qui est redoutable, ce n’est pas le bouillonnement des idées avec ce qu’il comporte d’erreurs et de confusion. Le vrai danger est dans la misère et l’asphyxie des esprits. » Marcel Aymé
1 Ils ont tous deux interprété des personnages de Marcel Aymé dans La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, adaptation cinématographique du Vin de Paris (1947).
- Uranus, Marcel Aymé, Folio, 1972 (première parution en 1948)
Solène Vary















