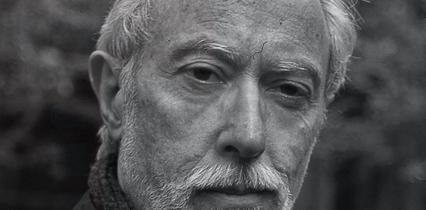Dans les salles confinées, les professionnels du spectacle continuent d’aller voir la création qui bout en sourdine. Zone Critique faisait partie des heureux élus au Théâtre Paris-Villette, pour un Massacre du printemps qui fait écho à nos « printemps inexorables » du moment.
Le deuil impossible
C’était un spectacle terriblement d’actualité, et qui aurait pu être tout ce qu’on cherche à éviter en allant au spectacle pour oublier la pandémie : une jeune fille voit décéder sa mère d’un cancer foudroyant, et apprend quinze jours après que son père souffre du même mal. Quoi de mieux pour couper l’herbe sous le pied d’une belle plante en plein printemps de la vie, et aussi pour nous mettre le moral dans les chaussettes en période de crise sanitaire ? Car tout y est : les bip-bip du cœur qui s’affaiblit, les blouses blanches, l’attente auprès du lit de la malade sous oxygène, les résultats catastrophiques. Et pourtant, et pourtant.
Que signifie la vie qui continue, à quoi peut-elle bien ressembler ?
Certaines choses résonnent évidemment très fort, mais surtout du côté des vivants, et notamment des soignants, nos héros du moment. Comment faire pour annoncer un décès quand on est encore inexpérimenté ? Forcément on se trompe, et on blesse. Faut-il aimer la douleur pour être infirmière ? Où est-on le plus heureux, en chirurgie ou en oncologie ? Comment évacuer le stress de la mort des autres ? Au centre de l’espace, un cube renferme tout le chagrin de la chambre d’hôpital en boîte noire déjà cercueil, que l’on peut murer à l’envi, et dont il faudrait abattre les parois. La boîte est posée là comme une cabane de jardin sur une pelouse synthétique dont le vert insolent est une gifle à tant de désespoir. Le spectacle tourne autour d’une aporie, l’impossibilité de parler du deuil et le besoin d’y mettre des mots même incongrus : que signifie la vie qui continue, à quoi peut-elle bien ressembler… Faire une lessive et planter des fleurs, ou se saouler à mort ? La parole circule mal entre tous ces encore vivants, chacun prisonniers de monologues rageurs qui ne se rencontrent pas.

Courir, courir
On troque la blouse blanche pour une robe à paillettes et des plumes d’indien.
Mais étrangement, rien de plombant là-dedans. Une énergie vitale court tout au long de la pièce, une beauté sauvage. Elsa Granat mène une bande de comédien.ne.s très homogène, sur un parcours que l’on imagine au moins partiellement biographique, sans jamais verser dans le pathos. Dans le rôle de la fille endeuillée, la performance incroyable d’Edith Proust la fait passer par toutes les étapes de la vie en l’espace de dix minutes, de l’enfant en plein caprice à l’ado en colère, la mère dépassée et pour finir, la vieille dame indigne – ma préférée. Il y a déjà tout ça en elle qui bout et qui déborde, tous les âges en attente de se révéler, et dès lors le temps n’a plus de prise, les corps le dépassent. On troque la blouse blanche pour une robe à paillettes et des plumes d’indien.
C’est une pièce terrible, mais terrible au sens du Petit Nicolas : terriblement vivante, qui fait pousser du courage dans le dos et donne envie, comme les comédiens, de sauter sur un trampoline, danser, chanter à tue-tête. Il y a trop d’espoir dans les sourires et les histoires du père, qui accepte tranquillement son destin, pour que l’on s’apitoie plus longtemps. « Il faudrait courir, courir ! » nous incite-t-il, simple et serein avec ses fleurs en plastique, et son sourire nous tord le ventre. Il ne faut pas le décevoir ! Si je me fie aux reniflements autour de moi, je n’étais pas la seule à cacher mon émotion derrière mon masque.
Depuis trop longtemps, nous ne pleurons plus ensemble au théâtre. A quand le printemps ?
- Le massacre du printemps, Cie Tout un ciel, mis en scène par Elsa Granat, dramaturgie de Laure Grisinger. Affaire à suivre