
Woody Allen a écrit un recueil de nouvelles… Et alors ? Rien de grave ! Dans Zéro gravité, le cinéaste �écrit comme un conteur farceur ; son recueil ressemble à la retranscription d’un one-man-show où l’absurde se goûte en toute légèreté pour réjouir l’esprit.
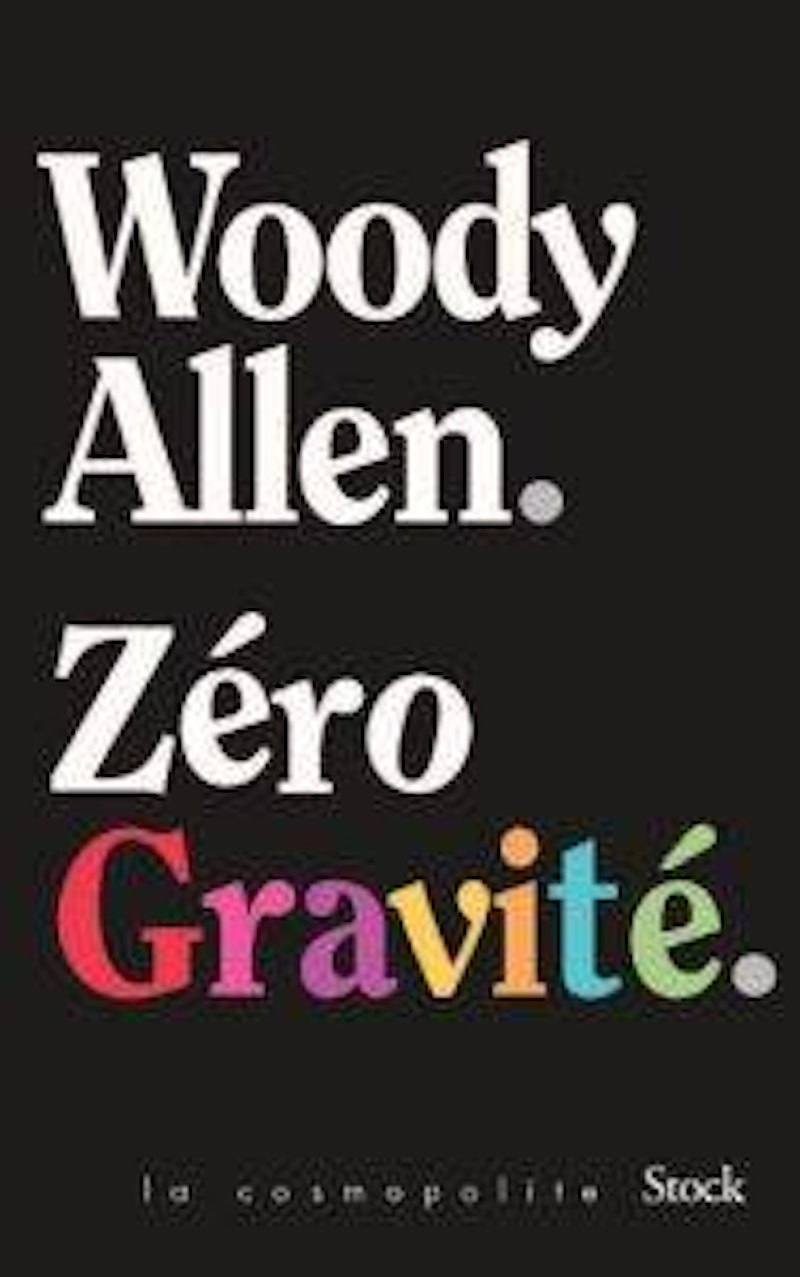
Génial que celui qui aime observer les gens fasse des films, tout aussi génial qu’il nous livre des nouvelles ! Woody Allen nous livre Zéro Gravité, aux éditions Stock, un recueil de quelques 19 nouvelles dont certaines avaient été publiées dans le New Yorker. On est ici pleinement dans l’univers du réalisateur, on baigne dans Manhattan, le jazz, la littérature, la judéité, la sexualité, le vin, la France… On est surtout immergé dans sa phrase, son bavardage à plusieurs caudalies, où le propos en l’air, tout léger, vient d’abord piquer l’intérêt, puis exploser en tête tel un feu d’artifice au départ précoce et, au final, se déposer profondément en nous tantôt en ironie mordante, tantôt en mélancolie joyeuse. La première nouvelle et la plus longue, Vivre à Manhattan, est sans doute la plus cinématographique. Le narrateur est comme la voix off qui introduit souvent ses films pour camper le décor. Cela raconte une histoire d’amour de deux êtres bavards qui croient se correspondre comme deux âmes sœurs car ils partagent le même regard sur le monde… et cela chemine jusqu’au gouffre qui les sépare radicalement. Les nouvelles qui suivent sont plus courtes et rocambolesques, l’absurde s’y déploie à cœur joie. L’une d’elles extrapole une partie de Monopoly dans la vraie vie, une autre raconte comment un cheval est devenu un peintre coté, dans d’autres on découvre des vaches tueuses, on est plongé dans la tête d’une voiture trop futée, on applaudit des poules chanteuses, on compatit devant des êtres réincarnés en homard…
Le point commun à tout ça ? L’absurde. Dans la première nouvelle, les deux amoureux se retrouvent car ils voient la vie pour ce qu’elle est : une gigantesque absurdité. Et tout le reste n’est que petits arrangements de l’être profond avec cette absurdité, avec la vie. C’est comme si ce point commun de départ identifié par les protagonistes de Vivre à Manhattan allait devenir le projet du recueil. Absurdité pour absurdité, Woody Allen décide de s’y vautrer. Il sera Kafka, mais un Kafka joyeux. Comme pour le beau, voir l’absurde procède d’une conversion du regard et la prose du cinéaste opère avec efficacité. La meilleure façon de prouver que le monde est fou est sans doute de se faire passer pour fou avec le même langage de rationalité employé par ceux qui épousent la marche du monde.
Le cinéma, bien sûr, est omniprésent, soit comme évocation, soit comme sujet, soit comme procédé narratif.
« Et soudain, il y a une étincelle. Ou alors ils imaginent qu’il y a une étincelle. » Le cinéma, bien sûr, est omniprésent, soit comme évocation, soit comme sujet, soit comme procédé narratif. Woody zoome sur un nombril en permanence, et place le monde dans le hors-champ pour mieux engendrer le sien. Il transforme l’artifice pathétique en détail-clé de ses histoires. Et ses chutes sont des pieds de nez car il n’y a aucune fin hollywoodienne qui tienne. Hollywood, voici en creux de quoi il se moque en permanence. Une série de nouvelles ressemble à un concours de scénarii : imaginez seulement des souris cambrioleuses ou un biopic où Windsor est obsédé par les nœuds de cravate… Il affiche ainsi son incapacité à proposer un cinéma blockbuster, mais si ce n’est pas hollywoodien, c’est clairement woodyallenien.
Le one man show woodyallenien
Woody Allen est un conteur farceur, il raconte en toute légèreté pour nous laisser entrevoir une profondeur qui nous est propre. Il manipule l’humour juif bien sûr, cette autodérision de l’être élu face au tout puissant. Il suffit qu’il décrive un « minus baraqué comme un asticot, myope derrière des carreaux à monture noire, et vêtu à la pequenaude » pour que l’on reconnaisse notre auteur. Woody convoque aussi l’humour anglais, qui permet de rire de la noirceur et de l’absurde. « Quel cruel destin d’être délicieux, d’être présenté en plat du jour. » se disent les deux hommes réincarnés en homard. Mais il ne s’arrête pas là, car on identifie clairement un esprit français propre à Molière, cette capacité à n’être jamais dupe de rien et surtout de soi-même, à ne rien nier de la tragédie tout en riant de ceux qui la vivent avec trop de sérieux. Mais il y a aussi du La Fontaine ! Avec ses vaches tueuses, ses poules chanteuses, ses souris voleuses, ses homards mordants, il nous offre un bestiaire rappelant l’anthropomorphisme des fables. Qu’on se le dise, Woody Allen est un cumulard d’esprit.
Woody Allen prouve la possibilité d’être bavard, nous offre l’exercice dans lequel il excelle : verbaliser et donc caricaturer le marécage intérieur de l’être. L’ironie s’exprime toujours de façon naïve pour mieux faire son nid. Pour accrocher des images, il a une langue, un véritable argot même : « Nagila piqua un fard et se mit à émettre des bruits similaires à ceux d’un flipper juste avant de tilter. » Et ce n’est pas fini, car il ose et abuse de jeux de mots. C’est certain, il aurait pu faire des tournées avec ses sketchs comiques tordants. C’est ainsi qu’avec les nouvelles les plus absurdes, nous basculons franchement dans des sketchs à la Raymond Devos. Dans le one-man-show qu’il nous offre, les jeux de mots apparaissent comme la diversion opérée par le magicien avant le tour de passe-passe. Le tour dans chaque nouvelle est la pirouette qui permettra de poser le point final à une histoire sans queue ni tête. Les jeux de mots viennent parfaire l’argot de Woody, et comme chez Devos, transformer le comique en poète.
Merci au « petit cafard insipide sans style ni distinction, falot et terne comme un fromage à pâte molle » de nous avoir régalés. Ses nouvelles sont certes inégales, mais offrant une distraction intelligente, où la légèreté nous fait renouer avec l’esprit.
- Zéro Gravité de Woody Allen, Stock, 2023
Crédit photo : Zéro Gravité de Woody Allen © Adam Bielawski

















