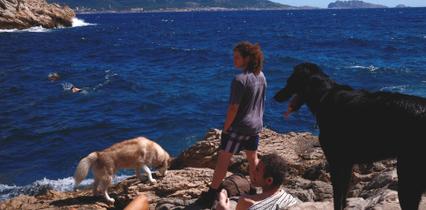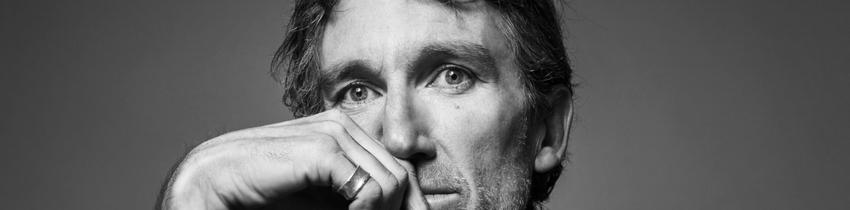Écrivains impuissants face aux blocages, voix publiques sous pression, engagement sincère ou posture opportuniste: nous avons interrogé François Bégaudeau sur les illusions autour du rôle des auteurs dans les luttes sociales. Pour lui, la responsabilité n’incombe pas à la «caste littéraire» mais à toutes celles et ceux dont la voix porte dans l’espace public. La vie étant toujours plus rapide que l’écriture, il affirme qu’aucune tâche spécifique ne revient à la littérature en tant que telle, si ce n’est d’écrire après coup – quand la bataille est déjà passée.
Jasmin Mandola :Chaque corps de métier dispose, en théorie, d’un moyen concret de bloquer ou ralentir le pays. Selon vous, les artistes (et en particulier les écrivains) ont-ils un tel pouvoir? Si oui, lequel? Sinon, est-ce un problème?
François Bégaudeau : Dans ce domaine les écrivains sont encore les cancres. Les travailleurs.euses du spectacle vivant peuvent perturber des spectacles ou des manifestations culturelles sur lesquels il y a de gros investissements et de gros retours sur investissement. L’annulation du festival d’Avignon en 2003 sous la pression des intermittents en lutte fut un moment clé du mouvement. Mais 1000 écrivains s’entendraient-ils pour cesser d’écrire pendant un mois que personne ne s’en rendrait compte. Et s’ils poussaient la radicalité jusqu’à ne rien publier pendant un an, gageons que les éditeurs trouveraient vite à les remplacer en repêchant des manuscrits dans l’immense océan des refusés.
Est-ce un problème? Non. S’il y a un réel potentiel de blocage massif du pays, si des millions sont prêts à y aller, nul besoin d’écrivains. Ça n’est un problème que dans le champ littéraire, où les auteurs.trices sont quasi démunis pour s’opposer aux mutations en cours, et d’abord à l’accaparement du marché par quelques actionnaires réacs, que nous appellerons au choix des ré-actionnaires ou des réac-tionnaires.
J. M. : Dans un contexte de blocage national ou de grève générale, pensez-vous que les écrivains ont une responsabilité particulière de se positionner ? Ou bien le choix de la neutralité peut-il se justifier ?
F. B. : Ce n’est pas sur les écrivains en tant que tels que pèse l’éventuelle responsabilité de se positionner. C’est sur les gens que leur position sociale rend audibles. Cela concerne donc autant une chanteuse qu’un animateur radio en vue, un activiste connu, un footballeur, un streamer influent, un astronaute. Si Thomas Pesquet appelle demain au blocage, il sera aussi entendu et perçu comme légitime qu’Emmanuel Carrère (qui, rassurons nous, n’appellera pas au blocage).
Ceci étant posé, deux choses :
- À l’heure hyperdémocratique des réseaux sociaux, cette préséance des « personnages publics » est sérieusement entachée – puisque d’une certaine manière tout le monde est au moins potentiellement un personnage public.
- J’ignore s’il y a, pour les personnes dont la voix porte, une responsabilité morale à s’exprimer sur des sujets sociaux, politiques, etc. Je trouve même que certains devraient fermer leur gueule. Hier je tombe sur un entretien de Stéphane Guillon, un humoriste des années 2000, où il dit (en substance) que le 7 octobre on s’est rendu compte que la bête immonde était encore là, blabla, et ceci sans un mot sur les bientôt deux années de massacres de Tsahal à Gaza. Eh bien je me suis dit que ce monsieur aurait mieux fait de se taire ; que la décence lui aurait prescrit le silence.
On devrait donc penser cette affaire en termes moins moraux que techniques : pour ce qui me concerne, si on me donne la possibilité de m’exprimer, je le fais dans la mesure où je sens, à tort ou à raison, que j’ai quelque chose d’intéressant à dire.
J. M. : Dans votre propre pratique, que seriez-vous prêt à mettre en jeu ou à interrompre (publication, interventions publiques, travail en cours…) pour prendre part à un mouvement social ?
F. B. : Prendre part à un mouvement social n’est pas un lourd sacrifice – j’espère d’ailleurs que ce n’est pas un sacrifice du tout, et qu’on s’y jette parce qu’on y trouve un surcroit de joie.
Eventuellement, on y sacrifie du temps. C’est d’ailleurs pour consacrer mon temps à l’écriture que je me suis finalement assez peu impliqué dans la vie politique réelle (les mouvements sociaux, les initiatives alternatives, la vie associative).
Reste une question de type grec : serais-je prêt à suspendre mes travaux un an pour me consacrer corps et âme à un mouvement social ? À priori, et contre toute attente, je dirais que oui, parce qu’un mouvement social qui dure un an est un événement, et incidemment un événement esthétique.
J. M. : Historiquement, certains écrivains ont été des relais ou catalyseurs pour des luttes sociales. Quelles sont les figures qui vous inspirent ?
F. B. : Les figures politiques qui m’inspirent sont plutôt des activistes à plein temps que des écrivains relais. Des gens comme Emma Goldman, Tosquelles, le sous-commandant Marcos. Et il faut y insister : si des écrivains se sont parfois retrouvés dans le feu de l’action (Vallès pendant la Commune, Hemingway, Orwell ou Weil contre le franquisme en Espagne, etc), ce n‘est pas en tant qu’écrivains. C’est en tant que citoyens politisés et soucieux de justice, et en tant qu’individus qui trouvaient dans la lutte une exaltation. Il n’y a pas de tache spécifique des écrivains dans les luttes. Si ce n’est d’en tirer des livres – mais par définition les livres arrivent après la bataille et donc n’y auront pesé d’aucun poids.
Ici je ne résiste pas au plaisir de citer la fameuse page 76 de Catapultes sans s, l’autobiographie de Guillaume Will : « Un écrivain qui achète un paquet de cacahuètes dans un Monoprix ne l’achète pas en écrivain. Un écrivain qui se mouche ne se mouche pas en écrivain. Il ne passe pas l’aspirateur en écrivain. S’il est marié il ne passe pas l’aspirateur. »
Quand il s’exprime sur le contexte social, les nouvelles pratiques touristiques, le Covid, ses goûts en tapis de douche, il ne s’exprime pas en écrivain, même si l’intervieweur l’a présenté ainsi et mentionnera son dernier roman sur le générique de fin. Du reste s’il parlait de son dernier roman, ce serait pareil. Même s’il parle de ses écrits, le locuteur n’est pas l’écrivant.
Il y a certes une continuité plus nette entre le roman L’Assommoir et la tribune J’accuse qu’entre L’assommoir et un tapis de douche. Les deux sont écrits. Le talent de plume intervient dans la prose de J’accuse. C’est davantage en homme politique qu’en poète que Hugo s’en prend à Napoléon le petit, mais il le fait avec sa verve légendaire, sa virtuosité rhétorique. « Cet homme ment comme les autres hommes respirent », c’est si bien envoyé que la langue usuelle d’aujourd’hui s’en souvient.
Reste que la rhétorique n’est pas la littérature. L’art oratoire n’est pas la littérature. N’est même pas une sous-branche de la littérature. Est le contraire de la littérature, qui s’écrit contre la rhétorique. Sinon il n’y aurait pas tant d’écrivains ratés, ou d’académiciens c’est tout comme, parmi nos présidents de la République. Tu échoues en écriture, tu réussiras en politique. Ta faiblesse dans un domaine – verbe haut – sera une force dans l’autre.
J. M. : Une parti...