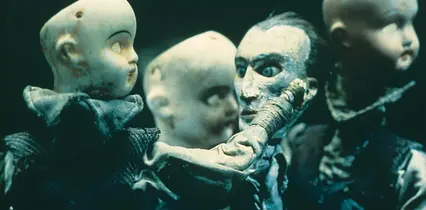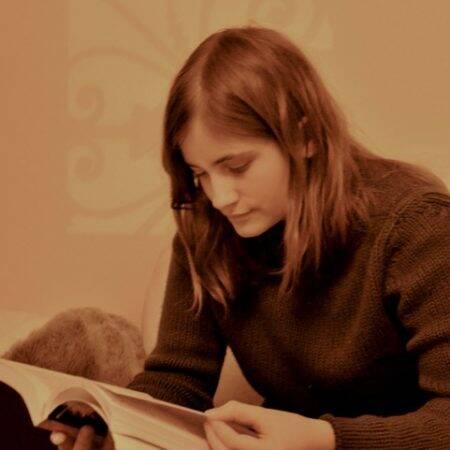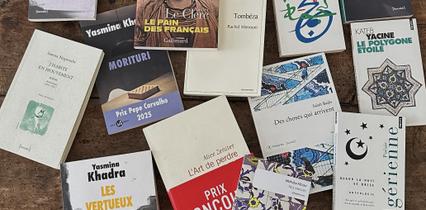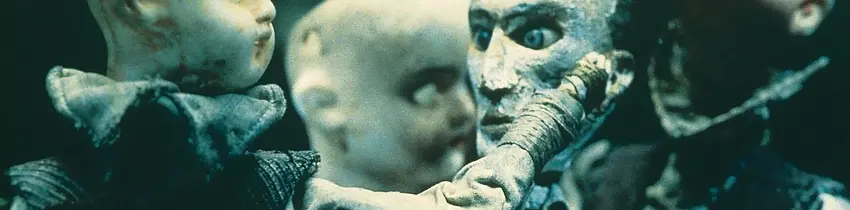Depuis quatre ans déjà, Zone Critique rend compte du Cinéma du Réel, grand rendez-vous du cinéma documentaire affranchi et radical. Cette année, nous souhaitions quitter la forme journalistique pour prendre davantage le temps, ne pas courir à la critique mais faire mûrir les réflexions et les envies, être dans le moment. Après une semaine à parcourir les salles du Quartier latin, voici nos regards et nos notes sur le festival, ses films, ses cinéastes et ses ambitions.

Cette semaine, une horde de jeunes – et moins jeunes – cinéphiles bloquaient le passage devant le cinéma l’Arlequin, dans le 6e arrondissement de Paris. Massés en petits groupes, on y discutait programmes, projections à venir et possibilités de dégoter des places pour la trilogie Jeunesse du documentariste star Wang Bing, dont deux des films étaient diffusés en avant-première. Des attroupements similaires s’apercevaient au Christine, au Saint-André-des-Arts et au Reflet Médicis, s’agglutinant sur la chaussée, signe d’un festival vivant et ayant gagné, en quittant le Centre Pompidou, pignon sur rue.
Tel était le mot d’ordre de cette 47e édition : rendre le documentaire visible dans l’espace public, attirer de nouveaux spectateurs, faire émerger de nouvelles réflexions. Fidèle à lui-même, le festival a laissé une grande place aux interrogations en tous genres et aux œuvres de toutes formes, se faisant le flambeau de la diversité et de la liberté du cinéma documentaire. Cette exigence, au cœur de l’identité du Cinéma du Réel depuis ses débuts, se voit renouvelée chaque année par sa programmation attentive et engagée. Avec la volonté de mettre en lumière ceux qui font vivre ce festival et lui donne toute sa singularité, Pauline Ciraci a rencontré Catherine Bizern, directrice artistique du Réel depuis 2018. Un entretien réalisé en amont du bouillonnement festivalier, pour parler du sens de cette édition, de l’équilibre précaire des festivals en France et de la capacité d’action du documentaire et des cinéastes face à l’affolement du monde. Que faire ? Pourquoi faire ? Que peut-on face aux évènements, face à l’histoire ?
Ces questions infusent little boy de l’américain James Benning, Grand Prix du Réel 2025. Dans ce documentaire au dispositif très simple – des enfants peignent des maquettes sur fond d’archives audio qui tissent en filigrane l’histoire des États-Unis –, les prémisses sont aussi paralysantes que révoltantes. Rien n’a changé, tout doit changer. Les deux longs-métrages Yvon et Evidence, relatés ici par Margaux Lefèvre, travaillent aussi la matière de l’héritage empoisonné, qu’il soit dans le corps irradié d’un ancien ouvrier nucléaire ou dans l’éducation transmise à sa fille par un père conservateur et chantre de l’industrie pétrochimique. En jetant un regard sur le passé, ces documentaires déploient une écriture sensible qui trace les contours d’une intimité universelle.
Au cours du festival, de nombreux cinéastes sont venus présenter leur film. Sylvain Métafiot nous propose de prolonger ces instants de discussion à travers deux interviews, l’une avec Anouk Moyaux, réalisatrice de Selegna Sol et l’autre avec Sophie Bredier, créatrice de Lumière de mes yeux. Dans ces deux films géographiquement opposés, l’un traitant du dilemme à quitter les États-Unis pour retourner vivre dans son village natal au Mexique, l’autre suivant le parcours de l’égyptien Mahmoud Abdelfattah venant faire soigner son visage attaqué à l’acide en France, la reconstruction prend des significations différentes.
Dans Lumière de mes yeux, la réalisatrice Sophie Bredier ne comprend pas l’homme qu’elle filme et qui ne la voit pas. Comment un lien peut-il se tisser quand il n’y a ni langue commune, ni contact visuel ? Diogo Serafim se propose justement d’interroger la distance entre le sujet et l’auteur dans un article balayant du regard un certain nombre des films présentés au Cinéma du Réel. À quelle distance poser la caméra pour faire en sorte de capter et de transmettre le réel, ou un bout de réalité ? Au cours de cette dernière semaine, les propositions ont été multiples, éthérées, brutales, pudiques ou voyeuristes, jouant du hors-cadre ou préférant le gros plan. Au spectateur maintenant de les faire siennes.