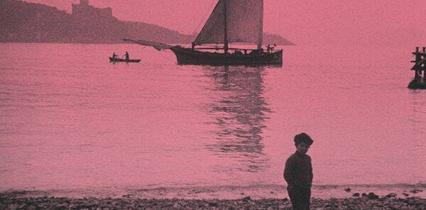Zone Critique revient aujourd’hui sur le deuxième roman, Jacob paru aux éditions Gallimard, de Simon Berger, un jeune écrivain talentueux issu de l’ENS où il étudia la philosophie. Derrière une intrigue assez classique, la rencontre entre un homme cultivé et un jeune bohémien, le livre intrigue par son style et les questions qu’il aborde avec finesse, qu’il s’agisse d’éducation, de grâce ou encore d’amour.
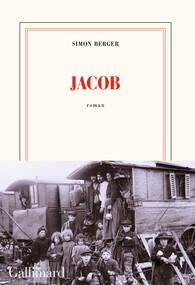
Ces oiseaux, là, l’auteur peine déjà à les nommer. On a pu dire que la terre ne mentait jamais. Itinérants, les gitans n’en possèdent pas. Ils sont cependant hommes de parole. Pour Simon Berger, la vérité n’est pas toujours dans la terre mais dans l’état civil : « ils étaient du peuple de ton père et de ta mère ; de ce peuple qui se donne pas de nom – on lui en a trop donné – de ce peuple qui vit de n’avoir pas de nom, de n’avoir pas de sol ; de ce peuple antique et fugace ». Romanichels, fils du vent, gens du voyage… le peuple accumule les dénominations poétiques pour mieux échapper à la taxinomie : « ils étaient tout ce qu’on voulait bien dire ».
Cet enfant, Jacob n’est pas celui de la Bible mais son nom le prédestine semble-t-il à quelque chose. Sa beauté fleurit aux premières pages sans pourquoi. Sans plus de pourquoi, le curé décide qu’il fera – lui le bohémien- sa communion en pleine cathédrale, le coin des nantis, sous le regard de tous les hommes en blazer de Clermont. L’un d’eux, Joseph le repère, veut lui offrir une chance et propose à sa famille d’assurer son éducation moyennant 100 francs par mois. La famille accepte.
L’éducation
Au cœur de l’amitié entre ces deux hommes se trouve le désir d’élever – et non seulement éduquer – en offrant au jeune des sentiments plus hauts, plus délicats.
Aussitôt, Joseph paraît bon éducateur. Sa naissance bourgeoise n’a pas terni la générosité de son âme – elle en a sans doute cultivé la superbe. Animé des meilleures intentions, il se prend d’amitié pour le bohémien. Une amitié faite d’un dévouement tout entier et voué à élever ce jeune élève ; convaincu qu’il suffira pour l’aider de placer un adulte intelligent et bien éduqué à ses côtés. Joseph veut convaincre Jacob de rejoindre le monde – ou demi-monde – de la moyenne bourgeoisie provinciale. Il lui consacre du temps, de l’affection même, le corrige quand cela est nécessaire, lui met des livres entre les mains, lui apprend aussi tous les codes de sociabilité qu’il ignore. En chrétien, il cherche à incarner dans ses gestes le souci du plus pauvre – peut-être inspiré par ce verset du magnificat : « il élèvera les humbles, et abattra les puissants de leur trône ». Élever donc – et non seulement éduquer – en offrant au jeune des sentiments plus hauts, plus délicats. Joseph est un bon mentor. Il pourrait aussi être un bon père – à défaut d’avoir seulement été un géniteur car Joseph est vieux garçon.
Et précisément, tel qu’il se révèle à nous au fil des pages, son attachement à Jacob n’est pas tout à fait l’amour paternel. Joseph, n’est pas insensible à la beauté, rappelons-le indécente, de l’enfant dont il a la charge. Derrière l’éducateur, se cache l’amoureux transi sans que ce sentiment inavouable ne s’autorise jamais un geste ni même un mot un peu trop affectueux ou déplacé : « il ne viola pas, jamais il ne viola l’intimité de ta chambre. Il ne passait pas le seuil sacré, la limite qui ne se franchit sans purification préalable. Il se serait senti indigne ; non à distance il te rêvait ». Sa retenue est admirable – et si elle ne l’était pas, elle paraîtrait dans une telle situation monstrueuse. « La part de ténèbres n’excède pas ce qui est normal dans une passion » nous rappelait déjà Montherlant. Le personnage conserve une certaine grâce et n’en aurait de toute façon aucune s’il laissait en lui s’épanouir quelque désir terrible pour cet enfant.
Comme ses gestes, son discours est retenu. Devant la famille de son protégé, c’est en des termes choisis et formels qu’il « propose » et « s’engage à » assurer l’éducation de Jacob : « en deux ou trois ans, je vous promets d’en faire un honnête homme. Je connais du monde ». « Les conditions matérielles sont-elles favorables à l’épanouissement de Jacob ? » demande-t-il, plein de sollicitude. L’offre est généreuse. Elle est d’une certaine façon humiliante pour la famille bohémienne : assurer l’éducation d’un enfant, c’est laisser entendre qu’elle a été jusqu’à présent négligée.
L’ambitieux projet d’en « faire » un honnête homme exclut du même coup celui que Jacob a été comme celui qui – charnellement – a « fait » Jacob et signé son état civil. Le père putatif aimerait qu’il n’y en ait jamais eu d’autres : « Joseph Desmarnénens ne parvenait pas à ignorer le spectacle auquel présentement tu tournais le dos, cette armada de roulottes où passaient des yeux torves, des spectres matis, comme rouillés de désespoir, au milieu de la crasse et d’une apparence de vomissure ». La famille de Jacob réagit mal. Les maladresses s’accumulent. Simon Berger raconte les humiliations symboliques dont Jacob est victime et qu’il finira par ne plus supporter. Et la suite amorce un dénouement que l’on devine dramatique.
La table rase éducative
Le récit s’attarde sur la manière dont des images confuses, simples, anodines, nous édifient.
« L’enfance est ce temps très court où la créature est sans syntaxe » écrit l’auteur. Sans langage articulé, l’enfant sait pourtant rapidement voir. Le tutoiement narratif est formel : « tu ne saurais dater ce souvenir, et pourtant tu as la conviction que c’est le premier ». Le récit s’attarde sur la manière dont des images confuses, simples, anodines, nous édifient. Si pour Descartes, « nous avons tous été enfants avant que d’être hommes » , le Jacob de Simon Berger a été humain dès ses premiers moments sur terre. Il a été sensible, intelligent, doué de mémoire… ses premières images impriment déjà en lui quelque chose dont il ne pourra se défaire. L’éducation cartésienne invite à nous défaire de notre crédulité originelle et juvénile – comme de nos origines. On comprend pourtant que l’enfance comme le lieu d’où l’on vient comptent pour Simon Berger.
Et cela aurait aussi compté si les notables de Clermont s’étaient intéressés à l’enfant qu’avait été Jacob avant de vouloir en faire un homme. Mais Joseph se méfie des gitans. Comment a-t-il pu s’attacher autant à l’un d’entre eux ? Joseph peut-il aimer la plénitude de son être alors qu’il aimerait en retrancher les premières années de formation que la voix de l’auteur fait décisives ?
Un regard a suffi pour allumer en lui un feu – mais un feu qui brûle plus qu’il n’éclaire. Sa passion prend la forme d’une sollicitude dévorante et possessive. En pleine Cathédrale, quand Joseph a pour la première fois aperçu Jacob et remarqué la finesse de ses traits , un coup d’œil avait suffi. Le « Ce fut comme une apparition » de l’Education Sentimentale devient chez Simon Berger « il se passait quelque chose comme si Joseph Desméniens assistait , en personne à la transfiguration ». Aussitôt Jacob fut aimé. Moins qu’une âme ou un être, il est probable que Joseph n’ait aimé en lui qu’un visage. Et l’amour paternel -comme l’amour chrétien- n’est pas un amour des visages.
Et derrière ce visage, sans doute une figure. Jacob est enfant comme l’était l’enfant Jésus : « tu étais révélé au seuil d’un champ de désespérance, le corps, l’antique corps glorieux. La lumière qu’émanait ce corps submergeait, emportait tout » Son corps de gloire est objet d’attention, d’admiration… la bonne société de Clermont voit aussi en lui une figure rédemptrice. Les hommes en blazer se félicitent d’avoir au moins pu sauver un malheureux gitan et d’avoir pu l’élever de sa fange pour lui accorder un peu de lumière. Flamines d’une version républicaine et (à peine) laïcisée du paulinisme, leur projet reste de faire « un homme nouveau » en le sauvant – non pas du péché originel mais de son origine sociale. ; et d’ailleurs sauver moins son âme que son avenir dans le monde.
Le livre captive alors que son intrigue n’est pas très originale – et son dénouement assez prévisible. L’intensité ne se révèle pleinement que dans les dernières pages. Le style est là pourtant. Entre Michel Butor et la dernière scène du Truman Show, c’est une voix narrative surplombante qui tutoie – même quand elle pontifie ou sermonne. La fatalité n’est jamais loin, ne serait-ce que par la forme de l’ouvrage – resserrée en 130 pages – y est pensée peut-être calculée et assez étroite pour que notre regard soit pris en tenaille et contraint de voir ce qui s’arrête à ses propres limites et qui parfois nous échappe. Pas de sortie possible ou d’échappée belle. Pas moyen non plus de refermer Jacob sans songer un instant à autre chose. Le sujet est difficile, il pourrait virer au monstrueux pour de pareilles tentations mais les personnages ont tous assez de générosité et de grâce pour éviter le scandale. L’auteur est assez intelligent pour ne pas tomber dans ce genre de panneau.
Au contraire, leur faiblesse ou leur tentation inavouable les humanise ; la résistance qu’ils y opposent les grandit aussi. L’identification est permise : nous sommes comme Jacob entre plusieurs mondes, parfois plusieurs espérances. Nous pouvons être aussi comme Joseph, le nez dans l’écueil d’espoirs déçus ou d’une générosité hypocrite qui se dit éducatrice. L’un et l’autre sont en nous et racontent notre histoire intérieure.
Bibliographie :
Berger, Simon, Jacob, Gallimard, 2021.