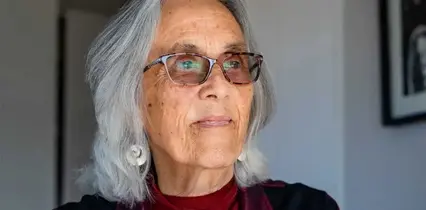Dans son dernier livre, L’Arche Titanic, publié aux éditions Stock, Éric Chevillard prend le prétexte d’une nuit passée au Muséum d’histoire naturelle pour évoquer de manière forte, intelligente et pleine de verve, le rapport de l’homme à la nature – alors que nous vivons la sixième extinction de masse des animaux.
Un récit de notre dévastation

Pourquoi cela ? L’énigme trouve rapidement des éléments de résolution : entre la salle des espèces disparues et la Grande Galerie de l’évolution s’étendent quatre niveaux pour deux étages et un sous-sol, qui font penser à un paquebot en déperdition. Ne s’agit-il pas là d’espèces n’ayant plus d’existence vivace, dont nous ne conservons qu’ici les traces ? Et ne sont-elles pas aux portes de cette galerie, les nombreuses autres espèces qui vont bientôt disparaître (quand ce n’est pas déjà fait) au vu de la sixième extinction de masse actuellement en cours ?
Il s’agit bien en effet d’une Arche de Noé qui a déjà commencé à couler, et qui va sombrer totalement en emportant une bonne partie du vivant. Noé sombre, noué. Cela, Chevillard le suggère lui-même, non sans une certaine verve langagière teintée d’humour : « Je tiens le responsable. Je l’ai dans mes souliers. Je l’ai solidement lié avec ma paire de lacets. L’exterminateur, le pollueur, le forestier pyromane. L’homme qui ne sait plus nommer le monde. L’homme qui le débaptise. La sixième extinction massive, nous le savons, est celle dite de l’anthropocène, l’ère de l’homme./ Triomphe de notre ingéniosité, nous sommes devenus égaux, en termes de dévastation, […] aux plus violents des cataclysmes. » Car le Muséum d’histoire naturelle n’est pas le lieu où le vivant revit, il est le témoignage de naufrages. L’auteur souligne l’étrangeté du verbe « naturaliser » : empailler un animal, est-ce vraiment le rendre lui rendre son caractère naturel ? La nature – et donc chaque fruit que nous croquons – est-elle rembourrée de paille ?
L’Arche Titanic devient en effet un élément de mise en abyme : « Car ce sont bien des morts qui m’entourent, ces beaux animaux. Plus encore, pire encore, ce sont des fantômes morts. Imaginez le degré d’anéantissement./ Des revenants revenus de tout. »
« Ani-mots »
On l’aura remarqué dans les passages cités, Chevillard joue sur les mots. Il fait preuve d’une grande inventivité langagière et utilise des formules qui nous frappent d’étonnement et d’exactitude. La question des mots hante ce livre – les mots, tels des animaux, disparaissent avec certains d’entre eux –, car ce qui n’existe plus ne paraît plus utile, et sans actualité ou performance le vocable s’évanouit. « […] quand une chose n’existe plus, elle ne peut plus être nommée que par une périphrase. »
La question des mots hante ce livre – les mots, tels des animaux, disparaissent avec certains d’entre eux –, car ce qui n’existe plus ne paraît plus utile, et sans actualité ou performance le vocable s’évanouit
L’auteur évoque aussi l’apparition du Verbe, auquel est associé dans notre culture l’apparition de tout ; il précise cependant que ce mythe met en avant la centralité de l’être humain (contre celle des animaux) ; l’intelligence qu’est censée lui apporter le langage se transforme en « baratin performatif : [l’Homme] assèche ou inonde, lève des terres ou les tasse, il sème ou il déboise. Rien en l’état ne lui convient jamais. Le monde ne s’ajuste pas à son rêve, mais la notice de son taille-haie est traduite dans toutes les langues. »
Ce livre s’intéresse aussi au lien entre littérature et animaux. Après avoir constaté que ces derniers n’étaient que peu mis à l’honneur dans la littérature, Chevillard souligne que lors de l’empaillement d’un animal, ce n’est pas toujours la paille qui a été utilisée, mais aussi parfois toutes sortes de choses, dont du papier. Ainsi, « Tout livre n’est-il pas une bonne farce ? »
Par ailleurs, pour parler de ce qui en littérature peut impulser une réflexion sur les animaux, il commente entre autres un texte de H. G. Wells, « L’île de l’æpyronis », concernant cette espèce disparue (un « texte naturalisé » par les soins de l’auteur, puisqu’il nous le restitue avec des morceaux d’origine)… ce qui ne l’empêche pas de mentionner lui-même plusieurs animaux de son invention, comme l’escognette et l’alongue (sans compter quelques mots forgés discrètement ici ou là – nul n’est maître de son cheptel, et qui se plaindrait de le voir ainsi s’agrandir ?). Inventer, donc, des animaux pour conjurer le sort ou entretenir l’espoir, comme cela arrive lorsque nous découvrons des espèces encore non répertoriées, ou bien le spécimen d’une espèce que nous croyions totalement disparue.
Le chant de l’impermanence
Toutefois, c’est bien le thème de la perte qui l’emporte, malgré la puissance langagière de l’écrivain. À propos des animaux empaillés, il affirme : « La vie n’a pas quitté ces morts. » ; avant d’ajouter : « Ces grands animaux statufiés, figés dans leur cuir comme des pâtés en croûte, bougent encore. […] Ça s’active même sacrément./ Les parasites sont à l’ouvrage. Ils dépiautent ce qui fut si patiemment cousu. Même une bête naturalisée il y a trois siècles excite leur appétit. » L’apparente conservation de ce qui n’est qu’un souvenir des espèces disparues est en conséquence elle-même menacée. Cela ne fait que renvoyer l’Homme à l’impermanence de toute chose, et à sa solitude à venir.
La légèreté de Chevillard n’amoindrit pas ce constat. Les animaux sont presque empaillés vivants : « Sur les plages s’échouent des baleines et des dauphins farcis de plastique. Dernier rembourrage à la mode./ Tu trouves dans ton poisson un sac pour l’emballer./ Pratique. » Rasons-nous les forêts pour nous procurer « la paille nécessaire pour naturaliser avant leur disparition les animaux sylvestres que cette déforestation condamne. » ? Doit-on enfin se contenter de l’éléphant en en contemplant l’exemplaire inanimé : « La peau vernie du pachyderme est tendue sur une espèce de tonneau, cela nous choque un peu aujourd’hui mais ne fit pas barrir les barriques. » ?
La légèreté de Chevillard n’amoindrit pas le constat de l’impermanence de toute chose et de la solitude à venir de l’homme
Les propos en présence dans L’Arche Titanic se fondent sur une parole toujours renouvelée, tissant finement des liens avec la thématique : mentions de documents et sujets divers forment l’encyclopédie-monde d’une nuit.
En dehors de cette nuit muséale justement, Chevillard évoque un épisode surprenant de son existence (servant d’intermèdes dans le livre) où, au sortir de son sommeil, se réveillant dans une chambre d’hôtes, il reconnaît la pièce comme étant la chambre de son oncle et sa tante, peinte d’une autre couleur qu’à l’époque où il la connaissait. Il découvrira que cette maison de famille, vendue, a été reconfigurée par sa nouvelle propriétaire – une autre réflexion sur la perte, le changement, le passage d’un espace-temps à un autre.
Nous faisant circuler avec lui de lieu en lieu, de mot en mot avec force, l’auteur nous permet de naviguer avec un plaisir inventif sur cette Arche Titanic, dont nous savons bien ce qu’elle est.
Certains affirment parfois que la littérature est engoncée, qu’elle n’a plus rien à dire, appartient déjà aux animaux disparus et empaillés. Ce à quoi je serais tenté de répondre par ce propos de l’auteur, que j’appliquerais au style de ce livre : « Je ne connais qu’un empaillé vif – le feu. » Si le papier a pu être utilisé pour l’empaillage, qu’est-ce qui l’empêche de devenir – tout vêtu de qualités littéraires – incandescent ? La vivacité brûlante s’imprime ici dans les mots qui, figés sur la page, bondissent.
Bibliographie :
Chevillard, Éric, L’Arche Titanic, éditions Stock, 2022.