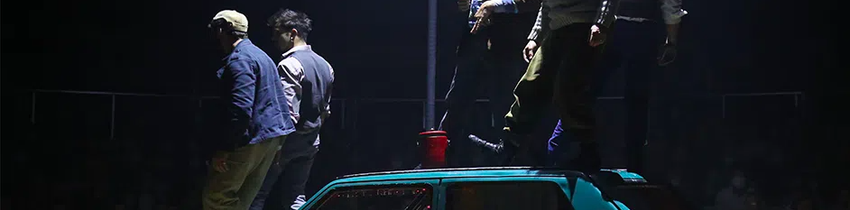Plus proche de l’œuvre originale de Fassbinder que « librement inspirée » de celle-ci, Peter von Kant rend un hommage enlevé à l’idole de François Ozon tout en faisant varier habilement le registre du film original, tirant Les Larmes amères de Petra von Kant du côté de la comédie grinçante.

Film gigogne
En faisant de Peter von Kant un cinéaste en pleine crise existentielle, Ozon lorgne clairement du côté du métafilm, qui consacre en même temps qu’il destitue l’idole. Peter, qui profite de ses films et de sa notoriété pour lancer la carrière de ses jeunes amants, renvoie ainsi à Fassbinder. Ozon pousse le clin d’œil jusqu’à attribuer au personnage d’Amir, le nom de Ben Salem, tête d’affiche du sulfureux Tous les autres s’appellent Ali (1974). Cependant, l’idée ne relève pas seulement de la coquetterie intellectuelle. En effet, Ozon transforme le récit tragique d’un rapport de domination à l’origine d’une chute en un ego trip. En d’autres termes, l’histoire saugrenue de Petra von Kant, qui s’abîmait en amour jusqu’à perdre la raison, est peut-être au fond le produit d’un fantasme narcissique, intimement lié au mécanisme cinématographique lui-même, c’est-à-dire à la projection des désirs à l’écran.
Ozon se demande si le cinéma ne vient pas brouiller les frontières entre le rêve d’amour et l’amour véritable
C’est d’ailleurs le sens de la séquence sur laquelle se clôt le film : Peter s’enferme dans sa salle de projection et contemple, ivre de douleur, les images d’Amir qu’il a captées lors de leur première rencontre. Il tend les bras dans un geste désespéré comme pour tenter de saisir un fantasme qui lui échappe irrémédiablement. De même, le choix de casting d’Isabelle Adjani en Fedora des temps modernes, relève d’une réflexion sur la star de cinéma. Adjani campe une vedette hystérique – le rôle lui va à ravir – et son interprétation participe du mélange des registres qui caractérise l’ensemble du film. Enfin, l’apparition d’Hanna Schygulla en mère bienveillante de Peter, qui fredonne une comptine en allemand pour l’endormir, donne au film, comme au dispositif de la mise en abyme, une jolie cohérence. En un sens, le déplacement de l’intrigue du milieu de la haute couture à celui du cinéma redonne toute sa portée à la situation de départ, puisqu’il n’est question que d’images dans Les Larmes amères de Petra von Kant. Alors que Fassbinder développait un propos sur les apparences, les faux semblants et la logique de l’illusion, Ozon se demande si le cinéma ne vient pas brouiller les frontières entre le rêve d’amour – le « bel amour » selon la formule de Peter, qu’il désire si ardemment – et l’amour véritable.
Dans le film de 1972, les tableaux de maître au fond du plan suggéraient un peu lourdement la fascination érotique pour un corps, qui tournait in fine à l’obsession cannibale d’un homme aux loups. Ici, la référence au Saint Sébastien de Mantegna permet de montrer comment Amir devient à la fois un martyr et un objet kitsch, un élément de décoration parmi d’autres, au même titre que Sidonie, dont l’inquiétant portrait trône au-dessus du lit. Plus encore, Ozon creuse la différence d’âge et construit l’opposition des personnages jusque dans les corps de ses interprètes. Amir est d’une jeunesse insolente puisqu’il n’a que vingt-trois ans. Sa beauté, mise en valeur dans une reprise de la scène de danse d’origine et accentuée par son reflet que l’on aperçoit dans un grand miroir, est presque intolérable. Par contraste, Ménochet, engoncé dans des chemises aux couleurs aussi criardes que les murs de son appartement, dodeline plus qu’il ne danse. Il inspire un dégoût profond qui culmine dans une scène de repas orgiaque au cours duquel on le voit sucer avidement des carcasses de crevettes. Autrement dit, Ozon fait le choix de la caricature et transforme aussi profondément le personnage de Karl qui n’est plus seulement un souffre-douleur mutique, mais aussi une silhouette famélique, hantant l’appartement de sa troublante présence.
Le rire de Petra
Ozon exploite les puissances du faux
Il était prévisible que François Ozon se réapproprie un film à la fois culte et kitsch, en allant plus loin dans l’impudeur. Ce faisant, il parvient à briser la rigidité de la forme théâtrale du film de Fassbinder, qui tenait à l’unité de lieu, mais aussi à la composition en tableaux et au style très écrit. Le dispositif, le texte et même la bande-son sont presque identiques, donnant ainsi l’occasion d’entendre à nouveau le très beau dialogue entre Sidonie et Petra, dans lequel il est question de l’idée d’amour et de conjugalité qui causera la perte de la protagoniste. Cependant, au lieu de recourir aux artifices théâtraux, Ozon exploite les puissances du faux à partir du registre comique. On peut considérer que la profondeur de l’œuvre de Fassbinder est sacrifiée sur l’autel du pastiche. Ou bien constater que ladite profondeur ne consiste pas tant en une exploration psychologique qu’en un portrait écœurant d’une bourgeoisie malade. La caricature ne vaut pas trahison dans la mesure où elle permet de rendre plus claire encore la pulsion possessive qui anime Peter/Petra. Il s’agit d’une pulsion réifiante, une pulsion de collectionneur, aussi esthétique que pathétique : elle remplit le vide sidéral d’une existence morne. C’est peut-être moins la logique mortifère d’un désir qui intéresse Ozon que la dissection méthodique des fantasmes d’une certaine classe sociale à laquelle appartiennent aussi bien Sidonie que Peter et sa mère.
Aussi troublant que son modèle, Peter von Kant se déguste comme une madeleine cinéphile. Un film n’en chasse pas un autre pour autant. Ozon réalise ainsi son rêve de fusion amoureuse et nous invite à prolonger indéfiniment la songerie.
- Peter von Kant, un film de François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani et Khalil Ben Gharbia. En salles depuis le 6 juillet 2022.