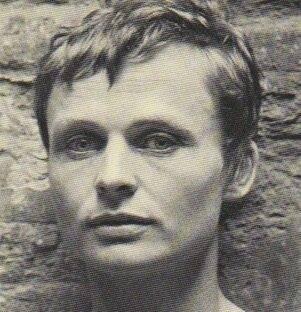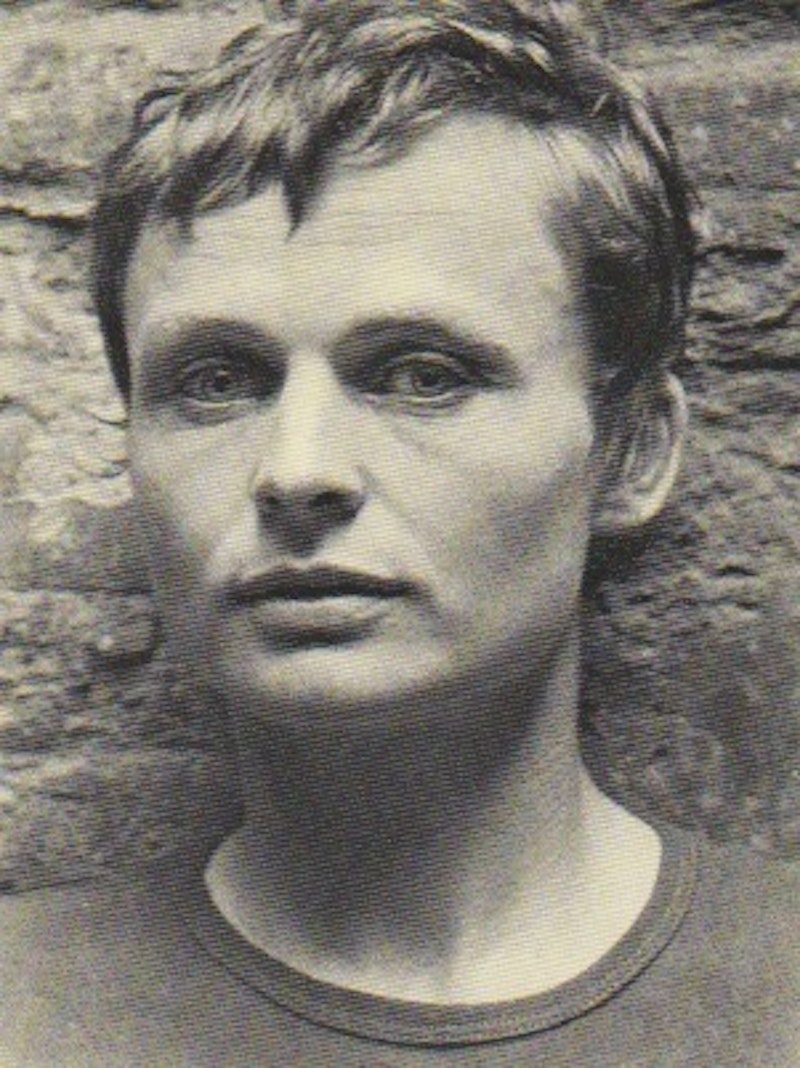
L’exposition Eve Gramatzki : destruction = construction au LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine de Dunkerque) permettra jusqu’au 18 septembre de (re)découvrir quelques œuvres de l’artiste germano-française. Une anthologie de textes critiques sur son travail est publiée à cette occasion aux éditions Méridianes.
Ce texte de Patrick Autréaux en est extrait.
Une œuvre est sans doute le plus allusif et contradictoire des témoins matériels d’un cheminement intérieur. Et de ce qui reste quand on n’y est plus, le plus hasardeux à interpréter, le plus mouvant peut-être de l’inconstant. Et c’est autant une œuvre qu’un parcours que je voudrais interroger ici.
L’écoute du travail d’un ou une artiste laisse venir à soi les mécanismes flottant qui l’ont réglé, les structures qui l’ont parfois dirigé. Lecture de l’informulé, souvent pour l’artiste même, qu’on entrevoit au-delà de l’explicite des œuvres. Silhouette d’un être, telle qu’il ou elle s’esquisse à la dérobée pour ce regard qui sait attendre de biais.
Un péril hante l’œuvre d’Eve Gramatzki et lui donne sa poignante singularité. Elle tentait de dire le rien, écrit-on. Le presque rien, serait-il plus judicieux de dire. Ou plutôt témoignait-elle de sa dangereuse ambivalence.
Un péril hante l’œuvre d’Eve Gramatzki

Un dessin émerge, emblématique, dans l’œuvre des débuts.
Empaumure trouée, un gant dresse sa face sans visage. La béance semble vivante en lui. Il est là qui fait le guet et menace comme s’il promettait une poignée qui risque de nous engloutir. Un regard fasciné et inquiet le dessine : plus qu’un gant, c’est l’implacable qui semble prêt à se réveiller et à fondre sur sa proie. Relique d’un fauconnier sadique et arbitraire : monde de l’enfance peut-être ou celui du dedans.
Le gant d’Eve Gramatzki fait naître l’effroi, malgré la beauté qu’apporte la précision presque mystérieuse du dessin. Il ranime des peurs anciennes : dévoration par l’ogre ou aspiration par le vide. Il donne sa forme à l’emprise sur nous de l’angoisse.
L’artiste racontait, et les proches à sa suite : c’est la fin de la guerre, le Troisième Reich s’effondre, elle a dix ans, les Russes sèment la panique, le port d’où la famille veut s’enfuir vient d’être bombardé, elle s’échappe de la foule et ramasse le gant d’un officier ; pour la remercier, il les fait embarquer avec son frère et son père dans le dernier bateau.
Des décennies plus tard, ce gant ressurgit. Souvenir d’enfance ou trauma exhibé par l’intensité du dessin : non plus réelle menace, mais menace de l’arbitraire du réel.
Pour l’apprivoiser peut-être, Eve Gramatzki en devient la servante, elle baisse ses yeux ardents, elle emprunte la voie des humbles. Torchons troués, semelle usée, mouchoirs chiffonnés, culottes abandonnées : elle dessine des débris textiles, autour desquels la précision réaliste élabore avec compassion sa clôture. Comme si le risque était moins grand à dessiner de très près. Les dessins de cette période sont dépositaires de quelque chose d’énigmatique : une monstrance dont la représentation est habitée par la ténacité d’un affrontement mais aussi par une amicale douceur.
Puis au fil des mois, les trames s’effilochent, les tissus se défont, les lignes se désorganisent, même si l’on suit la dérive des motifs géométriques ou des taches sur les linges. Pour éviter peut-être l’impasse où mène un réalisme à l’impénétrable arrière-boutique, elle s’engage sur la voie de l’abstraction. Et pendant quelques années, Eve Gramatzki tient la chronique de cette décomposition. Un de ses carnets indique l’équation ambiguë : destruction égale construction. Ce sera le mot d’ordre de sa recherche.
L’éclatement de la représentation figurative aboutit à des œuvres aériennes : zigzags de papillons, herbes en brosse, akènes de graminées sur lesquelles on souffle, ou tablettes d’une écriture cryptique, cunéiforme, dirait-on, qui énoncerait quelque relation d’un monde dont le sens et les usages n’ont plus cours. Qu’on les décrypte ou pas n’est pas l’enjeu : ce n’est pas le gain d’un sens ou de son absence, mais de notre destruction par ce je ne sais quoi d’inéluctable, qui est peut-être à l’œuvre.
Eve Gramatzki désordonne alors l’énigme réaliste comme si elle suivait une fatalité de la dispersion. Et son mouvement est à la fois hésitant et sûr, qui semble dire : à quoi bon résister.
Désordonner l’énigme réaliste, écrire l’illisible du réel

C’est dans les années 90 qu’elle parviendra sur cette voie qui fait la singularité de son travail, et où l’on sent le jeu des vibrations et une lucidité d’aveugle. Ses œuvres se voilent d’une trame ou d’un maillage tracés au crayon. Pénélope ou prisonnière, Eve Gramatzki expose le panorama fantomatique d’une vision bouchée. Derrière la grisaille, comme parasitée, pas vraiment de sérénité, mais le silence de brumes froides, de réminiscences peut-être : lait noir de l’aubei de quelque impossible dévoilement. Brouillard où pourraient apparaître un spectre ou des barbelés : le repère d’un irreprésentable. Et cette grisaille, comme parfois celles des vitraux, cache quelque chose d’irréparable ou d’impossible à atteindre.
Les œuvres des toutes dernières années interrogent : grandes feuilles couvertes d’aquarelles et de lignes, panneaux évoquant des suaires sans visage ; ensemble préparé avec soin pour recevoir l’on ne sait quoi, attendu et redouté, qui ne vient pas encore, qui peut-être ne viendra jamais.
Même intensément colorées, émeraude vermillon citrin, ces œuvres semblent naître d’un informe ambivalent. Les matériaux utilisés, mine de plomb craie cendres, opacifient des lavis plutôt éteints : vert d’eau, beige, mauve, bleuâtre. Et leur lumière semble bien venir d’en deçà, comme diffusée par un écran qui obturerait la lumière au-delà.
Mais on pourrait aussi y voir une longue missive – écrite par qui ? –, stèle où l’écriture serait comme vue de très loinii, comme si la lire n’importait pas, comme si ce qu’elle disait était l’illisibilité elle-même. Une illisibilité qui serait attente. Cette micrographie, qui est celle des enfermés (volontaires ou pas), rappelle qu’on doit s’appliquer de très prêt pour comprendre et écouter, sans être sûr de pouvoir saisir ce qu’on dit. Elle invite à se pencher vers quelqu’un qui murmure quelque chose de très sensible mais qu’on entend mal dans le bruit du monde.
Vers la grande épreuve intérieure

Elle s’était retirée dans les Cévennes. Un ermitage à elle, où elle poursuivait son travail. Et celui de ces années 90 semble décrire une grande épreuve intérieure, taraudée par l’attente d’une délivrance. Mais semble aussi témoigner de cette aspiration à une vision. Ou bien est à l’œuvre une sorte de rayonnement inversé, absorbant, qui est souvent le propre des natures mystiques, des deuils interminables. Et les lignes de ses dessins, tout ce maillage précis mais à l’efficacité incertaine, seraient élaborés pour parer quelque béance de refaire surface.
La fuite et la quête, indémêlables, aboutissent donc à la survenue d’une menace de nouveau ; comme si une force, gantelet aimanté, attirait à elle et couvrait la lumière du désir, en lui faisant sentir une épaisseur de noir, dont on ne sait si elle est épaisseur ou piétinement devant le néant. Cette fascination encore pour la béance qui nous habite, nous fonde peut-être, mais semble aussi différer toute extase apaisante. Par extase, j’entends cette saisie au bord du gouffre d’une lumière intérieure, qui serait comme une émanation et une révélation englobante du réel.
L’être en nous que toute démarche artistique ou intérieure cherche à révéler est profondément ambivalent et dangereux. Qualité bien connue du sacré. Et l’art n’est pas forcément, contrairement au poème, selon le mot de Paul Celan, ce rien d’autre qu’une poignée de main. Chez Gramatzki, la poignée de main avec le réel est aussi un stigmate. Elle étreint un rien qui la pénètre. Et si dans l’œuvre des années d’isolement vibrent la poussière, le sol et la lumière, cette vibration semble conscience d’une imprévisible instabilité.
Malgré cela, peut-être à cause de cette humanité qui s’est déposée dans son travail d’alors, ces œuvres nous accueillent avec bienveillance – celle de qui a beaucoup souffert et compris.
Le réel est ce pourquoi on se met en route. Même si cette route doit nous tuer. Souvent transmuée par quelque rite, sa part inquiétante conduit sur un chemin entre dévoration et sublimation. On finit par y succomber. Pas toujours bienheureux comme l’artiste chinois du conte, quand le peintre tourne le dos à son public, qu’un brouillard venu de leur œuvre emplit la pièce et que, sous l’action de cette magie inconsciente d’elle-même, il s’enfouit dans son œuvre.
Il est des disparitions plus tragiques, quand l’art n’empêche pas le monstre de dévorer l’être, de l’entraîner contre son gré, de le mutiler, provoquant la consternation autour de lui. Car parfois, personne ne peut aider, personne ne peut secourir.
Certaines œuvres rayonnent, tendent la main vers nous. Elles nous dénudent, mais restent à nos côtés face à l’extase dont elles parlent et à laquelle elles préparent peut-être, sur le chemin de laquelle elles guident.
Et puis d’autres sont des recherches inquiètes qui exposent le versant sombre de cette marche dans la montagne, au bord des falaises. Mais elles éclairent paradoxalement sur le danger de cette grande épreuve dont parle la mystique. Et à quoi certains ne réchappent pas.
L’œuvre d’Eve Gramatzki est peut-être de ces dernières.
Sa vie privée, inutile d’y trop entrer.
Elle a sur les photos un air fragile et un côté Coco Chanel ; elle portait de petits chapeaux, était élégante, un peu hautaine aussi. L’allure d’une funambule. Le choix des Cévennes, où elle s’était retirée et ne trouvait pas l’apaisement espéré, n’est sans doute pas indifférent. Héritières de l’Eglise du Désert, les Cévennes ont toujours su accueillir les fugitifs. C’est le dénuement qu’elle aura voulu vivre. Réfugiée de l’intérieur, sans reposoir durable. Il lui fallait creuser des sillons vides, errer sur des feuilles préparées pour quelque survenue qui l’eût sauvée. Errance qui finirait par s’interrompre dans une conviction tragique : la vie prépare longtemps à quelque chose qui n’arrive jamaisiii.
Les êtres comme Eve Gramatzki oscillent entre ce qui explose l’être dans la joie et ce qui le réduit à rien. Sur ce chemin instable, pareil à celui des mystiques sans dieu, elle connaîtra dans le secret le moment de bascule : irruption d’un néant sans extase, dont l’empaumure finit par tout avaler de la vie, en laissant parfois une œuvre. C’est la cruelle ironie que subissent, saints ou artistes, les arpenteurs du dedans.
Mais il n’est pas impossible que ce soit pourquoi une telle œuvre peut être une si fidèle amie pour celles et ceux qui vivent ça.
PATRICK AUTREAUX
i Paul Celan
iiFrançois Boutibonnes
iiiW.B. Yeats