
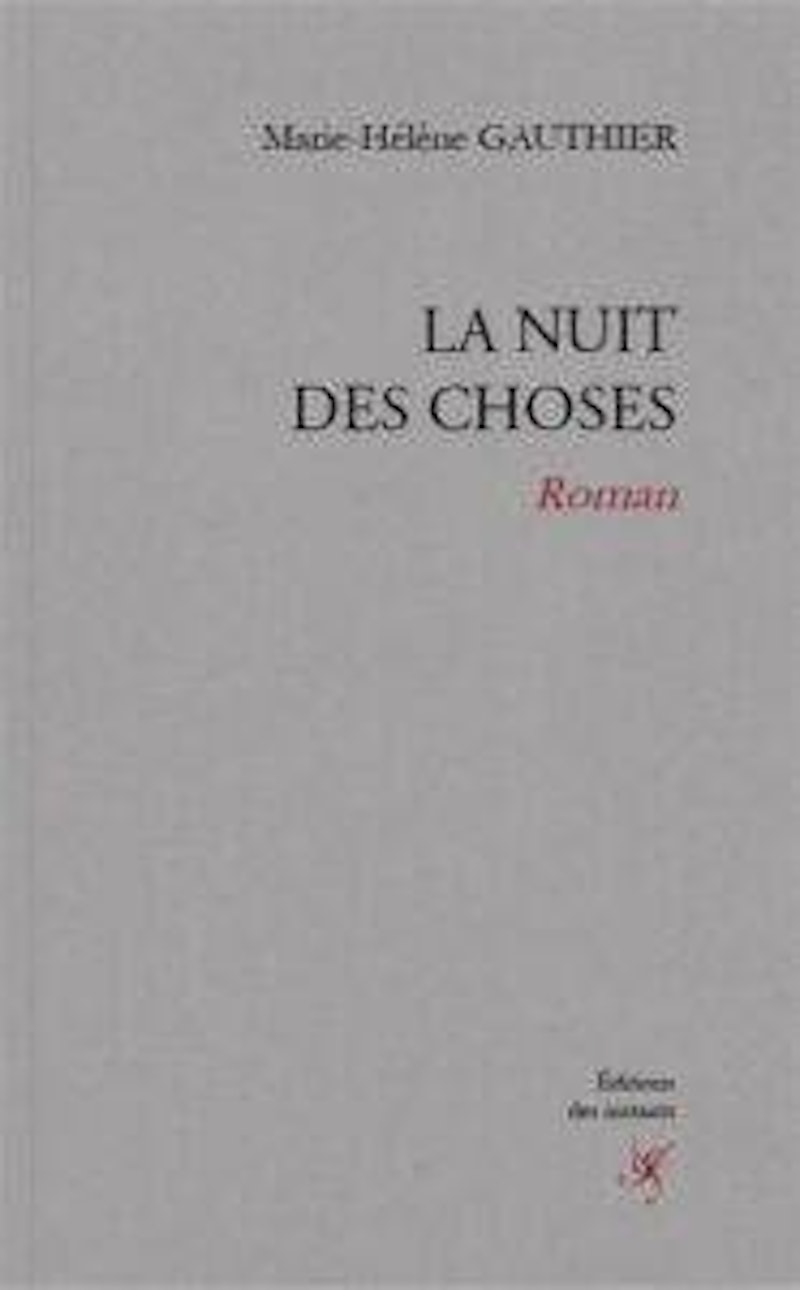
Marie-Hélène Gauthier : De choses connues, de choses vécues et que j’ai essayé de comprendre. Il y a une formule de Henri Thomas que j’aime beaucoup qui dit « ce qui fait souffrir, c’est l’inexpliqué ». Alors mon but était peut-être d’essayer de creuser, non pas un foyer d’explications – parce que je crois qu’on n’en trouve pas – mais une traversée à l’intérieur de cet inexpliqué pour essayer non pas de l’amadouer mais de l’atténuer. D’atténuer la souffrance qu’entraine l’inexpliqué.
Vous écrivez : Elle enviait souvent la liberté de ceux qui ne s’attachaient pas, n’ancraient pas leurs émotions dans l’esthétique d’un tableau, d’une statuette, d’une coupole, d’un bol imparfait. De ceux qui contenaient si bien tout ce qu’ils ressentaient qu’ils déplaçaient sans trainer derrière eux le besoin de tisser l’harmonie, pour scinder l’espace de ce qui avait été vécu. Parce que finalement, elle était de ceux qui ne se suffisaient pas. »
Pour vous, tout attachement esthétique se traduit-il par un manque, une impuissance à contenir ce que l’on ressent ?
Je ne sais pas si ça traduit ou si ça en émane. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Mais quand vous avez relu cette phrase, j’ai pensé à un tout petit ensemble de vers d’Henri Thomas que j’aime beaucoup – je reviens souvent sur Henri Thomas car je suis en train de travailler sur lui en ce moment – qui dit : « Craignez, craignez, c’est une âme insoumise de voyageur à petite valise. » Et pour moi c’est l’image de la liberté. C’est aussi Anouilh qui a écrit sur le voyageur sans bagage. C’est cette possibilité qui est de ne pas avoir besoin de se lier à des objets extérieurs, qu’ils soient esthétiques ou de simples objets de la vie courante. Quand on n’a pas ce besoin, on doit pouvoir glisser sur le fil des jours, puisque l’on n’est pas attaché. En revanche, le personnage féminin de mon roman a ce besoin comme répondant à une forme de cadrage, pour y retrouver des ancrages dans le réel par le biais de la présence muette des choses. Et aussi d’une forme de dépendance. Car lorsque ça disparait, ou bien si ça devait être amené à disparaitre, il n’y a plus cette liberté du voyageur à petite valise. Il s’agit donc là de deux images de vie qui se confrontent dans mon esprit : vaut-il mieux n’être dépendant de rien et glisser aussi bien sur les évènements que sur le rapport aux choses et aux décors, ou alors avoir besoin de tisser une harmonie, c’est-à-dire de se lier à des objets qui résonnent entre eux ?
Donc, pour vous l’harmonie c’est une forme d’ancrage au réel en tissant des liens entre des choses auxquelles on se sent sinon étranger ?
Le terme de sumphonia, l’accord des choses, la résonnance, me parait quelque chose n’appartenant pas seulement à l’ordre de l’esthétique mais d’une sorte d’éthique existentielle.
Oui, et c’est pour ça que le terme de sumphonia, l’accord des choses, la résonnance, me parait quelque chose n’appartenant pas seulement à l’ordre de l’esthétique mais d’une sorte d’éthique existentielle. Des auteurs qui parlent de littérature comme Iris Murdoch ou Roland Barthes, disent que pour eux, aujourd’hui, le discours philosophique se déplace vers un discours différent, qu’ils appellent pour l’une, réalisme ontologique et pour l’autre, amour ontologique et qui est le rapport au réel lorsqu’il est lié au détail : l’amour des choses, l’amour du détail. Roland Barthes dit que c’est l’amour du moirée, les côtés chatoyants des infimes nuances du réel. C’est une forme de rapport au réel, une forme de vision du rapport au réel. L’harmonie, c’est d’arriver à faire en sorte que ces rapports aient un sens qui vous en donne à vous dès lors que l’on y trouve une place.
C’est une forme pour vous d’équilibre ?
Oui. Une forme d’équilibre, une forme d’esthétique et si je pouvais oser le terme, une forme d’ontologie, c’est-à-dire de rapport au réel.
Et comment l’équilibre, cet équilibre, peut se tisser de ce déséquilibre ? Est-ce qu’il passe quelque chose de ce déséquilibre dans l’équilibre de l’harmonie ?
Certainement que le déséquilibre est un moteur dans la recherche de l’équilibre, sans quoi les choses seraient données. Et l’équilibre est une forme de thérapie du déséquilibre, une forme de réaccordance au réel. Maintenant je crois que ça ne se trouve qu’en se cherchant ou en se faisant. C’est Antonio Machado qui dit que le chemin se fait en se faisant. Je crois que c’est un peu ça, l’harmonie se tisse dans le temps mais ça doit être comme une sorte de balance difficile entre l’équilibre et la vulnérabilité. Il y a certainement des personnes qui ont un rapport d’esthétique harmonieuse au réel immédiat, parce que cela ne leur pose pas de problème. Et puis d’autres, pour lesquels c’est une affaire, comme je l’ai dit tout à l’heure, d’ancrage et de besoin d’ancrage, donc c’est déjà plus tout à fait la même motivation.
Comment cette harmonie ou tout du moins ce rapport à l’harmonie a pu se retranscrire dans l’écriture de votre livre et dans votre travail de la langue ?
Je dois dire, en tout modestie, que le travail de la langue n’a pas été si grand que ça, et pour tous les livres philosophiques que j’ai écrits c’était pareil. J’ai toujours écrit de façon un peu immédiate en retravaillant après. Mais c’est pour ça que je ne suis sans doute pas une écrivaine véritable. Je ne suis pas de ceux qui vont écrire cinq lignes et vont passer cinq mois à réviser les cinq lignes. Ça part vraiment d’une continuité qui est relue après et cela même en philosophie. Alors maintenant, comment ça a joué ? Et bien dans l’autorisation de certaines inversions de phrases, de certains néologismes – dont plusieurs ont été d’ailleurs supprimés par la suite mais que je m’autorisais quand même – et puis une imagerie un peu maritime de la sonorité des phrases. J’avais envie que ça coule dans un rythme parfois répétitif. Pas des phrases qui soit serrées. Il y a une écriture qui est chez certains écrivains très courte, avec un rythme frappé. Moi, j’avais besoin d’un rythme à l’image de vagues qui se superposent les unes les autres.
Pour vous il y a un rapport à la mer quand on évoque les notions d’harmonie et d’écriture ?
D’abord je pense que ce à quoi j’ai été très sensible, c’était l’écoute. C’est-à-dire qu’en même temps que j’écrivais, j’étais sur une écoute du rythme de la phrase et qu’il fallait que ça ait l’air d’être, là aussi, comme un bruissement d’eau coulante. Et quand ça devenait trop sophistiqué ou encore trop conceptuel, alors j’essayais de défaire.
Et c’était donc une recherche d’équilibre entre le trop abstrait et le trop matériel ?
Exactement. C’était cette histoire de rythme qui, tout en laissant passer les descriptions intérieures que je devais faire passer, devait se trouver un peu lancinant, comme un flux qui se répéterait et qui reviendrait, parce que c’est un peu ça aussi l’inexpliqué : les choses que l’on se répète.
Ce qui renvoie à cette image de vagues ?
Oui, là aussi je suis très influencée par les imageries maritimes qu’on retrouve chez Georges Perros ou chez Henri Thomas. C’est ce bruit de la mer, auquel je suis extrêmement sensible.
Tout ce rythme, ce flux et ce reflux de conscience, dans l’espace d’une situation qui était inexpliquée ?
Dans une situation de perte et plus exactement de perte à soi. De sorte que l’ancrage dans les objets était aussi une forme de sauvetage, pour éviter la noyade pure. Car quand on perd complètement de vue le rapport à soi, ce qui reste ce sont ces petites choses qui sont comme des regards sur vous enveloppant de douceur.
- Marie-Hélène Gauthier, La nuit des choses, Éditions des instants, 2021.
- Lien du podcast « Je tiens absolument à cette virgule »

















